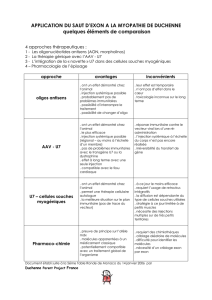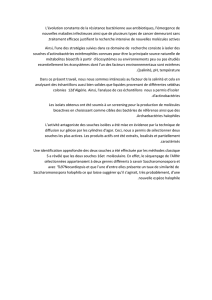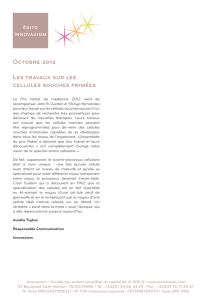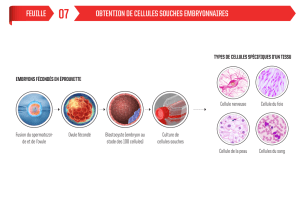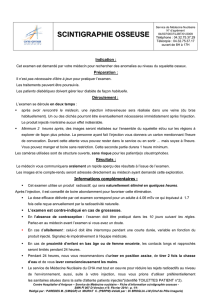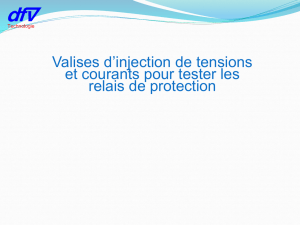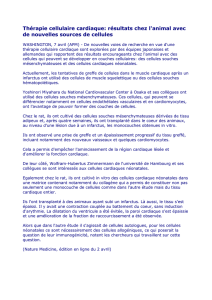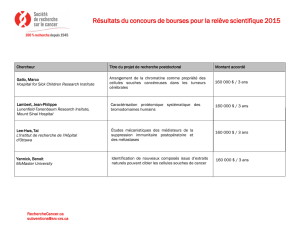cellules souches petstem stomatite caudale chat - Stem-T

Essai thérapeutique du traitement d’une gingivo-
stomatite féline par cellules souches
mésenchymateuses PETSTEM©

Points sur la gingivo-stomatite féline
La gingivo-stomatite féline fait partie des pathologies inflammatoires chroniques d’étiologie
multifactorielle connaissant des échecs thérapeutiques. De nombreux facteurs non exhaustifs
comme la présence de plaques dentaires, la présence d’une insuffisance rénale, l’infection par un
calicivirus, le virus leucemogene félin ou le virus de l’immunodéficience féline contribuent à
maintenir une inflammation chronique qui finit par s’auto-entretenir conduisant parfois à
l’euthanasie devant l’inefficacité des soins pour assurer un confort de vie quotidien à l’animal.
Le cas clinique de Tigrou
Tigrou est un chat européen mâle castré né en juillet 2013. Le 24 aout 2015, il est présenté suite à
une gingivo-stomatite déjà traitée il y a 2 mois par injection d’antibiotique à effet retard (cefovecine)
et de corticoïde à effet retard (diacetate de triamcinolone) qui avait amélioré les signes cliniques
pendant 5 semaines. La baisse d’activité (jeux, sorties, interaction avec ses congénères, etc) et
d’appétit de Tigrou (« s’étouffe », « s’étrangle » lorsque qu’il ingère ses croquettes/ses
boulettes/soupe) sont les indices évocateurs de la dégradation de l’état de sa bouche qui poussent
les propriétaires à consulter leur vétérinaire.
Lors des consultations qui suivront sur une période de plus d’un an nous observerons une
inflammation chronique des structure buccales caudales (tonsilles/gencives/muqueuses orales
maxillaires et mandibulaires/oropharynx). Un traitement par voie orale étant impossible (la
déglutition étant trop douloureuse et chat très peu coopératif), le même traitement par injection
d’antibiotque (cefovecine) et corticoïde longue action (diacetate de triamcinolone ) est renouvelé
tous les 1 à 2 mois. En milieu de parcours (6 mois après le début des injections retard), une exérèse
totale des dents est effectuée mais ne le soulage que très provisoirement (10 jours). Par la suite et à
3 reprises, seuls des corticoïdes retard (sans antibiotique) ont été injectés. L’amélioration fut moins
nette peut être dûe à une accoutumance et baisse d’efficacité causée par la répétition d’injections de
corticoïde.
En raison du budget limité des propriétaires, aucun test d’évaluation sérologique de statut FelV/FIV
ou de PCR calicivirose n’a été effectué. De même, les traitements à base d’interféron ou de
cyclosporine ont été proposés et refusés par les propriétaires pour la même raison.
Mode d’action des cellules souches
Migration des cellules souches
Lors d’une injection intraveineuse, les cellules souches mésenchymateuses se retrouvent
principalement retenues dans les capillaires pulmonaires. La plupart d’entre elles y périront dans les
72h post-injection. Une très faible partie (approximativement 5%) migre vers les tissus lésés de la
cavité orale (homing lésionnel).
Effet paracrine
Le mode d’action principal des CSMs provient de leur capacité à transmettre des messages chimiques
à leur environnement par la sécrétion de cytokines, de facteurs de croissance et de micro-vésicules
transportant des protéines et micro-ARN exerçant des fonctions diverses : anti-inflammatoires, anti-
apoptiques, pro-angiogéniques, cytoprotectrices, anti-fibrosantes…

Effets anti-inflammatoire
Cet effet s’obtient lorsque les cellules souches mésenchymateuses sécrètent les cytokines IL-1
récepteur antagoniste, TGF-ß et IL-10. A noter qu’il est d’autant plus important lorsque le chat
présente des symptômes inflammatoires marqués. On traite ici les symptômes et il en découle un
confort pour l’animal pendant une quinzaine de jours.
Effet immuno-régulateur
La stomatite caudale est une maladie dysimmunitaire. Les cellules souches mésenchymateuses ont
des propriétés immunorégulatrices notoires : elles vont agir sur l’une des causes de la pathologie.
La sécrétion par les CSMs des cytokines TGFb, HGF et PGE2 mais aussi de l’ondoleamine 2,3-
dioxygénase favorise la régulation du système immunitaire.
De plus, les CSMs inhibent la prolifération des lymphocytes T et B ainsi que les cellules dentriques et
les lymphocytes NK. C’est d’ailleurs par la réduction de la population de lymphocyte T CD8+ que l’on
parvient à obtenir réduction des signes cliniques. Cet effet peut prendre du temps pour se mettre en
place (2 à 4 mois).
Protocole cellules souches
Le protocole est à destination des patients réfractaire après avulsion dentaire et non atteints de FeLV
et FIV. Il se compose de :
d’un test d’éligibilité
de 2 injections, en intraveineuse lente, à un mois d’écart de seringues de 10mL de 20M de
cellules souches mésenchymateuses fraiches issues de tissus adipeux.
1
Répétition conseillée tous les 4 mois dans les cas les plus difficiles
Il est important que les CSMs soient fraiches, c’est-à-dire non congelées (la plupart du temps elles
sont conservées en azote liquide et livrées directement congelées grâce à de la neige carbonique). La
viabilité des CSMs congelées chute d’au moins 50% lors de la décongélation à quoi s’ajoute un choc
thermique invalidant leur fonctionnalité et capacité thérapeutique. De plus, du DMSO est
généralement ajouté à la solution comme cryoconservateur. Le DMSO engendre un risque de non
tolérance.
Pour ce cas cliniques, les CSMs fraiches (non congelées et donc sans DMSO) ont été envoyées par
livreur dans une pochette thermique à 4-6°C.
1
Arzi, Therapeutic Efficacy of Fresh, Autologous Mesenchymal Stem Cells for Severe Refractory
Gingivostomatitis in Cats, 2015, Stem cell translational Med.

Test d’éligibilité
Le 3 novembre 2016, le test d’éligibilité du traitement par cellules souches mésenchymateuses pour
la stomatite caudale est réalisé sur Tigrou. Il consiste en l’envoi au laboratoire de thérapie cellulaire
1mL de sang en tube EDTA (violet). Le prélèvement est passé au cymomètre de flux pour mesurer la
population de lympocytes T NK CD8+Low parmi la population de CD8+. Une population de CD8+Low
inférieur à 15% de la population de CD8+ est un biomarqueur de l’éligibilité du patient. Le résultat est
communiqué sous 48h maximum après réception du prélèvement.
Injections 1 (J0)
Tigrou est éligible et la date cible d’injection est fixée au 23 novembre 2016 (J0). Cela réclame une
organisation synchronisée car les CSMs ont une durée de vie très courte (72h), l’injection doit être
idéalement réalisée dans les 48 heures suivant leur sortie du laboratoire. Après 48h, la viabilité
cellulaire chute drastiquement à 40%. Il est important d’injecter les CSMs au plus vite après leur
conditionnement au laboratoire pour maximiser les effets thérapeutiques. Suite à des contraintes
logistiques extérieures, La première injection a été réalisée dans les 40h après la sortie du
laboratoire.
Un cathéter est posé sur la veine céphalique de la patte antérieure droite et une sédation à base
d’une association de tilétamine et zolazépam est effectuée. L’injection de 10 millilitres de CSMs à
concentration de 5 millions par KG est réalisée par voie intraveineuse lente sur 10 minutes. Afin
d’objectiver les résultats, un scoring des signes cliniques et des photographies du fond de la gueule
sont réalisées (PHOTO 1).
Photo 1 - Cavité orale avant injection 1 (J0)
Apres 3 jours sans effet visible, Tigrou se remet à manger, joue et dégluti sans s’étouffer pendant 15
jours puis se dégrade petit à petit.

Injection 2 (J+30)
Le 27 décembre 2016 (J+30), la seconde injection est réalisée et le fond de la gueule est
photographié (Photo 2 et 3) pour comparaison. Macroscopiquement, et ce malgré un aspect
anormalement épaissi, l’inflammation est bien moindre sur les gencives et l’oropharinx. Cependant,
la diminution de l’activité et les comportements anormaux d’étouffement et de gêne à la déglutition
persistent.
Photo 2 Cavité orale avant injection 2 (J+30)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%