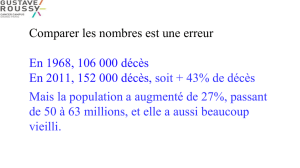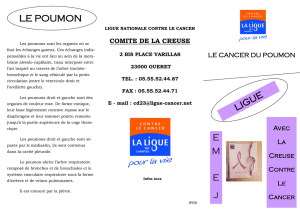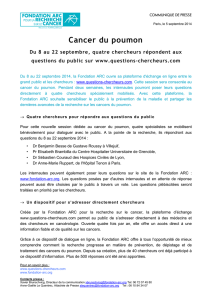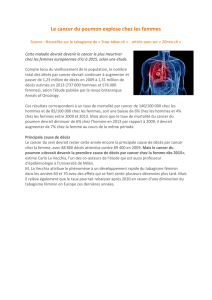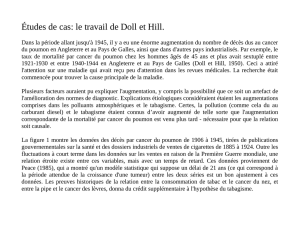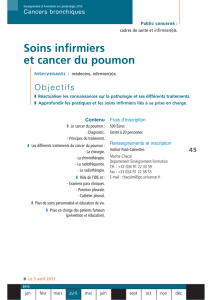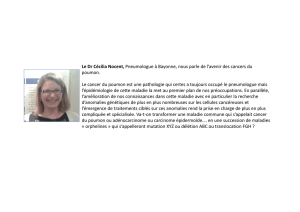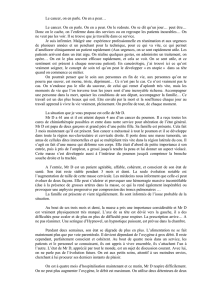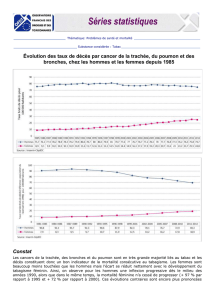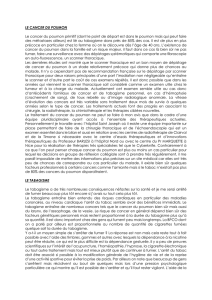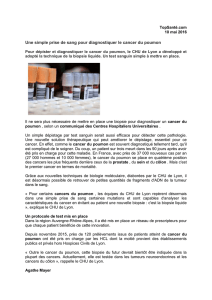Cancer du poumon

« Cancer du poumon,
le tabac n’est pas le seul coupable !
La Fondation pour la Recherche Médicale a été créée en 1947 pour apporter une aide rapide et décisive aux chercheurs
dans tous les domaines de la recherche médicale. La Fondation a ainsi participé à toutes les grandes découvertes
médicales françaises. Grâce uniquement aux dons et legs privés, elle soutient chaque année 1 chercheur sur 3 et finance
environ 700 programmes de recherche. La Fondation Recherche Médicale remplit également une mission d’information
pour favoriser le dialogue entre les Français et les chercheurs. A ce titre, elle s’est vue attribuer par le gouvernement le
label « campagne d’intérêt général 2005 ».
Pour faire un don :
Bullletin à découper en dernière page de ce document.
À retourner à :
Fondation pour la Recherche Médicale
54, rue de Varenne - 75335 Paris cedex 07
Tél. : 01 44 39 75 75 - Fax : 01 44 39 75 99
ou sur sur www.frm.org (rubrique "aidez la recherche")
Cancer du poumon : le tabac n’est pas le seul coupable y www.frm.org 1
> SOMMAIRE
Pourquoi des Journées de la
Fondation Recherche Médicale ?
25 000 nouveaux cas chaque année :
et demain ?
Doit-on généraliser la détection précoce ?
Des tirs de plus en plus ciblés
pour attaquer les tumeurs
Témoignages
Les réponses à vos questions
À propos de la Fondation
p. 2
p. 3
p. 3
p. 5
p. 7
p. 8
p. 14
> Propos recueillis à l’occasion de la 4è édition des
Journées de la Fondation Recherche Médicale, sur le
thème « Sommes-nous malades de notre
environnement ? ». Le présent débat s’est déroulé le 14
septembre 2005, à l’Amphithéâtre du CRDP de
Grenoble.
> Débat animé par Laurent Romejko, journaliste de
France 2.
> Document disponible sur le site de la Fondation
Recherche Médicale www.frm.org
> Publication : novembre 2005
> Crédits photographiques : Fondation pour la
Recherche Médicale
»
Avec la participation de :
> Dr Denis Moro-Sibilot
Pneumologue spécialisé en oncologie thoracique et praticien hospitalier dans le département de médecine aiguë
spécialisée en pneumologie du CHU, et chercheur au sein de l'unité Inserm 578 « Bases moléculaires de
l'initiation et de la progression des cancers du poumon », au sein de l’Institut Albert Bonniot à Grenoble.
> Pr Christian Brambilla
Chef du département de médecine aiguë pneumologie et directeur de l'unité Inserm 578 « Bases moléculaires de
l'initiation et de la progression des cancers du poumon », au sein de l'Institut Albert Bonniot à Grenoble.
> Pr Marie-Christine Favrot
Responsable de l'équipe « Thérapie du cancer du poumon par vectorisation intra-tumorale de molécules pro-
apoptotiques » dans l'unité Inserm 578, au sein de l’Institut Albert Bonniot à Grenoble.

Journées de la Fondation Recherche Médicale 2005 y Cancer du poumon y www.frm.org 2
Pourquoi
des « Journées de la Fondation Recherche Médicale » ?
Plus que jamais, les liens entre environnement et santé sont aujourd’hui au
cœur des inquiétudes des Français. Pollution de l’air et de l’eau, risques
alimentaires, contamination microbiologique et chimique, rayonnements,
stress et bruit… sont autant de facteurs incriminés dans nombre de maladies
et auxquels nous sommes tous potentiellement exposés. En outre, les
maladies liées directement ou indirectement à notre environnement et à nos
modes de vie sont en constante augmentation : cancers, maladies
cardiovasculaires, allergies, obésité, stérilité… À titre d’exemple, on estime
que 7 à 20 % des cancers seraient imputables à des facteurs
environnementaux ! Pourtant, aujourd’hui encore, nombre de questions
restent en suspens…
Devant le besoin d’information que vous nous manifestez chaque jour, la Fondation Recherche
Médicale a décidé en septembre 2005 d’ouvrir ce débat avec vous, en présence des meilleurs
experts. La 4e édition des Journées de la Fondation Recherche Médicale1 a posé, en effet, la
question « Sommes-nous malades de notre environnement ? ». Au cours de six débats sur six
thématiques différentes et dans six villes de France, un public venu nombreux a pu dialoguer avec les
chercheurs et trouver réponses à ses questions. Face à ce questionnement, la Fondation Recherche
Médicale a également choisi de lancer, dès 2004, le programme « Défis de la recherche en
allergologie2 ». C’est une réelle incitation au développement de recherches sur les origines
moléculaires et cellulaires des allergies et sur les pistes de traitements. C’est également une initiative
ambitieuse qui n’aurait pu voir le jour sans la générosité et la confiance de ses donateurs - peut-être
vous ? -. Cette nouvelle édition des Journées de la Fondation Recherche Médicale est finalement
l’occasion de mieux comprendre les enjeux de la recherche et de mesurer le rôle essentiel de la
Fondation Recherche Médicale.
Joëlle Finidori,
Directrice des affaires scientifiques
de la Fondation Recherche Médicale
1visitez le site consacré à l’événement http://www.jfrm.org
2pour plus d’infos, consultez la page http://www.frm.org/demandez/dem_specifiques_allergie.php

Journées de la Fondation Recherche Médicale 2005 y Cancer du poumon y www.frm.org 3
25 000 nouveaux cas
chaque année : et demain ?
Dr Denis Moro-Sibilot,
Pneumologue spécialisé en oncologie
thoracique et praticien hospitalier dans le
département de médecine aiguë spécialisée
en pneumologie du CHU, et chercheur au sein
de l'unité Inserm 578 « Bases moléculaires de
l'initiation et de la progression des cancers du
poumon », au sein de l’Institut Albert Bonniot à
Grenoble.
> Le tabac est-il aussi dangereux
qu’on le dit ?
Le tabac est certainement plus dangereux
qu’on le dit ! Alors
que cette
information est
inscrite sur les
paquets de tabac, il
y a une
minimisation
volontaire des
dangers du tabac
de la part des
industries qui le
fabriquent. Pour
preuve, il a fallu
attendre 2001 pour que le PDG de Philip
Morris International reconnaisse que la
cigarette était nocive. Le combat contre ceux
qui fabriquent des cigarettes est un combat de
David contre Goliath, avec un rapport financier
de 1 à 100. Le déséquilibre entre les moyens
mis à disposition pour la prévention et les
moyens de promotion du tabac est colossal. Il
y a beaucoup de choses à faire, comme
l’éducation des enfants dans les écoles ou
dans les universités, où il faut expliquer les
dangers du tabac. La part réglementaire et
législative reste également importante : la loi
Evin est une bonne chose, et l’appliquer en
serait une meilleure !
Les Etats-Unis, via leur réglementation, ont
abouti à une diminution très importante du taux
de cancers dans la population, aussi bien chez
les hommes que chez les femmes, même si la
diminution est moins marquée chez ces
dernières. Les mauvaises habitudes des
hommes sont passées dans la population
féminine au cours des années 1970. La
France en est encore loin. Du fait des
modifications des habitudes tabagiques, les
hommes fument moins (70 % d’hommes
fumeurs dans les années 1960 à 45 - 50 % en
2 000 voire 30 % dans la région grenobloise)
et développent moins de cancers du poumon,
au contraire des femmes, dont le tabagisme a
augmenté de manière importante. Ce
tabagisme féminin devient problématique,
notamment chez les femmes jeunes.
> Le tabac n’est pas le seul facteur
Il existe d’autres facteurs. On peut citer le
tabagisme passif. Dans les décès attribués au
tabac, on distingue les tabagiques actifs et les
tabagiques passifs. Des personnes qui ont
travaillé ou vécu dans des endroits enfumés
ont été exposées au tabac et ont un risque de
développer un cancer. Le tabac est une
pollution souvent ignorée qu’il faut pourtant
prendre en compte. Malheureusement, il
semble que les gens n’aient pas encore réalisé
le danger du tabagisme passif. La loi Evin est
mal respectée, comme on peut le constater
dans les gares ou les aéroports.
Par ailleurs, l’amiante est un facteur
professionnel, largement répercuté par la
grande presse. Sur les 25 000 cancers du
poumon qui se déclarent chaque année en
France, un millier est lié à l’amiante. D’autres
facteurs sont liés à la pollution : des études
menées à Singapour montrent un parallélisme
entre l’intensité du trafic automobile et
l’incidence de certains cancers. La pollution
industrielle est également responsable de
certains cancers. Des travaux menés sur le
sous-continent indien, où les normes sont
moins respectées qu’en Europe, montrent une
augmentation du nombre de cancers en
fonction du nombre d’années passées à
travailler en usine. Des travaux nord-
américains ont montré qu’en terme de nombre
de patients atteints d’un cancer du poumon, le
poids de la pollution était comparable à celui
du tabagisme passif.
Doit-on généraliser
la détection précoce ?
Pr Christian Brambilla,
Chef du département de médecine aiguë
pneumologie et directeur de l'unité Inserm 578
« Laboratoire bases moléculaires de l'initiation
et de la progression des cancers du poumon »,
au sein de l'Institut Albert Bonniot à Grenoble.
> Pourquoi n’y a-t-il pas de dépistage
systématique du cancer du poumon ?
L’espoir de survie pour les patients atteints
d’un cancer du poumon est très différent selon

Journées de la Fondation Recherche Médicale 2005 y Cancer du poumon y www.frm.org 4
le stade auquel il est détecté.
Malheureusement, dans 8 cas sur 10, le
cancer du poumon est détecté trop
tardivement pour qu’une opération soit
possible. Lorsqu’on détecte un cancer précoce
à partir d’une radiographie pulmonaire ou d’un
scanner, les chances de guérison par la
chirurgie seule ou associée à une
chimiothérapie sont plus importantes.
Au contraire du
cancer du sein
par exemple, le
fait de réaliser
des examens
de dépistage
systématique
n’améliorerait
pas les choses.
Ces essais sont
très coûteux.
Voici trente ans,
des essais avaient été réalisés aux Etats-Unis
et en Europe en utilisant la radiographie
pulmonaire. Si l’on trouvait davantage de petits
cancers, la survie des sujets qui n’avaient pas
eu de radio n’était pas moins bonne que celle
des sujets qui avaient passé une radio. Le fait
de réaliser des radios à grande échelle
n’améliorait donc pas la situation. Ce type
d’étude dure très longtemps : cinq années sont
nécessaires pour inclure des milliers de
personnes, suivies de cinq autres pour les
suivre, et enfin de vingt années de débats sur
les résultats. Ces discussions se poursuivent
sur certains cancers, comme c’est le cas pour
le cancer du sein. Néanmoins, les femmes ont
des mammographies régulières, et le pronostic
du cancer du sein s’améliore. Ceci n’a pas
encore été montré sur le cancer du poumon.
Depuis deux ans, nous essayons d’obtenir de
la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance
Maladie) la possibilité de lancer l’essai de
dépistage en France. Aux Pays-Bas et au
Danemark, 12 000 personnes seront incluses
dans l’essai. Elles sont au nombre de 20 000
aux Etats-Unis. En France, les discussions se
prolongent et la CNAM ne semble pas être
décidée à investir la somme – il est vrai
considérable –, d’environ 200 millions d’euros.
Il s’agit en effet de réaliser des scanners sur
20 000 personnes pendant 5 ans. Il est
toutefois impératif que cet argent soit investi,
car le dépistage révélera de très petites
lésions, qui peuvent changer la donne. Cette
journée est l’occasion de demander à nos
responsables de santé d’apporter une
réponse, positive ou négative, sachant que les
crédits ont été mis de côté pour cela.
> A qui s’adresse ce dépistage ?
La population à risque est clairement celle des
fumeurs, ainsi que celle des personnes
exposées à l’amiante. La population féminine
ayant des antécédents de cancers du poumon
ou des voies respiratoires commence à être
considérée comme une population à risque. Il
faut tenter de mieux cibler ces populations à
risque, car l’argent de la Sécurité sociale doit
être utilisé à bon escient. Il ne faut pas non
plus réaliser des scanners à répétition, car cet
examen entraîne une irradiation qui peut ne
pas être dénuée de risque.
Le terme « tabagisme » ne se limite à définir le
fait de fumer 3 paquets par jour. Un tabagisme
prolongé chez la femme, avec quelques
cigarettes par jour, peut être tout aussi
dangereux. Il faut donc bien réfléchir à la
manière de cibler les patients et les patientes.
Il faut clairement dire aux jeunes femmes
qu’elles prennent beaucoup de risque, même
en fumant quelques cigarettes par jour.
En ce qui concerne le tabagisme passif, les
fumeurs doivent s’obliger à fumer à l’extérieur
de la maison. L’industrie du tabac est en toile
de fond pour masquer les informations : le
tabagisme passif est dangereux. La Loi Evin
est une bonne chose, mais il faut l’appliquer.
Lorsqu’une personne non fumeuse est dans
un milieu enfumé plusieurs heures par jour,
elle inhale des produits dangereux.
> Effets carcinogènes du tabac sur le gène
Le cheminement depuis le carcinogène
contenu dans la fumée de tabac jusqu’à
l’altération des gènes par ce carcinogène
commence à être bien connu. Ceci permettra
éventuellement d’avoir des armes efficaces.
Cette connaissance permet aussi d’avoir
toutes les preuves du délit, et ceci est à
présent bien prouvé pour le tabagisme passif,
même si la publication de résultats
scientifiques sur ce domaine a souvent été
freinée.
Laurent Romejko – Au cours de vos travaux
menés au sein du laboratoire Albert Bonniot,
avez-vous déjà bénéficié de l’aide de la
Fondation pour la Recherche Médicale ?
Pr Christian Brambilla – Bien sûr, et cela à
de nombreuses reprises. Un dossier a encore
été déposé cette année. Il est essentiel que la
Fondation soutienne les jeunes chercheurs.

Journées de la Fondation Recherche Médicale 2005 y Cancer du poumon y www.frm.org 5
Des tirs de plus en plus ciblés
pour attaquer les tumeurs
Pr Marie-Christine Favrot,
Responsable de l'équipe « Thérapie du cancer
du poumon par vectorisation intra-tumorale de
molécules pro-apoptotiques » dans l'unité
Inserm 578, au sein de l’Institut Albert Bonniot
à Grenoble
> Qu’est ce qu’un traitement ciblé ?
Il s’agit d’un traitement spécifique des
anomalies présentes dans la cellule tumorale,
qui lui ont permis de passer d’un état normal à
un état malin. Une cellule tumorale peut
présenter deux grands types d’anomalies : soit
elle se multiplie trop vite, soit elle refuse de
mourir. Ces anomalies peuvent se situer au
niveau du gène : actuellement, il est encore
difficile de traiter une maladie par thérapie
génique en
intervenant
directement sur
le gène.
Heureusement,
le gène code
pour des
protéines,
contre
lesquelles on
dispose de
davantage
d’armes
lorsqu’elles sont
anormales.
> Quelles anomalies peut-on cibler ?
Les premières anomalies sont les facteurs de
croissance, qui permettent aux cellules
tumorales de survivre et de se multiplier : on
peut essayer de bloquer ces facteurs de
croissance en les neutralisant. Les facteurs de
croissance se fixent sur des récepteurs situés
sur la membrane de la cellule maligne : on
peut alors essayer de bloquer ces récepteurs.
On peut également bloquer le système
existant entre ces récepteurs et la machinerie
interne de la cellule maligne, dont la mise en
marche déclenche la multiplication cellulaire.
La médecine commence à disposer de
drogues pour lutter contre ces anomalies.
Un autre type d’anomalies concerne la
vascularisation d’une tumeur. Une tumeur a
besoin d’être nourrie pour proliférer, et cette
nourriture (oxygène, sucres, …) arrive via des
vaisseaux, qui lui sont indispensables. Si l’on
réussit à détruire cette vascularisation, on a
une chance de voir la tumeur régresser ou
disparaître. Une série de traitements vise soit
à détruire ces vaisseaux (voici plus d’un siècle,
des chirurgiens thrombosaient déjà les artères
irriguant une tumeur), soit à utiliser des
thérapeutiques ciblées, en neutralisant les
facteurs de croissance des cellules de ces
vaisseaux.
> Pourquoi des thérapies ciblées ?
Le premier motif repose sur l’espoir que ces
thérapies ciblées soient moins toxiques qu’une
chimiothérapie. Ceci n’est pas clairement
démontré, car rien dans l’organisme n’est
totalement spécifique et ces thérapies peuvent
toucher d’autres cellules.
Le second motif est que malgré un nombre
croissant de molécules de chimiothérapie avec
des modes d’action différents et la possibilité
de les associer entre elles, certains cancers
(notamment le cancer du poumon) restent
relativement résistants à la chimiothérapie.
> Quel espoir mettre dans ces
thérapies ciblées ?
Le milieu médical et les malades ont un grand
espoir dans ces thérapies ciblées. Il faut
toutefois le nuancer : leur spécificité à une
anomalie fait à la fois l’intérêt et la limite de
ces molécules. En effet, chaque malade a sa
propre tumeur, même si l’on peut nuancer en
disant que 25 % des malades présentent un
type d’anomalie, 25 % un autre type… La
prescription de ce type de médicament
nécessite que la tumeur ait été analysée et
que le traitement soit bien indiqué. Par ailleurs,
on dispose de molécules ciblées contre
quelques anomalies, mais pas toutes. Cela
signifie qu’il faudra multiplier cet arsenal
thérapeutique afin d’avoir au final une
molécule pour chaque groupe de malade, via
un traitement personnalisé. Une autre limite
vient du fait que certaines anomalies sont
relativement faciles à cibler. D’autres sont
beaucoup plus complexes, car il est
nécessaire d’amener le médicament jusqu’au
noyau de la cellule maligne. Ces problèmes
rappellent ceux de la thérapie génique et
nécessitent la fabrication de vecteurs qui
amèneront les molécules thérapeutiques au
bon endroit.
Les médias ont cité des molécules
« miracles » qui avaient soigné des malades à
des phases critiques de leur maladie, comme
dans le cas de la leucémie myéloïde avec le
Glivec©. Dans le cas du cancer du poumon, la
molécule Iressa© cible un facteur de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%