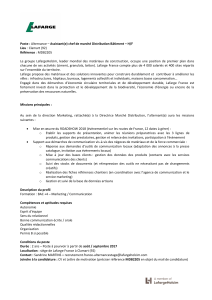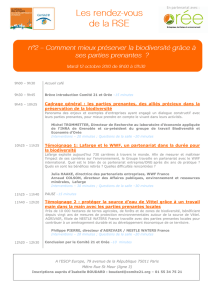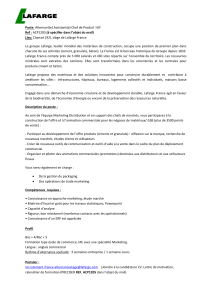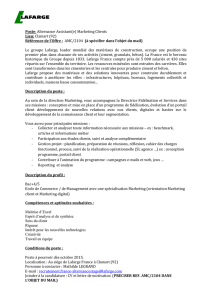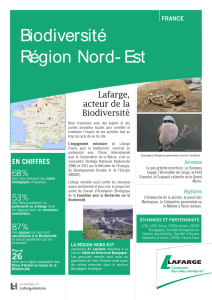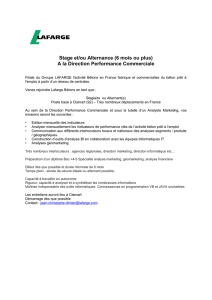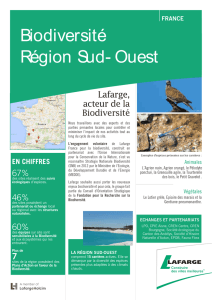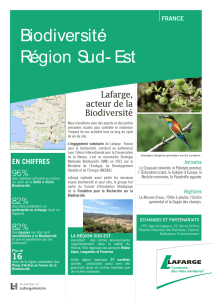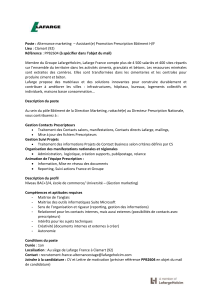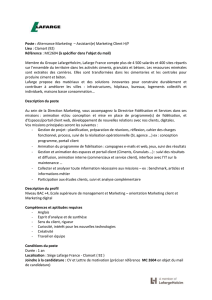Grand Journal de la Biodiversité

s
LA DÉMARCHE DE LAFARGE
en question
La protection
des écosystèmes
1.
RÉHABILITATION, UNE OPPORTUNITÉ POUR LA BIODIVERSITÉ ?
2. RÉAMÉNAGEMENT : CONFRONTATION
OU CONCERTATION ? 3. VERS UN SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA BIODIVERSITÉ ? 4. COMMENT
PROTÉGER ET DÉVELOPPER LES SERVICES RENDUS PAR LES ÉCOSYSTÈMES ?
LE GRAND JOURNAL
DE LA BIODIVERSITÉ

L E G R A N D J O UR NA L DE L A BI OD IV ER SI TÉ | L AFAR GE | 3
© Médiathèque Lafarge - Francis Vigouroux
Lafarge exploite 730 carrières dans le monde // 450 millions de tonnes de roches sont
extraites // 64% des carrières ont été évaluées selon des critères établis par le WWF //
79% des carrières disposent d’un plan de réhabilitation // 35% des carrières situées
en zone sensible sont dotées d’un programme de développement de la biodiversité
>Carrière d’Anneville, Normandie, France.
OLIVIER LUNEAU
Directeur du Développement durable et des Affaires publiques Groupe
Au cœur de notre stratégie
de développement durable,
la protection de la biodiversité
est une préoccupation ancienne
pour nous. Mais elle a pris
toute sa mesure depuis 2000,
grâce à la signature du partenariat
avec le WWF. Nous nous sommes
alors formellement engagés
à instaurer des plans de réhabilitation
de toutes nos carrières en activité.
Nos équipes se sont beaucoup
professionnalisées et, aujourd’hui,
nous avons atteint un niveau de
maturité qui nous permet d’avoir des
objectifs mesurables. En lien avec
les parties prenantes, nous identifions
les risques et appliquons notre
politique. Nous mesurons
constamment sa pertinence grâce à
nos indicateurs clés de performance.”
“
Lancées en 2007, les Ambitions Développement durable 2012 scellent les engagements
de Lafarge dans le domaine du développement durable en fixant des objectifs chiffrés. Le volet
consacré à la protection de la biodiversité prévoit notamment d’évaluer, selon des critères
validés par le WWF, la valeur écologique de l’ensemble des 730 carrières exploitées par le Groupe
à travers le monde. Il préconise également la mise en place de plans de développement de
la biodiversité sur les sites abritant des espèces animales ou végétales rares ou localisés dans
des périmètres protégés, en collaboration avec les associations environnementales locales.
Une feuille de route pour la biodiversité
© Alain Le Breton
BRUNO LAFONT
Président - Directeur général de Lafarge
BRUNO LAFONT
04
DIVERSITÉ BIOLOGIQUE:
AGIR FACE À L’URGENCE
06
BIODIVERSITÉ ET CARRIÈRES:
DES INITIATIVESLOCALES
À UNE DÉMARCHE DE PARTENARIATS
08
RÉHABILITATION, UNE OPPORTUNITÉ
POUR LA BIODIVERSITÉ?
Un cadre global pour une politique au quotidien
14
RÉAMÉNAGEMENT: CONFRONTATION
OU CONCERTATION ?
Transparence et dialogue, une dynamique
de progrès
16
VERS UN SYSTÈME DE MANAGEMENT
DE LA BIODIVERSITÉ?
Outils d’évaluation et formation,
gages d’efficacité
20
COMMENT PROTÉGER ET
DÉVELOPPER LES SERVICES RENDUS
PAR LES ÉCOSYSTÈMES?
Le rôle inestimable du milieu naturel
>De l’élaboration du projet de réaménagement du site
à sa réhabilitation, en passant par la période d’exploitation.
PAGES CENTRALES
LES 3 VIES D’UNE CARRIÈRE
SOMMAIRE
© Stéphane de Bourgies
© Médiathèque Lafarge - ConstructionPhotography.com - Paul McMullin
Organisation des Nations unies a déclaré 2010, Année internationale de la biodiversité afin
de mettre en lumière les enjeux et de nous alerter. Les scientifiques nous le confirment :
notre planète enregistre une perte de richesse biologique et la préservation des écosystèmes
est un défi capital pour l’avenir du monde.
Notre engagement pour la construction d’un monde plus durable est ancien. Il est le reflet
de nos valeurs et fondé sur une évidence : nous devons être exemplaires dans nos opérations
et suivre une démarche responsable qui suppose transparence et dialogue avec les associations
et les communautés voisines des carrières que nous exploitons. Notre ancrage au cœur des
territoires nous a permis de développer une grande capacité d’écoute et de concertation.
Ainsi, nous avons appris à enrichir notre approche scientifique de protection de la nature avec
des savoirs ancestraux. Aujourd’hui, nous avons fait des progrès importants. Nous sommes
capables d’insérer la carrière dans son environnement naturel, de reconstituer des habitats
pour la faune et la flore, et de préserver les espèces sensibles.
Notre objectif est maintenant d’être reconnu partout dans le monde comme un contributeur
responsable, compétent et efficace, au progrès de la biodiversité. Cette ambition s’appuie sur
des partenariats globaux et locaux – notamment avec le WWF International – sur des équipes
dédiées et motivées, sur notre dynamisme et notre désir partagé de progresser et d’apprendre.
© Charlotte Cauwer
2| LAFARGE | LE GRAND JOURNAL DE LA BIODIVERSITÉ
>
Carrière réhabilitée de Caversham, Royaume-Uni.
l’

L E G R A N D J O UR NA L DE L A BI OD IV ER SI TÉ | L AFA R G E | 5
4| LAFARGE | LE GRAND JOURNAL DE LA BIODIVERSITÉ
Les espèces sont actuellement en phase d’extinction massive. Cette urgence
appelle à une mobilisation des scientifiques, pouvoirs publics et acteurs
économiques, tenus d’intégrer rapidement des critères de développement durable.
ressources (chasse, pêche…) ; les invasions ou les proliférations d’espèces
(certaines algues ou cultures notamment) ; le réchauffement climatique,
principalement dû à l’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; et
la destruction ou la dégradation des écosystèmes (urbanisation, déforestation,
pollution des sols et des eaux, prélèvement non durable de l’eau…).
Si la disparition d’espèces vivantes peut parfois relever d’un phénomène
de régulation naturelle, son rythme actuel est extrêmement élevé. Et l’effet
d’entraînement de cette contraction de la biodiversité sur la planète est dévas-
tateur : chaque espèce qui disparaît met en péril l’équilibre d’un écosystème
entier, avec le risque de provoquer de nouvelles extinctions et de bouleverser
des phénomènes naturels qui paraissaient immuables.
Des pratiques remises en question. L’intervention humaine a souvent
malmené les milieux naturels. La déforestation, la chimie agricole alliée à une
culture intensive ou encore l’assèchement des zones humides ont causé
d’immenses préjudices. « Le sol est un écosystème, souligne Jean-
Paul Jeanrenaud, directeur des relations avec les entreprises au WWF Inter-
national. S’il est maintenu en bonne santé, il sera productif ad vitam æternam
et fournira toujours de la nourriture. En revanche, si l’on détruit la faune et
la flore naturelle qui sont à l’origine de sa fertilité, il faudra toujours plus
d’apport extérieur, ce qui coûtera de plus en plus en cher. Et en définitive,
le sol sera rendu stérile : il ne sera plus qu’une matrice pour maintenir les
plantes dans une position verticale. »
Les écosystèmes des marais, longtemps jugés improductifs, ont également
pâti de l’activité humaine. « Quand on parlait des zones humides, autrefois,
on parlait de marécages, indique Arnaud Colson, directeur des affaires
publiques et du développement durable de l’Activité Granulats & Béton en
France. Le marécage avait une connotation très négative : il attirait les
moustiques et les maladies, il propageait les virus. Aujourd’hui, nous savons
L’érosion de la biodiversité observée depuis les
années 1980 est en partie due à l’activité humaine.
2010 a été décrétée Année internationale de la biodiversité par les Nations
unies pour sensibiliser l’opinion mondiale aux dangers qui pèsent
aujourd’hui sur la survie de nombreuses espèces animales et végétales.
Communément, la biodiversité désigne la variété des espèces vivantes sur
notre planète. Or, aujourd’hui, la disparition des espèces s’opère à un rythme
alarmant. « Le point de vue est unanime parmi les spécialistes : on assiste
à une érosion, un recul profond de la biodiversité, constate Jean-Marie Pelt,
professeur honoraire de biologie végétale à l’université de Metz et président
de l’Institut européen d’écologie. Le taux d’extinction est, selon les espèces,
de 50 à 1 000 fois supérieur au taux d’extinction attendu. C’est une érosion
rapide, et qui s’accélère. »
Phase d’extinction massive. En 2005, le rapport « Millennium Ecosystem
Assessment » estimait que la disparition de 12 % des oiseaux, 25 % des
mammifères et 32 % des amphibiens se produirait d’ici à 2100. Et nombre
de scientifiques estiment aujourd’hui que la planète traverse sa sixième
grande crise d’extinction. Une crise essentiellement due à l’action de l’espèce
humaine sur son environnement. Le Centre national de la recherche scien-
tifique (CNRS) distingue, en effet, quatre grandes causes, qui, interconnec-
tées, sont à l’origine de cette extinction massive : l’exploitation intensive des
Diversité biologique :
agir face à l’urgence
JEAN-PAUL JEANRENAUD
Directeur des relations avec les entreprises au WWF International
Il y a des endroits
particulièrement sensibles
où il ne devrait y avoir aucune
activité industrielle, et les entreprises
doivent apprendre à respecter
ces restrictions. Dans d’autres,
il est parfaitement possible
de protéger la biodiversité tout
en exerçant une activité industrielle.
Mais cela requiert une certaine
rigueur, de la discipline, et des
investissements. Une approche
responsable peut présenter
un coût initial mais, au final,
être un bon voisin, être une
entreprise respectueuse des milieux
naturels apporte des bénéfices.”
© Irène R Lengui / L’IV
“
que le marécage est une zone humide riche au plan écologique parce que,
justement, elle accueille de nombreuses espèces, dont les moustiques, qui
font partie de la chaîne alimentaire des oiseaux et des batraciens. Nous
savons aussi qu’elle procure un service d’écosystème essentiel : la purifica-
tion de l’eau. »
Devant le constat des dégâts causés par des pratiques irresponsables,
une évidence s’impose. « Protéger l’environnement relève tout simplement du
bon sens, souligne Jean-Paul Jeanrenaud (WWF International). Sans écologie,
il n’y a pas d’économie : on ne fait pas de business sur une planète morte. »
Face à l’urgence, pouvoirs publics, ONG, scientifiques, mais également
industriels doivent se mobiliser pour prendre les mesures nécessaires à la
protection des espèces et de leurs habitats. La mise en place de partenariats
et d’initiatives communes paraît aujourd’hui indispensable pour mener des
actions concertées et mobiliser l’expertise permettant de mesurer l’impact
des activités humaines. « Non seulement l’industrie peut faire rimer business
et préservation de l’environnement, mais elle le doit, conclut Jean-Marie
Pelt. Elle doit intégrer l’ensemble des problématiques de développement
durable. Il n’existe a priori aucune incompatibilité rédhibitoire, pour peu
que l’on ait à l’esprit un autre modèle et que l’on mette en œuvre des
pratiques adaptées. »
© DR
Pour comprendre et préserver la flore et la faune, le
partage des connaissances est un enjeu essentiel.
LA VIE SUR TERRE, UN FRAGILE ÉQUILIBRE
Afin de mener une démarche de protection de la biodiversité sur ses anciennes
carrières, Lafarge a noué, au fil des ans, de nombreux partenariats. À la clé,
une connaissance approfondie du vivant et des outils de diagnostic écologique.
ESPÈCES
TERRESTRES
L’Indice Planète vivante est un indicateur de la biodiversité dans le monde. Son évolution
accuse une régression à partir des années 1980, qui s’accélère après 1990.
ESPÈCES
D’EAU DOUCE
ENSEMBLE
DES VERTÉBRÉS
ESPÈCES
MARINES
INDICE PLANÈTE VIVANTE
(Indice 1 en 1970)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
© DR Médiathèque Lafarge
>Carrière réhabilitée de Meknès, Maroc.
La biodiversité est partout, sur terre et dans l’eau.
Elle englobe toutes les formes de vie, des micro-
organismes aux plantes et animaux. La survie et
la reproduction des espèces vivantes reposent sur
un ensemble d’interactions communément désigné
par le terme d’écosystème. Cette interdépendance
rend la nature extrêmement vulnérable à une
extinctionaccélérée des espèces.

L E G R A N D J O UR NA L DE L A BI OD IV ER SI TÉ | L AFA R G E | 7
6| LAFARGE | LE GRAND JOURNAL DE LA BIODIVERSITÉ
Les prémices de la réhabilitation. Dès les années 1970 et tout au long
des années 1980, le rapprochement des sites d’extraction avec des associa-
tions de naturalistes se faisait au niveau local, de façon ponctuelle et le plus
souvent informelle. Mais au milieu des années 1990, une nouvelle étape
est franchie, et la démarche est élargie. Elle constitue la première étape vers
la définition d’une politique globale de préservation des milieux naturels et
des espèces menacées.
« En 1995, Lafarge a été le premier industriel à mettre en place un contrat avec
le Muséum national d’histoire naturelle en France, se rappelle Arnaud Colson,
directeur des affaires publiques et du développement durable de l’Activité
Granulats & Béton du Groupe en France. Cela ne s’était jamais fait auparavant.
Ce partenariat consistait à établir des inventaires scientifiques sur nos terrains,
en totale transparence, et à travailler sur des projets de réhabilitation. Cela a
été passionnant, car nous avons fait beaucoup de découvertes sur le plan
scientifique, et effacé un certain nombre de nos préjugés. » C’est à cette
période que s’est développée la notion de réaménagement progressif ou
coordonné qui sera appliquée à toutes les carrières du Groupe, tandis que
les actions menées auparavant, sur la base d’initiatives locales, souffraient
de grandes disparités.
Initier une dynamique à l’échelle du secteur. En 1995, Lafarge rejoint
le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (World
Business Council for Sustainable Development ou WBCSD), un groupement
L’extraction de matières premières minérales est indispensable à la fabrica-
tion de matériaux de construction. Le calcaire et l’argile entrent dans la compo-
sition du ciment, le plâtre est fait à partir de gypse, tandis que les granulats
sont des roches concassées. Lafarge exploite aujourd’hui 730 carrières à
travers le monde, d’où sont extraites 450 millions de tonnes de roches. Sur ces
sites, qui échappent à l’activité agricole et à l’urbanisation, existe l’opportunité
de créer des zones adaptées pour accueillir diverses espèces animales et
végétales. À condition de développer des procédés d’exploitation responsables
et de recréer des espaces écologiques sur le site des anciennes carrières.
Afin de mesurer et maîtriser l’impact de ses carrières sur l’environnement,
Lafarge a progressivement mis en place une politique de partenariats.
de 200 entreprises engagées pour faire progresser les problématiques liées
au développement durable. L’objectif affiché du WBCSD est d’imaginer et de
promouvoir des processus industriels dont l’empreinte environnementale sera
neutre, voire positive. Dans le secteur cimentier, un tel objectif nécessite
de longues années et de profondes transformations. Mais, en prenant des
engagements concrets et publics, Lafarge a initié une réelle dynamique à l’échelle
du secteur. Associé au groupe de travail sur la biodiversité, Lafarge y est égale-
ment actif sur les thèmes de l’énergie, du changement climatique et de l’eau.
« Lafarge est engagé dans de nombreux programmes, souligne James Griffith,
directeur général écosystèmes au WBCSD, notamment au travers de la cofon-
dation de l’Initiative ciment pour le développement durable (Cement Sustai-
nability Initiative ou CSI). » Ce programme réunit aujourd’hui 23 entreprises
cimentières, qui représentent 40 % de la production mondiale. En partageant
leurs expériences et en mettant en œuvre des bonnes pratiques et des innova-
tions communes, ses membres s’attachent à réduire de façon concertée
l’impact de leurs activités sur l’environnement.
Une approche inédite. En signant en 2000 un partenariat au niveau mondial
avec le WWF International, le Groupe a initié un genre d’association inédit,
aussi bien dans le monde de l’entreprise que dans celui des ONG. L’approche
des problématiques environnementales développée par le Groupe, et plus
spécifiquement ses initiatives en faveur de la biodiversité, ont créé un précé-
dent, tant dans le secteur cimentier que dans l’industrie dans son ensemble.
« Pour nous, c’était une expérience : pouvons-nous travailler avec une très
grosse entreprise, dont l’empreinte environnementale est importante, et pouvons-
nous exercer une réelle influence ?, se souvient Jean-Paul Jeanrenaud (WWF
International). Peu d’entreprises adoptent ce genre d’approche, ouverte à la
discussion et au débat. » La mise en place de cette collaboration ne s’est pas
faite sans heurts, mais le partenariat, qui a été renouvelé à deux reprises, en
2004 et en 2009, a apporté beaucoup au secteur cimentier et plus générale-
ment aux relations entre l’industrie et les ONG environnementales. « La prise
de conscience des industriels nécessitait une action forte et visible. C’est là le
premier grand succès de notre collaboration », conclut Jean-Paul Jeanrenaud.
Grâce aux outils élaborés avec ses partenaires, des plus petites associations
locales au WWF, Lafarge s’est attaché à améliorer sa connaissance de l’envi-
ronnement et, dans les zones sensibles, à mettre en place des programmes
de gestion de la biodiversité à travers, notamment, la réhabilitation des
carrières. Les unités opérationnelles du Groupe sont amenées à identifier les
risques et les opportunités que représente leur activité pour la biodiversité
locale. Et au terme de l’exploitation d’un site, des espaces écologiquement
et économiquement viables sont recréés.
« L’apport de ces partenariats est essentiel pour Lafarge, souligne Pierre
de Prémare. Sans regard extérieur sur nos actions, nos initiatives et les possi-
bilités de les améliorer, nous resterions juge et partie de notre travail. »
Grâce à ces rapprochements, Lafarge a défini pour ses carrières des méthodes
innovantes de revalorisation des sites, qui ont depuis révélé leur efficacité.
© Médiathèque Lafarge - Olivier Coulange
1970
Dès le début des années 1970,
Lafarge prend en compte les enjeux
environnementaux sur ses sites,
et notamment les carrières.
Le Groupe adopte alors plusieurs
mesures qui anticipent les
réglementations, comme en France
et au Kenya.
1980
Au cours des années 1980, Lafarge noue
de multiples partenariats, officiels ou
informels, avec des associations locales
de naturalistes sur des thèmes précis : un
ornithologue qui vient compter les oiseaux
sur une carrière, un botaniste qui a repéré
des espèces intéressantes sur un site…
1979
La Communauté européenne
adopte la directive oiseaux,
relative à la préservation des
espèces sauvages.
La même année, la convention
de Berne sur la protection
de la vie sauvage est signée par
la Communauté européenne
et quarante-quatre autres pays.
1992
À Rio de Janeiro (Brésil)
se tient la première
conférence des Nations unies
sur l’environnement.
Elle aboutit notamment
à la signature de la Convention
sur la diversité biologique.
1987
Le rapport Brundtland
de la Commission mondiale
sur l’environnement
et le développement
crée un nouveau concept :
« Le développement
durable est un mode
de développement
qui répond aux besoins
du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures
de répondre aux leurs. »
HALLER PARK, UN SITE D’EXCEPTION
Le réaménagement en parc naturel de
l’ancienne carrière de la cimenterie de Bamburi,
près de Mombasa au Kenya, a commencé dès
le début des années 1970. Sur les 422 espèces
végétales introduites ou apparues spontanément
dans les écosystèmes forestiers, les zones humides
et les prairies réaménagées de l’ancienne carrière,
364 ont survécu, dont 30 figurent sur la liste
rouge des espèces menacées établie par l’Union
internationale pour la conservation de la nature
(UICN). La beauté du site, rebaptisé Haller Park,
l’intégration écologique réussie, ainsi que le
nombre de ses visiteurs et l’activité économique
générée, ont fait de cette réhabilitation une
réalisation emblématique.
2009
Dans la carrière de Presque Isle
aux États-Unis, Lafarge lance pour la
première fois une étude visant à analyser
et évaluer la valeur des services rendus
par les écosystèmes sur l’un de ses sites.
1999
Membres du Conseil mondial des
entreprises pour le développement durable
(World Business Council for Sustainable
Development ou WBCSD), Lafarge
et Holcim créent l’Initiative ciment
pour le développement durable.
Cette démarche sectorielle novatrice
réunit aujourd’hui 23 cimentiers du monde
entier, qui travaillent ensemble à réduire
les impacts écologiques de leurs activités.
1995
Lafarge signe son premier
partenariat en France avec
le Muséum national d’histoire
naturelle. Les études menées
contribuent à développer une
expertise dans la connaissance
du vivant sur les carrières.
2007
Le plan Ambitions
Développement durable 2012
de Lafarge fixe des objectifs
chiffrés pour réduire
l’empreinte environnementale
des activités du Groupe.
2000
Le WWF et Lafarge nouent
un partenariat.
Cette association inédite
entre un acteur industriel
et une organisation non
gouvernementale de
protection de l’environnement
crée un précédent.
Biodiversité et carrières :
des initiatives locales à une
démarche de partenariats
LES ÉTAPES CLÉS DE LA POLITIQUE DE LAFARGE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
ARNAUD COLSON
Directeur des affaires publiques et du développement durable de l’Activité Granulats & Béton, France
Dans les années 1980,
on a pris conscience que, tout
au long des Trente glorieuses,
la reconstruction de nos différents
pays engagée après la Seconde
Guerre mondiale s’était faite dans
des conditions discutables du
point de vue de l’environnement.
`
L’urgence de la reconstruction
et une réglementation relativement
souple ont favorisé des procédés
industriels néfastes d’un point
de vue écologique.
Aujourd’hui, on se rend compte
que les principes de développement
durable, en plus d’être utiles pour
l’environnement, se révèlent
bénéfiques en matière de rentabilité.”
“
PIERRE DE PRÉMARE
Directeur de l’environnement et des affaires
publiques pour les carrières de Lafarge
Il y a eu un véritable
changement dans
le contexte international.
Auparavant, les industriels
étaient considérés comme de
grands destructeurs de la nature.
Dans de nombreux pays,
le Groupe commence aujourd’hui
à nouer des relations de
confiance avec les associations
environnementales et les
scientifiques. Comme le souligne
le WBCSD, la préservation
de l’environnement repose aussi
sur les entreprises.”
“
© DR Médiathèque Lafarge
© Médiathèque Lafarge
© Médiathèque Lafarge
© DR

L E G R A N D J O UR NA L DE L A BI OD IV ER SI TÉ | L AFA R G E | 9
8| LAFARGE | LE GRAND JOURNAL DE LA BIODIVERSITÉ
e 27 décembre 2009, dans une tribune du quoti-
dien espagnol El Pais, le célèbre écrivain péruvien
Mario Vargas Llosa propose de sacrer personna-
lités de l’année Owen et Mzee, un hippopotame et
une tortue. L’histoire de ce duo peu ordinaire est
si exemplaire qu’on croirait à une fable. En
décembre 2004, alors qu’un raz de marée dévas-
tait les côtes kenyanes, un bébé hippopotame
happé par les eaux a finalement été rejeté sur
terre dans les environs de Mombasa. Recueilli par
les employés du Haller Park voisin, il ne tarde pas
à se choisir une mère adoptive : Mzee, une tortue
d’Aldabra, âgée de 130 ans. Pendant des mois,
elle lui a tout appris : nager, manger, chercher des
continuer à exploiter des carrières, nous devons
montrer ce que nous avons fait sur d’autres lieux,
comment nous avons recréé des milieux naturels
viables, géré des forêts depuis vingt-cinq ans, et
travaillé en bonne intelligence avec des parte-
naires et des communautés locales. »
Aujourd’hui, obtenir un permis d’exploitation peut
durer plusieurs années. Pour que ce permis soit
accordé, la capacité de l’entreprise à rendre son
activité acceptable est un critère essentiel. Et
rendre une carrière acceptable, c’est, en grande
partie, restituer après exploitation un site abritant
un milieu naturel cohérent et une biodiversité
importante. Dans certains cas, la biodiversité
recréée grâce à la réhabilitation peut même se
révéler plus riche que celle observée sur le site
avant l’exploitation.
Amorcer le travail de réhabilitation en amont
permet d’associer les parties prenantes locales au
projet et de déterminer avec elles les priorités et les
endroits pour dormir… Et Vargas Llosa de
conclure sa chronique en exhortant les belliqueux
humains à suivre cet exemple de sagesse, de
solidarité et d’harmonie.
Cinq ans après, Owen et Mzee coulent toujours
des jours heureux à Haller Park. Créé sur le site
de l’ancienne carrière de Bamburi de la cimen-
terie de Lafarge à Monbassa, le parc, devenu un
refuge de biodiversité, est un modèle de gestion
du réaménagement d’une carrière, pris en
exemple partout dans le monde. Mais la réhabili-
tation d’une carrière en un site naturel viable
est une démarche inscrite sur le long terme,
au succès de laquelle il faut consacrer des années.
Et qu’il convient donc d’engager à temps.
Une démarche responsable
C’est pourquoi, aujourd’hui, toute nouvelle carrière
ouverte par Lafarge doit être dotée d’un plan de
réhabilitation avant même le début de son exploi-
tation. C’est d’abord une question de légitimité.
« Nous avons une devise qui est la suivante : “Nos
réaménagements d’aujourd’hui sont nos carrières
de demain”, explique Pierre de Prémare. Pour
Un cadre global
pour une politique
au quotidien
l
1.
© Médiathèque Lafarge - Olivier Coulange
René Haller
Naturaliste, créateur du Haller Park dans la carrière
de Bamburi, au Kenya
J’ai commencé la réhabilitation
de la carrière en 1971, avant qu’elle
n’appartienne à Lafarge, en tant
que directeur général de Baobab Farm
qui avait été appelée par l’entreprise
exploitante. Au début, il n’y avait pas
de terre et nous avons dû faire
des expériences avec différents types
d’arbres pionniers pour ramener
la vie dans la carrière. Sans notre
intervention, la nature aurait mis bien
plus longtemps à reprendre ses droits.
Aujourd’hui, nous pouvons réhabiliter
beaucoup plus vite grâce au soutien
financier de Lafarge. Je suis fier que le
site soit devenu si célèbre et soit pris
en exemple par de nombreuses carrières
dans le monde.”
LA CARRIÈRE DE SOUTH PIT, PRÈS DE
CALGARY, AU CANADA, A ÉTÉ EXPLOITÉE
DE 1970 À 1998. Son réaménagement,
engagé en relation avec de nombreux
partenaires locaux, a consisté en la création
de trois parcelles distinctes : le quartier
résidentiel de Chaparral, le terrain de golf
Blue Devil et le parc Lafarge Meadows.
Cet espace naturel comprend notamment
des zones humides à la végétation dense,
où nichent de nombreuses espèces d’oiseaux.
Les plans d’eau ont, en outre, été conçus
pour drainer les éventuels débordements
de la rivière voisine ou des bassins d’orage
de la ville de Calgary.
Les initiatives environnementales du Groupe
dans la région ont été récompensées
par le prix Alberta Emerald en juin 2009.
UN SITE, TROIS RÉHABILITATIONS
LA PREUVE PAR L’EXEMPLE
© DR
© DR Médiathèque Lafarge
Réhabilitation, une opportunité pour la biodiversité ?
Lafarge s’est appuyé sur son expérience et sur les bonnes pratiques pour structurer sa politique en matière
de préservation des milieux naturels. Le plan de réaménagement, nécessairement conçu sur mesure,
en fonction de la sensibilité du milieu naturel, est élaboré selon des règles précises.
“
© Médiathèque Lafarge - Olivier Coulange
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%