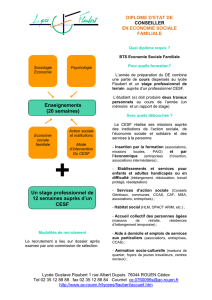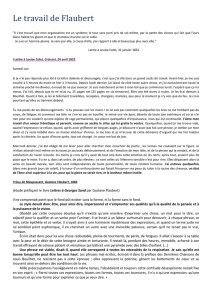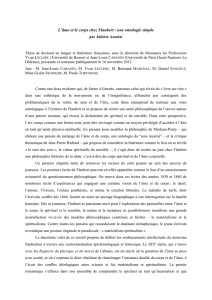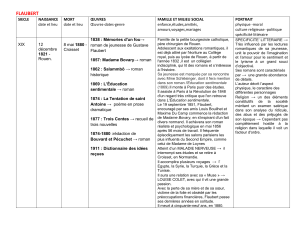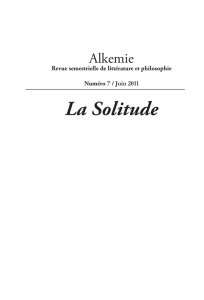Revue Flaubert, n° 7, 2007 De Flaubert à Cioran

1
Revue Flaubert, n° 7, 2007
De Flaubert à Cioran : une pensée de la contradiction.
Relire Flaubert à l’aune de La Tentation d’exister de Cioran
Thierry Poyet
Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand 2, IUFM d’Auvergne)
« Son pessimisme n’est pas seulement un malaise romantique.
Il est plus profond ; il est philosophique et raisonné. »
René Dumesnil, Gustave Flaubert (p. 329)
Dans La Tentation d’exister, Cioran cite une seule fois
Flaubert pour inscrire en quelque sorte le romancier dans
l’actualité de notre époque : « Rappelez-vous plutôt le mot de
Flaubert : « Je suis un mystique et je ne crois à rien. » J’y vois
l’adage de notre temps, d’un temps infiniment intense, et sans
substance. » (p. 121). Or, c’est précisément cette question de la
postérité de Flaubert que l’œuvre de Cioran, à sa manière,
permet d’interroger : la pensée flaubertienne telle qu’elle
s’exprime dans la correspondance mais aussi dans les romans
réussit-elle à nous interpeller aujourd’hui, et si oui, pour nous
transmettre quelle conception de la vie ? Plus : dans quelle
mesure la pensée de Cioran, un siècle plus tard, peut-elle se lire
comme une occasion de renouer avec celle de Flaubert qu’elle
viendrait illustrer, approfondir ou développer sur un mode plus
résolument philosophique et en même temps plus noir ou tout
simplement poussé dans ses derniers retranchements ?
Par commodité pratique, et parce que nous y lisons
résolument une sorte de quintessence de la pensée de Cioran,
nous avons choisi de limiter notre analyse à ce texte de 1956
1
qu’est La Tentation d’exister en le confrontant vigoureusement à
la correspondance de Flaubert.
Et c’est la rencontre de deux conceptions philosophiques de
l’existence que nous voudrions interroger au travers de quatre
pistes de réflexion pour mieux comprendre la portée de la
« philosophie flaubertienne » :
– l’œuvre de Cioran tente de répondre à la question « qu’est-ce
qu’exister ? » et dans ses propositions le penseur renoue à
–––––
1
. Un siècle le sépare donc juste de Madame Bovary si l’on prend en compte sa
parution en feuilletons dans la Revue de Paris, dirigée entre autres par un certain
Maxime Du Camp.

2
plusieurs reprises avec les positions de Flaubert : il conviendrait
donc d’analyser en quoi il est légitime d’établir une vraie
filiation et de chercher dans la pensée de Cioran ce qu’elle
emprunte à celle de Flaubert en lui donnant alors une nouvelle
actualité, une seconde force, une portée supérieure. La place du
moi, la question de la rupture avec une société de la bonne
conscience, le tiraillement entre l’Absolu et le quotidien de
l’existence ou encore la tentation de la mort, dans le meurtre ou
le suicide, apparaissent, entre autres, comme des éléments
essentiels d’une rencontre intellectuelle qui rappelle un Flaubert
au romantisme vite coloré de nihilisme. Autrement dit, le
Flaubert d’une pensée qui se cherche pour se construire dans
une opposition révoltée et un esprit de ferme contradiction.
Penser, c’est s’opposer aux autres, voilà peut-être comment
caractériser la philosophie flaubertienne et le mode sur lequel
elle se développe.
– de manière plus immédiatement concrète, cette rencontre
s’établit aussi à travers une redéfinition de la relation aux
autres : quelle place réserver au penseur qui se construit en
rupture avec la société qui est la sienne, et le plus souvent, en
opposition avec ses contemporains ? Pourquoi, et dans quelle
mesure, la posture de Flaubert, singulière en son temps, peut-
elle être reprise à son compte par Cioran, un siècle plus tard,
pour être érigée en principe même de l’être-là ? Le regard porté
sur la société, la figure de l’intellectuel, la question des valeurs,
ou encore l’attirance pour le débile, constituent quelques-uns des
nombreux moments d’un dialogue intense entre Flaubert et
Cioran qui rappelle combien l’écrivain Flaubert n’a eu de cesse
de penser l’homme en rupture : quand le renoncement a favorisé
l’affirmation d’un nihilisme puissant, il s’agit encore de trouver
la voie d’une nouvelle esthétique. Flaubert penseur s’affirme-t-il
ou disparaît-il en Flaubert artiste ? Quand penser, c’est se
dédoubler…
– cependant, parce qu’il y a deux pensées, malgré tout, qui se
heurtent portées par deux mondes, deux expériences et deux
existences bien étrangers, des différences subsistent, essentielles
entre les deux penseurs, et il n’est pas possible de retrouver
toute la passion flaubertienne dans l’obstiné renoncement de
Cioran : la place du moi avec lequel Flaubert ne rompt pas,
toujours vigoureux, ou au contraire la lucidité de ce même
Flaubert sur la réelle portée d’une œuvre littéraire apparaissent
comme autant de coins enfoncés dans une filiation qu’on aurait
pu croire plus marquée encore. C’est bien la complexité
contradictoire de Flaubert qui semble encore l’emporter. Penser,

3
c’est rencontrer l’autre pour mieux s’affirmer seul.
– enfin, dans une pensée qui s’affine en rétrécissant le champ de
ses investigations, Cioran définit volontiers la figure de
l’écrivain et la fonction du littéraire. Très souvent, son propos
interroge les principes flaubertiens – de l’impersonnalité au
projet du roman sur rien, en passant par l’attrait exceptionnel
concédé au poétique sur le narratif – et s’établit comme porté
par la figure tutélaire d’un Flaubert qui aurait mis en actes ce
que le penseur essaye – plus ou moins bien – de théoriser. Il faut
donc interroger encore l’enjeu de cette rencontre qui, s’appuyant
sur la citation d’autres écrivains que Flaubert, semble pourtant
tout entière construite autour de l’œuvre flaubertienne : comme
si elle venait révéler que celle-ci est à même de synthétiser tant
les questions essentielles qui sont posées que les éléments de
réponse qui sont avancés parce que Flaubert serait d’abord le
penseur d’une esthétique, une esthétique de la différence, de
l’opposition et de l’isolement. Penser, c’est construire après
avoir détruit…
Ainsi, la lecture de Cioran peut-elle se donner comme un
moment fort de relecture de l’œuvre flaubertienne, aussi bien
dans ses romans que dans sa correspondance : un révélateur.
Non que Cioran renvoie explicitement et fréquemment à
Flaubert mais parce que le discours qui se donne à lire a déjà été
tenu.
En effet, Flaubert, trop souvent limité à n’être qu’un grand
romancier, un esthète exigeant ou un contempteur farouche de la
bêtise – c’est déjà tant ! –, peut prétendre à une approche plus
globale qui l’éclaire dans sa dimension de véritable penseur de
la comédie humaine. Certes, son œuvre littéraire ou épistolaire
ne constitue pas une entreprise de philosophie au sens propre –
ce n’est pas un système totalisateur qui réfléchit le monde et se
réfléchit – mais elle doit être considérée, aujourd’hui, dans sa
richesse humaniste qui, l’enlevant au cadre étroit de son siècle,
l’affirme définitivement dans son intemporalité. Parce qu’elle
dit aux hommes ce qu’ils sont, rien que ce qu’ils sont, tout ce
qu’ils sont ou devraient devenir et que lui, Flaubert, se sent déjà
être : des êtres de contradiction(s) trop désireux de ce qui sera et
non de ce qui est, pour qui l’intransitivité du verbe penser l’a
emporté sur sa transitivité, pour qui la philosophie exprime un
repli sur soi, seule promesse d’avenir, et non une ouverture aux
autres, certitude présente, objet de tous les renoncements.

4
Pour une définition de l’existence : « penser contre soi »
L’existence pose problème parce qu’elle est existence sociale
et Flaubert, repris en cela par Cioran, dénonce l’homme dans
son état d’animal social. On connaît les multiples déclarations
de l’épistolier qui s’oppose à la vie commune, à la pensée
générale, à un mode de vie consensuel ; on sait aussi tout ce
qu’il reproche à la pente de Rousseau que l’humanité a préféré
suivre, plutôt que celle de Voltaire. Flaubert hait une existence
de la facilité intellectuelle, du sentiment compassionnel, de
l’empathie démagogique. Or, Cioran pense à l’identique contre
une existence sans aspérité, qui contourne les difficultés et évite
de résoudre les problèmes. D’où des déclarations à la violence
flaubertienne sous la plume de Cioran qui écrit par exemple :
Le degré de notre affranchissement se mesure à la quantité
d’entreprises dont nous nous serons émancipés, comme à notre
capacité de convertir tout objet en non-objet. Mais il ne signifie rien
de parler d’affranchissement à propos d’une humanité pressée qui a
oublié qu’on ne saurait reconquérir la vie ni en jouir sans l’avoir
auparavant abolie. (p. 15)
La notion d’effort se situe au carrefour de leurs philosophies.
Il s’agit d’exister autrement pour pouvoir accepter encore
l’idée même d’existence. Il y a bien sûr là l’expression d’un
tiraillement entre un désir d’Absolu et une prééminence de
l’existence telle qu’elle se donne dans sa banalité. Pour Cioran,
cela signifie : « nous sommes voulus sujets, et tout sujet est
rupture avec la quiétude de l’Unité. » (p. 21)
D’ailleurs, qui peut prétendre ne pas être bourgeois à ses
yeux, à lui qui rappelle que, par bourgeois, il faut entendre tout
ce qui pense bassement ? Les colères de Flaubert disent
justement sa difficulté à exister dans un monde qui ne semble
pas fait pour lui et où la notion même d’existence ne correspond
pas aux valeurs érigées pour soi-même : « Nous mesurons la
valeur de l’individu à la somme de ses désaccords avec les
choses, à son incapacité d’être indifférent, à son refus de tendre
vers l’objet. » (p. 21), théorise Cioran selon une approche tout à
fait voisine. La société bourgeoise est une société de la bonne
conscience et il n’est pas possible, pour Flaubert comme pour
Cioran, de la supporter telle quelle ; le propos de Cioran sonne
comme une attaque : « il faut empêcher ceux qui ont trop bonne
conscience de vivre et de mourir en paix. » (p. 14) N’est-ce pas
la mission que Flaubert assigne à ses romans ? Faire prendre
conscience du mal-être engendré par une société de la

5
suffisance, pousser à une réaction salvatrice avant qu’il ne soit
trop tard ? Mais Flaubert et Cioran savent bien, tragiquement,
leur appartenance à cette bourgeoisie-là, à ce camp de ceux qui
ont « trop bonne conscience »…
Si la question de l’existence n’interrogeait que la forme
constitutive de la société, la douleur de vivre semblerait bien
faible. Pour Flaubert, il en va conséquemment de la remise en
cause de sa propre existence : comment vivre en une société
aussi mal accueillante, aussi peu faite pour soi, pour ses
principes et ses valeurs ? La tentation du suicide s’affirme alors
bien vivace
2
. Comme la dernière échappatoire envisageable
quand tout a été tenté… Cioran, bien des années plus tard,
s’inscrit volontiers dans les mêmes pas. À son tour, il souffre
d’un environnement hostile, à son tour, il voudrait casser la
margoulette au premier venu
3
, comme l’écrit Flaubert dans ses
lettres et, à son tour, il remet en cause sa propre existence. D’où
cette confidence en signe d’alarme : « Seuls nous séduisent les
esprits qui se sont détruits pour avoir voulu donner un sens à
leur vie. » (p. 24)
4
Parce que la difficile non-acceptation de
l’existence passe par une remise en cause absolue de soi.
S’assumer, assumer son moi, son nom, sa conscience, s’il s’agit
de la première exigence imposée à l’homo intellectus, ne
constitue pas pour autant une attitude suffisante pour aider à
supporter les épreuves du quotidien. Il faut aller plus loin dans la
remise en cause de la facilité qui consiste à se laisser vivre : il
s’agit aussi de savoir se remettre en cause et de parvenir à
penser contre soi. Cioran affirme : « Maîtres dans l’art de penser
contre soi, Nietzsche, Baudelaire et Dostoïevski nous ont appris
à miser sur nos périls, à élargir la sphère de nos maux, à acquérir
de l’existence par la division d’être avec notre être. » (p. 11) Il
aurait pu ajouter à cette courte liste le nom de Flaubert, car c’est
ce qui a toujours fasciné – et tenté – le maître de Croisset.
Flaubert a su très vite qu’il portait en lui, aussi, tout ce qu’il
exécrait et s’il a essayé de tuer la part bourgeoise inhérente à son
être, à son éducation, à son mode d’existence, c’est aussi dans
–––––
2
. Voir notre article « La tentation du suicide ou la contradiction irrésolue », Bulletin
Flaubert-Maupassant, n° 6, 1998.
3
. Cioran écrit : « Entre la sérénité et le sang, c’est vers le sang qu’il est naturel
d’incliner. Le meurtre suppose et couronne la révolte : celui qui ignore le désir de tuer
aura beau peser des opinions subversives, il ne sera jamais qu’un conformiste. »
(p. 23)
4
. On ne peut s’empêcher de mettre alors une telle déclaration en relation par exemple
avec les rumeurs de suicide à la fin de la vie de Cioran et sa rupture avec la littérature,
notamment...
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%