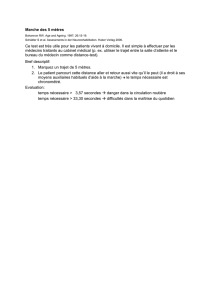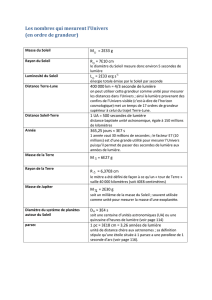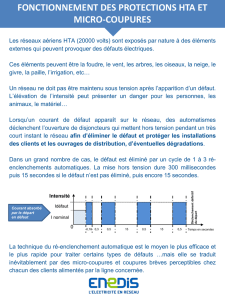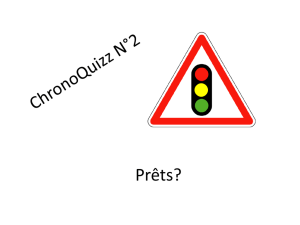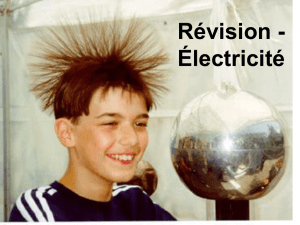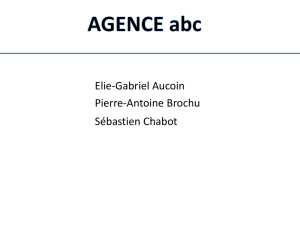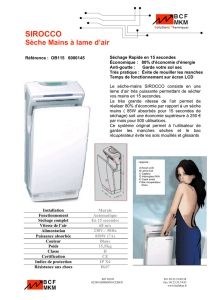Motivation, mémoire et pédagogie

Motivation, mémoire et pédagogie

Collection Savoir et formation
dirigée par Jacky Beillerot et Michel Gault
A la croisée de l'économique, du social et du culturel, des acquis du passé
et des investissements qui engagent l'avenir, la formation s'impose
désormais comme passage obligé, tant pour la survie et le développement
des sociétés, que pour l'accomplissement des individus.
La formation articule savoir et savoir-faire, elle conjugue l'appropriation
des connaissances et des pratiques à des fins professionnelles, sociales,
personnelles et l'exploration des thèses et des valeurs qui les sous-tendent,
du sens à leur assigner.
La collection Savoir et Formation veut contribuer à l'information et à la
réflexion sur ces aspects majeurs.
Dernières parutions
Dominique FABLET, Les interventions socio-éducatives, 2002.
Collectif, L'identité chez les formateurs d'enseignants. Echanges franco-
québécois, 2002.
Jean-François CHOSSON, Pratiques de l'entrainement mental, 2002.
Bernadette TILLARD, Des familles face à la naissance, 2002.
Jacky BEILLEROT, Pédagogie: chroniques d'une décennie (1991-
2001), 2002.
P. CARRE, M. TETART (coord.), Les ateliers de pédagogie
personnalisée,2002.
Bernadette TILLARD (coord.), Groupes de parents, 2002.
Ouvrage coordonné par Chantal HUMER T, Institutions et organisations
de l'action sociale. Crises, changements, innovations, 2003.
Claudine BLANCHARD-LAVILLE (coord.), Une séance de cours
ordinaire. «Mélanie tiens passe au tableau », 2003
Patricia VALLET, Désir d'emprise et Éthique de la Formation, 2003.
Claudine BLANCHARD-LAVILLE, Dominique FABLET, Travail social
et analyse des pratiques professionnelles. Dispositifs et pratiques de
formation, 2003.
M.C. BAIETTO, A. BARTHELEMY, L. GADEAU, Pour une clinique
de la relation éducative, 2003.

Fabien Fenouillet
Motivation, mémoire et pédagogie
L'Harmattan
5-7, rue de l'École-Polytechnique
75005 Paris
FRANCE
L'Harmattan Hongrie L'Harmattan Italia
Hargita u. 3 Via Bava, 37
1026 Budapest 10214 Torino
HONGRIE ITALIE

@L'Hannatlan,2003
ISBN: 2-7475-4546-6

SOMMAIRE
INTRODUCTION ... 1
MÉMOIRE 3
I-MÉMOIRE À COURT TERME ET MÉMOIRE À LONG TERME 4
1-Distinction entre stockage à court terme et à long terme 4
1.1 En termes de durée 4
1.2 En termes de capacité 6
2-Modèles modulaires de la mémoire 6
3-Pluralité de la mémoire à court terme 10
3.1 Activation à court tenne 10
3.2 Mélno ire de travai I Il
3.3' Mélnoire fichier 12
II -MÉMOIRE ET ORGANISATION 13
1-Stockage 13
1.1 Notion de" chunk" 13
1.2 Codes et organisation 15
1.3 Organisation subjective 17
2-Récupération 21
2.1 Récupération et catégorisation 22
2.2 Encodage des épisodes 25
3-Stratégies d'organisation et procédés mnémoniques 26
3.1 Prin cipes généraux 26
3 .2 Class i fi cation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
III - MÉMOIRE ENCYCLOPÉDIQUEET EXPERTISE 34
1-Expertise 34
2-Ménl0ire encyclopédique 36
IV -LAMÉMOIREÀL'ÉCOLEETENFORMATION 38
1 - Que retenons nous d'un cours? 39
1.1 Quantité d'infonnations : 39
1.2 Vitesse des infonnations : 39
1.3 Connaissances antérieures: 40
1.4 Et le reste ? 41
2 - lnlportance du nl0de de présentation des connaissances 41
2.1 Modalité de présentation: 42
2.2 Fonne de présentation: 44
3-De quelles connaissances s'agit-il? 44
MOTIVATION 47
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%