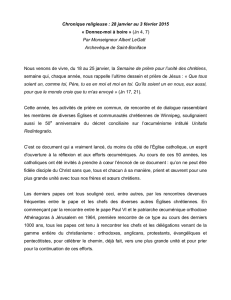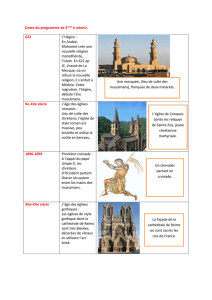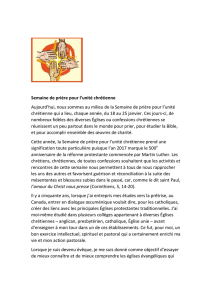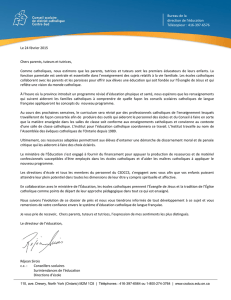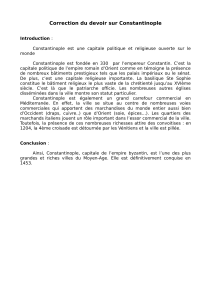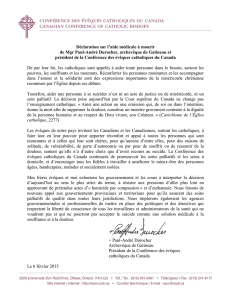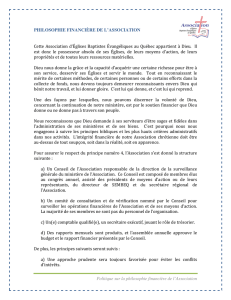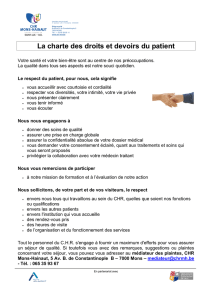Les catholiques à Constantinople Galata et les églises de rite latin

REMMM 107-110, 227-243
Elisabetta Borromeo*
Les catholiques à Constantinople
Galata et les églises
de rite latin au XVIIe siècle
Abstract. Catholics in Constantinople: Galata and Latin-Rite Churches of the 17
th
Century
This article suggests some elements for reflection on the catholic presence in the 17th century
Galata, suburb of Constantinople. On the base of the accounts of the catholic missionaries and
some Ottoman documents (kept in the archives of Saint Peter and Paul’s church in Istanbul),
this study examines the legal status of these Catholics, their distribution in the urban space as
well as the means they used to expressing their identity.
Résumé. Cet article propose quelques éléments de réflexion sur la présence catholique à Galata,
faubourg de Constantinople, au
XVII
e
siècle. En prenant appui sur les relations des missionnai-
res catholiques ainsi que sur des documents ottomans (conservés dans les archives de l’église
Saints Pierre et Paul à Istanbul), cette étude examine le statut juridique de ces catholiques,
leur répartition dans l’espace urbain ainsi que les moyens auxquels ils avaient recours pour
manifester leur identité.
Le 29 mai 1453, après un siège d’un mois et demi, Constantinople byzantine
tombait aux mains des Ottomans. Deux jours plus tard, Galata, le faubourg de
la ville situé de l’autre côté de la Corne d’Or, qui était depuis 1267 un comptoir
génois (Sauvaget, 1934 : 253), se rendit à Mehmed II, s’assurant ainsi une série
de privilèges en échange de sa soumission volontaire. Le 1er juin les Génois de
* Historienne, chercheur associée à l’UMR, Études turques et ottomanes, Paris.

228 / Elisabetta Borromeo
Galata signèrent un traité (‘ahdnâme*) aux termes duquel le sultan ottoman
s’engageait à ne pas détruire la “forteresse” et leur accordait le droit de conserver
leurs lieux de culte, d’y officier les cérémonies selon leur rite et d’élire parmi
eux un kethüdâ* (prieur) qui serait chargé de gérer leurs affaires et notamment
l’administration temporelle des églises. Par ce document, le nouveau souverain
reconnaissait la continuité du caractère chrétien et « étranger » (génois et puis
franc) du faubourg, placé sous l’autorité de la Magnifica Comunità di Pera et
de son conseil de la Loggia, bien que désormais Galata se trouvât de facto sous
administration directe du voïvode* ottoman et du cadi (Inalcık, 1991 ; Eldem,
1999 : 148-150). Cet ‘ahdnâme fut renouvelé en 1613, 1617, 1624 et 1652
(Dalleggio d’Alessio, 1940 ; Inalcık, 1991 : 18)1. Mais en 1682 la Porte refusa
d’accorder le berât *(brevet impérial) qui légitimait la Magnifica Comunità
(Mitler, 1979 : 73-74).
Pendant les premières décennies de la domination ottomane, la population
catholique, qui à l’époque génoise constituait la plus grande partie des habitants
de Galata (Pistarino, 1984 : 35), diminue considérablement. Le tahrîr defteri*
de 1478 y recense, à côté de 535 foyers musulmans, 332 foyers catholiques, 592
grecs orthodoxes et 32 arméniens (Inalcık, 1991 : 97). Vingt-cinq ans après la
conquête, les catholiques de Galata ne représentent plus que 22 % de la popu-
lation du faubourg, alors qu’en même temps nombre de musulmans s’y sont
installés (soit environ 35 % des foyers recensés).
Au fil du temps, Galata, qui depuis la fin du e siècle accueille aussi une
communauté juive, devient un secteur de plus en plus musulman, en particulier
dans ses parties proches de l’arsenal de Kasımpaa, de la Fonderie des canons
(Tophane) et de l’école des Acemioğlan de Galatasaray (Inalcık, 1991).
Après l’incendie de 1696, la population non musulmane, bien que toujours
majoritaire, se trouve concentrée soit dans les aires centrales du faubourg (les
catholiques dans le quartier de Bereketzade, les juifs à Karaköy, les Arméniens et
les Grecs aux alentours de l’église Saint-Benoît (Eldem, 1999 : 152)), soit dans les
proches environs de la citadelle. Les représentations diplomatiques – aussi bien
les ambassades inaugurées au cours du e siècle que celles qui étaient présentes
depuis plus longtemps, comme les Vénitiens – s’installent, quant à elles, à Péra2
(Beyoğlu), ensemble de collines surplombant Galata. Seuls les ambassadeurs
des Impériaux, du roi de Pologne et de la République de Raguse continuèrent
à loger de l’autre côté de la Corne d’Or.
1. Seul l’original en ottoman du renouvellement de 1613 a été retrouvé dans les archives d’État de
Gênes (cf. Storia Marittima dell’Italia, 1947 : 653 et Σakirofilu, 1983 : 223-224). Une copie du
renouvellement de 1624, conservée à Istanbul dans les archives de la Présidence du Conseil, a été
publiée en fac-similé par Σakirofilu, 1983 : 220-221. Il semblerait qu’il n’existe que des copies en
traduction italienne des renouvellements de 1617 et 1652 (Dalleggio d’Alessio, 1940).
2. Le toponyme Constantinople sera ici utilisé pour désigner les trois noyaux qui constituaient
l’ensemble de la ville : Stamboul, la ville ancienne ; Galata avec les quartiers proches des « Vigne di
Pera » (le Beyofilu des Ottomans), Tophane, BeÒiktaÒ ainsi que celui de l’arsenal impérial (Kasım
PaÒa) ; Üsküdar, sur la rive asiatique du Bosphore (dont il ne sera pas question dans cette étude).

Les catholiques à Constantinople. Galata et les églises de rite latin… / 229
REMMM 107-110, 227-243
Le passage progressif de Galata d’un faubourg génois à un secteur ottoman,
pluriethnique et habité par différents groupes ethnico-confessionnels, soulève
des interrogations sur la communauté latine3 : qui étaient ces catholiques qui
y résidait encore ? Quelle était leur visibilité dans la ville ? Quelles relations
entretenaient-ils avec les autres habitants, musulmans et non musulmans, ainsi
qu’avec le pouvoir ottoman ?
Analyser tous les aspects – complexes – de la présence des catholiques à
Constantinople dépasse le cadre de ce travail. Ici, seront simplement fournis
quelques éléments de réflexion afin de mieux appréhender le positionnement,
dans la société ottomane, des sujets du sultan de rite latin.
En premier lieu, en prenant appui sur des matériaux d’origine européenne4,
les pages qui suivent proposent un aperçu de cette population catholique au XVIIe
siècle5 ; dans une deuxième partie, est présentée, à travers une documentation
tant occidentale qu’ottomane6, le fonctionnement de la Magnifica Comunità,
institution représentant les zimmî* catholiques. Les églises et les rituels religieux
de ces derniers se trouvent au cœur de l’étude.
Les catholiques et leurs églises
Depuis la conquête ottomane jusqu’à la fin du e siècle, Galata perd pro-
gressivement son caractère de ville génoise et catholique : chrétiens orthodoxes,
Arméniens, musulmans ou juifs sont de plus en plus nombreux à s’y installer.
Pour autant, la population catholique de Constantinople non seulement ne
disparaît pas, mais – bien qu’en déclin – se voit enrichie de sang neuf. Ainsi,
lorsque Caffa, ancien comptoir génois, tombe entre les mains des Ottomans en
1475, sa population latine est déportée (sürgün*) vers Stamboul pour en peupler
un nouveau quartier (Veinstein, 1980 : 236-237). Au cours du e siècle, ce sera
le tour de Galata d’accueillir des familles catholiques originaires des îles égéen-
nes, dont la plupart, jusqu’à leur conquête par les Ottomans à partir de 1537,
étaient sous domination vénitienne ou génoise (Dalleggio d’Alessio : 310-311
et Sturdza, 1983 : 564-565).
3. « Latin » et « catholique » sont ici utilisés comme synonymes. Bien qu’ils correspondent en règle
générale à deux acceptions différentes (« latin », ethnique ; « catholique », confessionnel), dans le
cas de Galata, les deux termes se recouvraient.
4. Les sources occidentales consultées pour cet article sont les relations que les religieux catholiques
envoyés à Constantinople (missionnaires, visiteurs apostoliques et vicaires patriarcaux), adressaient
à leurs supérieurs à Rome. Dans le texte, le nom de l’auteur, suivi des dates de son passage à Galata,
sera en italiques afin de le distinguer des autres références bibliographiques citées.
5. Il s’agit plus particulièrement de la période allant de 1610, date du renouvellement des capitu-
lations accordées à la Magnifica Comunità, aux années 1680.
6. Outre les ‘ahdnâme, des hüccet délivrés par le cadi de Galata (conservés dans les archives de
l’église Saints-Pierre-et-Paul), ainsi que quelques documents, en ottoman et en italien, tirés des
archives de Venise (Venise, Archivio di Stato, Bailo a Costantinopoli).

230 / Elisabetta Borromeo

Les catholiques à Constantinople. Galata et les églises de rite latin… / 231
REMMM 107-110, 227-243
Dans les mêmes temps, Constantinople continue d’être une destination fré-
quentée par les Européens. Sous Mehmed II puis sous ses successeurs, d’autres
puissances occidentales, outre les Génois de Galata, concluent ou renouvellent
des traités avec les Ottomans (ahdnâme)7, renforçant ainsi la présence occidentale
dans ce faubourg de Constantinople et dans ses environs. Des catholiques en
provenance de l’Europe latine continuent alors à se rendre comme par le passé
dans la capitale ottomane, non seulement pour y commercer, mais aussi pour
mener des négociations avec les sultans et pour faire œuvre d’apostolat8.
D’après les relations que les missionnaires envoyés par le Saint-Siège écrivaient
à leurs supérieurs à Rome, au e siècle, il y avait dans la ville (y compris Galata
et Péra) environ 500-550 catholiques sujets ottomans, presque tous d’origine
italienne ; à ceux-ci s’ajoutaient les ressortissants des puissances étrangères9, les
esclaves et les esclaves affranchis (De Marchis, 1622 ; Mauri Della Fratta, 1629-
1631 ; Petricca da Sonnino, 1640). Ces estimations doivent toutefois être lues
avec prudence : il est bien connu que les auteurs de ces textes n’hésitaient pas à
puiser leurs informations dans les récits des observateurs européens qui, quant
à eux, se recopiaient souvent l’un l’autre. Ainsi, par exemple, si celles proposées
par le visiteur apostolique Pietro Cedulini en 1580-81 sont les mêmes que celles
fournies quelque soixante ans plus tard par le vicaire patriarcal Giovanni Mauri
Della Fratta, le nombre des catholiques étant beaucoup plus important dans
l’évaluation du premier parce qu’il inclut aussi 2 000 esclaves dans son décompte
(Cedulini, 1580-1581 et Mauri Della Fratta, 1629-1631).
Sur une population de 600 000 personnes pour l’ensemble de Constantinople
(Mantran, 1962 : 4710), ces catholiques zimmî correspondaient probablement
à environ 0,1 % des citadins et habitaient presque exclusivement Galata et ses
proches environs11. De l’autre côté de la Corne d’Or, à Stamboul, il existait,
vers 1630, seulement deux foyers constitués de descendants des Génois de Caffa
7. À l’exemple des Génois, les Vénitiens et les Polonais avaient noué des relations avec les Otto-
mans bien avant 1453 : les premiers depuis les années 1380, les seconds dès 1414. Un an à peine
après la conquête ottomane de la ville, Venise obtint du sultan de maintenir, comme à l’époque
byzantine, son baile à Constantinople. Quelques années plus tard, toujours à l’époque de Meh-
med II, les Florentins négocièrent aussi des Capitulations. Puis, au
e
siècle ce fut le tour de la
France (premiers pourparlers en 1535, ratification du traité en 1569) et des puissances protestantes
(l’Angleterre en 1582 et les Hollandais au début du
e
siècle, en 1612 (Mantran, 1962 : 511-
583 ; Goffman, 2002).
8. Un nombre de plus en plus élevé de missionnaires se rendit à Constantinople et plus généra-
lement dans l’Empire ottoman, notamment à partir des années 1620, lorsque l’Église catholique
organisa de façon de plus en plus rationnelle son réseau missionnaire avec la constitution, en 1622,
de la Congrégation de la « Propaganda Fide » (Metzler, 1970).
9. Les ambassadeurs et leur suite, les marchands et les voyageurs.
10. R. Mantran évalue entre 600 000 et 750 000 habitants la population de Constantinople vers
la fin du
e
siècle.
11. R. Mantran (1962 : 79) évalue la population du faubourg à environ 100 000 habitants. Il sem-
blerait toutefois que les catholiques aient été beaucoup moins nombreux (0,5 % de la population
contre 22 % en 1478, cf. ci-dessus).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%