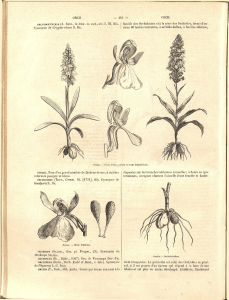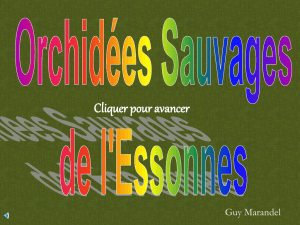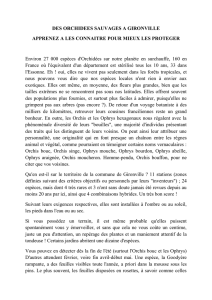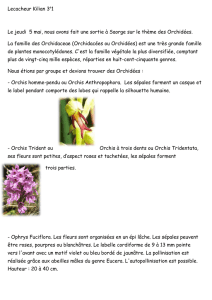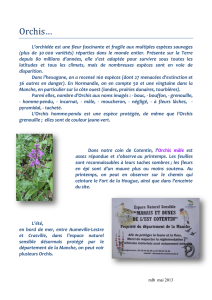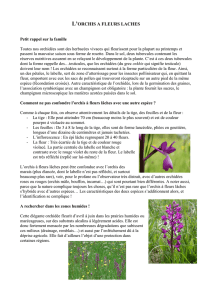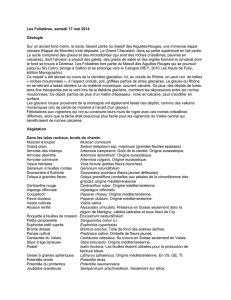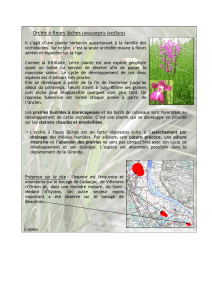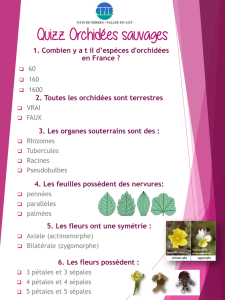Plantes Kabylie rd1_2


Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays
© Editions Ibis Press, 2006
ISBN : 2-910728-57-9
Ibis Press, 4 rue des Patriarches – 75005 Paris
Tél. : 01 43 71 28 87 – Fax : 01 43 71 22 85
Site internet : www.ibispress.com
Mail : contact@ibispress.com
Photo de couverture : Mahfoud Yanat

Mohand Aït Youssef
Plantes médicinales de Kabylie
Préface du docteur Jean-Philippe Brette
Ibis Press
Paris, 2006

Sommaire
Préface 5
Etude des espèces identifiées classées par ordre alphabétique 11
Liste des espèces non identifiées 333
Bibliographie 334
Glossaire des termes de botanique 339
Glossaire des termes médicaux 341
Liste des plantes citées 342
Liste des informateurs 349
Liste des abréviations 350

5
Préface
Des thérapeutes, des plantes et des esprits
L’ouvrage rend compte de l’usage des plantes médicinales en Kabylie et propose des éclairages scientifiques
sur ces pratiques traditionnelles. Cependant, ces utilisations thérapeutiques ne peuvent être entièrement
comprises si on ignore les contextes parfois magiques et religieux dans lesquels elles fonctionnent et si on
omet les praticiens qui en sont les acteurs. C’est pourquoi il nous a semblé opportun, en introduction, de
dire quelques mots sur les porteurs de ce savoir traditionnel et sur l’univers dans lequel la thérapie s’inscrit.
Acteurs de la thérapie traditionnelle
En étudiant les acteurs de la thérapie traditionnelle selon les services qu’ils rendent aux diverses commu-
nautés humaines de villes et de villages, de tribus et de confédérations, nous avons abouti à recenser cinq
catégories de tradipraticiens en Kabylie (valables probablement en d’autres régions arabophones et berbéro-
phones du Maghreb)1.La plupart de ces acteurs sont des thérapeutes de premier recours pour la population,
avant que celle-ci ne s’en remette (éventuellement) aux mains des «t’bîb», représentants officiels de la science
médicale et pharmaceutique.
El ‘attâr (l’herboriste; le pharmacien; le droguiste-herboriste). On le rencontre sur les marchés
hebdomadaires: il étale devant lui, sur ses nattes, toutes les drogues – végétales, animales, minérales – qu’il
estime nécessaires pour offrir un éventail complet des remèdes propres à guérir ses clients. Il propose des
dizaines de produits extraits du règne végétal (diverses parties séchées de plantes médicinales), ainsi que des
produits qui vont de la fleur de soufre au caméléon desséché. L’achat, qui est une véritable consultation,
avec établissement d’un diagnostic et choix entre plusieurs voies thérapeutiques possibles, s’apparente à une
véritable offre de services sur le plan sanitaire. Le consultant connaissant rarement à l’avance le traitement
dont il devrait bénéficier, el ‘attâr se doit d’être particulièrement expérimenté pour lui offrir les meilleures
chances de guérison… De plus, le patient sait qu’il peut retrouver chaque semaine son thérapeute au même
emplacement sur le marché du village.
L’injebaren (le rebouteux, le redresseur)
Il s’agit le plus souvent d’un homme qui s’apparente au rebouteux des régions rurales de pays présentant
d’autres traditions culturelles.
S’il appartient à une famille maraboutique, son don lui a été transmis par un de ses ascendants (directs
ou collatéraux) et sa lignée se doit dans tous les cas d’être exemplaire…
Il s’occupe des membres fracturés, des entorses graves, des articulations démises. Il peut remplacer le chi-
rurgien orthopédiste, être en mesure de redresser les fractures déplacées, de fabriquer des systèmes de con-
tention (immobilisation des membres fracturés), de poser des attèles… Il s’occupe exclusivement des maux
qui concernent l’appareil locomoteur. On dit de lui: «Sa main est un remède…» (N. Mohia, 1985).
1. Notre propos s’appuie sur les travaux de plusieurs auteurs qui ont recensé plusieurs types de tradipraticiens. N. Zerdoumi,
Enfants d’hier – L’éducation de l’enfant en milieu traditionnel algérien, Domaine maghrébin, Paris, 1970; F. Boiteux, Médecine tradi-
tionnelle de l’enfant kabyle, thèse de doctorat en médecine, Caen, 1976; J.-P. Brette Phytothérapie traditionnelle kabyle (...) Bilan de
quinze mois d’observations et d’études sur le terrain, thèse de doctorat en médecine, Paris, 1985.; N. Mohia, La Thérapeutique tradi-
tionnelle de la société kabyle, thèse de doctorat en médecine, Paris, 1985; L. Bedon, Contribution à l’étude phytochimique de quinze
plantes de Grande Kabylie, thèse de doctorat en pharmacie, 1996.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%