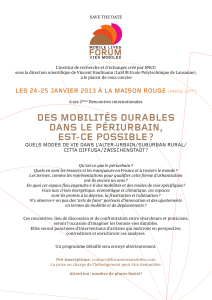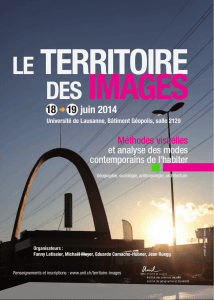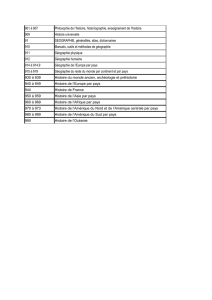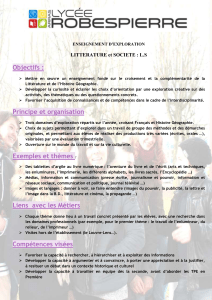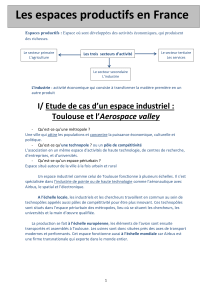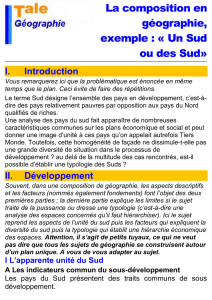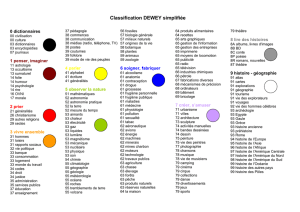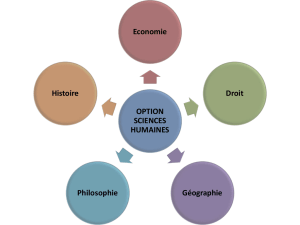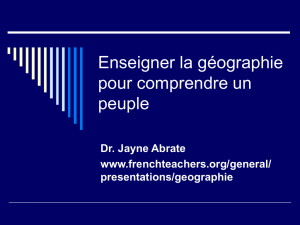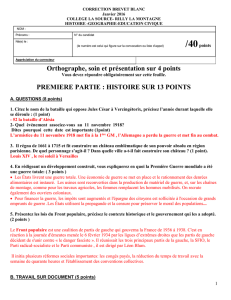"Le périurbain, formes et représentations", le 11 avril 2013

L’Association Régionale des Urbanistes Nord-Pas de Calais-Picardie,
présidée par Philippe DRUON,
est une association en Région du Conseil Français Des Urbanistes (CFDU),
présidé par Jean-Pierre MISPELON
Le CFDU rassemble l’ensemble des familles d’urbanistes
L’ensemble de nos activités
et des manifestations relatives à l’urbanisme
sur notre agenda :
https://sites.google.com/site/urbarunpp/agenda
Après ses universités d’été à Amiens sur le thème de la
« VILLE ABORDABLE»
Et la conférence de décembre sur la
«VILLE FRUGALE»
L’Association Régionale des Urbanistes
du Nord-Pas de Calais-Picardie
a le plaisir de vous inviter à
la conférence de
Arnaud BRENNETOT
« Le périurbain, formes
et représentations »
le jeudi 11 avril 2013 à 18h30
(Accueil à partir de 18h)
à la Maison de l’Architecture et de la Ville,

A partir de 18h00
Accueil
De 18h30 à 19h40
Arnaud BRENNETOT
Agrégé de géographie, après une carrière d’enseignant en Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles, il devient Maître de conférences en
géographie politique et aménagement à l’Université de Rouen. Il est
auteur d’une thèse portant sur la médiatisation du débat public territorial à
travers la presse magazine d’opinion en France (2009). Il s’intéresse en
particulier aux valeurs morales exprimées par les interlocuteurs du débat
public à l’égard des territoires qu’ils habitent. Il a ainsi publié plusieurs
articles de géographie politique portant sur les conceptions de la justice
spatiale développées dans diverses circonstances d’évaluation et
d’aménagement des territoires, aux échelles locale, régionale, nationale,
européenne et mondiale. Il travaille en particulier sur le discours des
médias, des responsables politiques, des aménageurs, des intellectuels,
des savants et des artistes. Outre sa participation à différents
programmes de recherche régionale financés par le Grand Réseau de
Recherche du Conseil régional de Haute-Normandie portant sur les
images de la Normandie, l’Axe Seine et le Grand Paris, il a également
animé le site de débat participatif Normandie 2010 porté par l’UMR CNRS
IDEES (2009-2010) et vient de lancer le site collaboratif de vulgarisation
pédagogique Terra Cognita (2011-2012). Il a également participé au
projet Eurobroadmap labellisé par le FP7 de la Commission européenne,
au cours duquel il a eu l’occasion de travailler sur des supports variés
(enquêtes individuelles, corpus de manuels scolaires), afin de dégager la
variété des visions et des perceptions de l’Europe dans le Monde. Ses
travaux actuels portent sur la géo éthique des néolibéralismes.
Liste des publications
BRENNETOT A., (2011), « Les Géographes et la justice spatiale. Généalogie
d’une relation compliquée », Annales de Géographie, n° 2, p. 115-134.
BRENNETOT A. (2010) « Pour une géoéthique. Éléments pour une
analyse des conceptions de la justice spatiale », L’Espace géographique,
n° 1, 2010, p.75-88.
BRENNETOT A. (2010) « La gouvernance parisienne, un objet de débat
public ? Médiatisation et enjeux géoéthiques autour du Grand Paris »,
L’Espace politique, n° 10, 2010, 19 p.
BILLARD G., BRENNETOT A. (2010). « Le périurbain a-t-il mauvaise
presse ? Analyse géoéthique du discours médiatique à l’égard de
l’espace périurbain en France », Articulo, revue de sciences humaines, n°
5, 2010, 19 p.
BRENNETOT A. (2009) Géoéthique du territoire. Le débat public
territorial à travers la presse magazine d’opinion en France. Rouen:
Université de Rouen, thèse de doctorat en géographie, 1009 p.
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00592087/en/
BRENNETOT A. (2008), « Optimum territorial et théories de la justice »,
Géopoint, 17ème biennale de Géographie, 5-6 juin 2008, Optimisation de
l’espace géographique et satisfactions sociétales », Université d’Avignon,
8 p.
A partir de 20h00
Information sur les actions 2013 autour d’un pot
convivial offert par l’ARUNPP
« Le périurbain,
formes et origines d’un anathème géographique »
Par Arnaud BRENNETOT
En France, le périurbain est resté longtemps une catégorie mal
identifiée dans le débat public. Autrefois assimilée à la
« rurbanisation », symbole d'une réconciliation possible de la ville et
de la campagne, le périurbain mais devenu, de plus en plus, le signe
inquiétant d'un dysfonctionnement des villes contemporaines. Les
reproches sont connus : le périurbain est ainsi accusé de provoquer
le mitage des campagnes, l'allongement inconsidéré de
déplacements automobiles énergivores, d'entraîner la privatisation
galopante des franges urbaines, la prolifération de paysages
monotones, le repli sur la sphère domestique, l'exacerbation du
conservatisme politique, etc. Ce discours anti périurbain est
aujourd'hui généralisé : intellectuels, savants, artiste mais
également responsables politiques et techniciens de l'aménagement
et de l'urbanisme se plaisent ainsi à vilipender les tares attribuées
au périurbain.
Cette vision péjorative puise autant dans l’observation des
mutations urbaines que dans l'angoisse plus profonde d'une
moyennisation des sociétés contemporaines. Cette hantise du
nivellement et de la standardisation n'est pas propre à la France et
on en trouve des traces, dès les années 1960, ailleurs en Europe ou
aux États-Unis. Depuis cette période, la disqualification esthétique,
morale et politique des espaces périurbains ou suburbains s'est
imposée comme un stéréotype incontournable devenu, pour
beaucoup, indépassable. Une telle banalisation contient alors le
risque d'enfermer le discours sur le périurbain dans le registre de la
caricature sociale, à l'image de ce qui se produisit autrefois à propos
des grands ensembles et d’empêcher l’opinion publique de saisir ce
qui, dans la vie pavillonnaire, est aujourd'hui susceptible de
représenter des opportunités stimulantes ou des potentialités
encourageantes.
1
/
2
100%