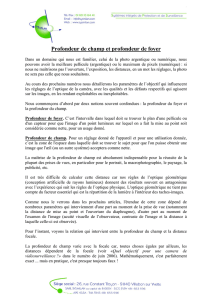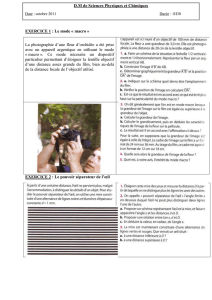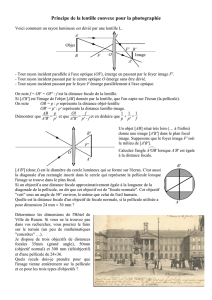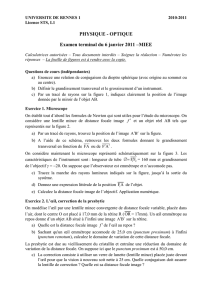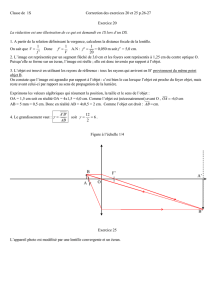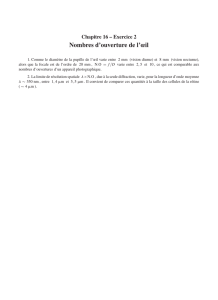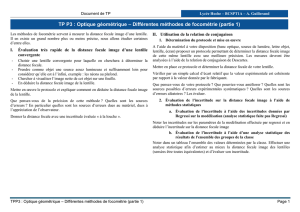La Distance focale

La Distance focale
Les distances focales, respectivement objet et image, d'un système optique centré convergent ou divergent sont, par
définition, les distances algébriques séparant respectivement le plan principal objet H du foyer objet F et le plan
principal image H′ du foyer image F′. Elles sont souvent notées respectivement ƒ et ƒ′.
Dans le cas d'un système mince, par exemple une lentille mince, les plans principaux peuvent être confondus avec le
centre optique de la lentille et dans ce cas la distance focale image est facilement définie par la distance algébrique
séparant le centre optique de la lentille mince du foyer image.
Dans tous les cas les distances focales font partie des éléments cardinaux d'un système, c'est-à-dire d'un ensemble de
grandeurs qui permettent une définition complète du système et une numérisation facile du calcul, notamment en
optique matricielle.
Propriétés
Pour les systèmes optiques dont les milieux d'entrée et de sortie sont identiques, les distances focales deviennent
égales en valeur absolue. C'est le cas très classique d'une lentille plongée dans l'air pour laquelle H'F' = − HF = f' = −
f.
On comprend facilement cette propriété à partir d'une autre définition possible des distances focales, à partir de la
vergence V d'un système. Si on appelle n et n' les indices d'entrée et de sortie du système :
et
Pour les systèmes plongés dans l'air (par exemple en photographie) on retrouve donc également la propriété suivante :
la distance focale image est l'inverse de la vergence :
La notion de convergence et de divergence s'en trouve également explicitée : on appellera convergent un système
optique dont la distance focale image est positive et divergent un système dont la distance focale image est négative.
Une lentille convergente a une distance focale positive et une lentille divergente une distance focale négative. En
photographie, les objectifs sont des systèmes convergents ainsi que les bonnettes d'approche. Les doubleurs de focale
qu'on intercale entre l'objectif et le film ou (le capteur) sont des systèmes afocaux.

Calcul et mesure
Il est toujours possible de calculer les distances focales à partir des données géométriques et des indices d'un système
(courbure, indice de réfraction) puisqu'elles sont reliées à la vergence. Néanmoins quand ces données viennent à
manquer une mesure expérimentale est possible.
Les mesures expérimentales, pour les systèmes minces tels les lentilles minces, reposent généralement sur la
détermination des positions des foyers objet et image. On rappelle que le foyer image est le point vers lequel
convergent après le système des rayons qui sont parallèles à l'axe optique avant le système. À l'inverse, des rayons
passant par le foyer objet ressortent parallèles à l'axe optique. Les rayons ne passent pas nécessairement
physiquement par le foyer, il peut s'agir de leur prolongation.
On peut en avoir l'illustration dans quelques cas simples :
•
lentille optique ;
•
miroir courbe.
On peut aussi la mesurer expérimentalement de plusieurs façons :
•
En la mesurant directement entre la lentille et l'image nette d'un objet suffisamment lointain pour être
considéré comme à l'infini (soleil, étoiles ou paysage à l'horizon).
•
Avec la méthode dite de Silbermann : quand la lentille est placée de telle façon que l'image sur un écran
(image réelle) a la même taille que l'objet alors la distance entre l'image et l'objet vaut quatre fois la distance
focale.
•
Par la méthode d'autocollimation (pour les lentilles convergentes seulement) : après avoir accolé un miroir
plan à une lentille, il suffit de rechercher la position de la lentille pour laquelle objet et image se superposent
parfaitement. La distance entre l'objet et la lentille est alors la distance focale de cette lentille.
Photographie
La surface sensible (la pellicule dans le cas de la photographie argentique, le capteur dans le cas de la photographie
numérique) est dans le plan de convergence des rayons issus de l'objet à photographier (voir les articles Mise au point
et Profondeur de champ). Dans le cas d'un objet « à l'infini » (c'est-à-dire, pour fixer les idées, situé à plus d'une
vingtaine de mètres, avec un appareil 24x36 et une optique courante), la surface sensible est dans le plan focal ; sa
distance avec le plan principal image H' de l'objectif est alors la distance focale. Voir aussi l'article Point nodal.
Une variation de la distance focale induit deux effets concrets sur l'image vue à travers l'objectif :
« Grandissement de l'objet »
Avec le format classique 24×36, par exemple, la focale dite "normale", naturelle ou moyenne est environ de 43 mm
(c'est la diagonale de l'image 24×36 mm) : avec cette focale, il est d'usage de dire que l'image est perçue à travers
l'objectif selon le même angle de champ que la vision humaine.

- La vision est un système à focalisation mentale variable : angle d’attention (lecture, examen d’un détail) sur 1° ;
angle d’observation sur 60° ; angle de perception sur 180°.
En réalité cette affirmation doit être nuancée sur plusieurs plans. En effet la vision humaine ne procède pas de la
même façon que l'enregistrement d'une image derrière un objectif de focale fixe donnée : l'œil a un champ de vision
de grande netteté ou angle d'attention (lecture, examen d'un détail) de l'ordre de 1 à 5 degrés, c'est-à-dire le champ
qu'enregistrerait une longue focale de 500 mm environ. Au-delà de ces 5 degrés, l'œil perçoit moins bien les fins
détails. L'œil balaye le champ sans arrêt, l'impression visuelle résulte donc de la comparaison permanente de
différents champs vers lesquels l'œil se tourne. Néanmoins, on parle d'angle d'observation, qui couvre environ 60°
dans le plan horizontal. C'est cet angle qui sert de référence pour la focale "normale" pour le format considéré.
D'autre part, l'œil a une sensibilité aux mouvements et à la lumière qui atteint presque les 180°, que décrit l'angle de
"perception".
Un autre point important c'est la façon dont les viseurs sont réglés. Par exemple il est courant que les viseurs des
appareils reflex 24×36 soient réglés pour que la focale de 35 mm donne un grossissement optique identique à ce que
l'œil nu verrait ; le 50 mm est donc affecté, à travers le viseur de ces appareils, d'un facteur de grossissement de 50/35
= 1,4.
Dans les appareils non reflex à télémètre, selon le modèle, le viseur peut être construit ou réglé à différentes valeurs
de grossissement entre 0,5 et 1,25 (avec une lentille additionnelle) ; grâce à des cadres-repères dans le viseur, ce qui
est vu dans le viseur est relié avec ce que les objectifs de différentes focales enregistreront sur la surface de 24×36
mm.
Il est clair que les vues prises aux très grands angles ou aux très longues focales ont quelque chose de « non-naturel »,
il est donc légitime de chercher à placer entre les deux une focale normale ou naturelle. La notion de « focale
normale » couvrant un angle de 53° (diagonale = focale), sans exclure totalement des raisons d'optique physiologique,
doit peut-être sans doute plus à l'histoire de la technique photographique. On peut en effet évoquer le poids historique
des optiques de type triplet et tessar qui couvrent, justement, cet angle avec une bonne qualité d'images pour un
encombrement et un prix réduits, formules optiques qui ont dominé le marché pendant presque un siècle.
Ci-dessous, un même objet photographié à travers diverses focales depuis un même point (le photographe ne se
déplace pas)
28 mm
50 mm 70 mm
210 mm
Déformation apparente de l'environnement
Une focale courte comme le 28 mm, aussi appelé grand angle, déforme apparemment la perspective et a un angle de
vision plus important que celui de l'œil humain. Là encore il faut nuancer compte tenu des remarques faites ci-dessus
sur le champ de vision de l'œil, mais il n'est pas possible à l'œil d'embrasser le champ total de 75° d'un 28 mm en
24×36 sans balayer le champ par un réflexe naturel de rotation du globe oculaire. L'image enregistrée sur le film en
une seule fois sous 75° est donc très différente de l'impression visuelle.
Une focale longue comme le 200 mm (téléobjectif) rapproche les plans et « aplatit » le fond du sujet.

Un point important est celui du rendu de perspective. Le rendu de perspective tel qu'il est vu par l'œil ou l'appareil
photo ne dépend que du point de vue où on se place. D'un même point de vue, une longue focale ou un grand
angulaire donneront le même rendu de perspective, et ceci quel que soit le type d'appareil ou de format utilisé. Un
agrandissement de la portion centrale de l'image prise au 28 mm est exactement identique dans sa perspective à
l'image prise avec une longue focale. Il n'est pas possible de changer le rendu de perspective sans changer de point de
vue. Un zoom ne fait que recadrer une image à la prise de vue, ce qui est un atout considérable, mais ne peut pas
changer le rendu de perspective.
Il convient également de distinguer la notion de téléobjectif de la notion de longue focale. Une longue focale
photographique est par convention toute focale plus longue que la diagonale du format. Parmi les formules optiques
utilisées, les téléobjectifs sont des longues focales qui ont l'avantage d'un encombrement mécanique plus court que
leur distance focale. Ils sont très prisés sur les reflex petit format, mais on peut parfaitement utiliser comme longue
focale d'autres formules que les téléobjectifs, par exemple des objectifs de lunette astronomique qui devront être
placés à peu près à une distance focale en avant du film, c'est-à-dire que le longueur de tube dans ce cas doit être au
moins aussi longue que la focale pour pouvoir mettre au point sur l'infini.
28 mm 35 mm 50 mm 70 mm
135 mm 270 mm
Effet des focales de 28 (courte), 35, 50 (moyenne), 70, 135 et 270 mm (longues) sur l'environnement : le photographe
se déplace de façon à ce que l'objet ait toujours la même taille sur la photo. De ce fait, le point de vue change donc le
rendu de perspective change tout en conservant la même dimension à l'objet central.
Autre exemple :
50 mm (focale moyenne)
17 mm (focale ultra-courte)
Les objectifs de type zoom ont une focale variable.
Voir l'article détaillé Déformation de perspective liée à la distance focale.
Angle de champ
Une longue focale (téléobjectif) correspond à un petit angle de prise de vue alors qu'une focale courte (grand angle),
comme son nom l'indique, a un angle de prise de vue beaucoup plus grand.

Projection cinématographique
Relation entre la hauteur h du photogramme (film sur la gauche), la distance focale ƒ de l'objectif (au centre), la
hauteur H de l'écran (à droite) et le distance de projection D
Sur la pellicule, la largeur du photogramme est constante (18 mm), mais à la projection, c'est la hauteur qui est
constante (hauteur de l'écran) ; on utilise donc des objectifs avec différentes focales ; pour le format 2,35:1
(Cinémascope), on utilise de plus une anamorphose
En projection cinématographique, l'écran est situé « à l'infini » et la pellicule est donc dans le plan focal. La distance
focale ƒ est adaptée afin que la hauteur de l'image projetée soit la hauteur de l'écran. La focale à utiliser se calcule
facilement en fonction :
•
de la hauteur de l'image sur la pellicule (voir Format de projection), h ;
•
la hauteur de l'écran, H ;
•
la distance projecteur-écran, D.
Il s'agit d'une simple loi proportionnelle (théorème de Thalès) :
H/h = (D-ƒ)/ƒ ≃ D/ƒ
puisque ƒ << D.
On utilise un cache pour tronquer la fenêtre de projection :
•
en général, il y a une bande noire qui remplit ce rôle, mais elle n'est pas totalement opaque d'une part (pour la
puissance de la lanterne), et d'autre part, comme le reste de la pellicule, elle peut être endommagée et laisser
passer de la lumière ;
•
certains films contiennent une image plus grande que celle projetée (l'image impresionnée lors de la prise de
vue est plus haute que le cadre), donc pas de bande noire.
Dans le cas du Cinémascope (rapport largeur sur hauteur de 2,35), on utilise une anamorphose : un complément
optique afocal placé devant l'objectif de prise de vue ou parfois dans le système de tirage des copies comprime
l'image dans le sens de la largeur sur la pellicule ; ce même dispositif est utilisé devant l'objectif de projection pour
restituer, sur l'écran, une image remise à sa bonne largeur. Le plus connu de ces dispositifs est l'Hypergonar du
professeur Chrétien mais il en existe d'autres ; tous comportent des associations de « lentilles » cylindriques.
1
/
5
100%