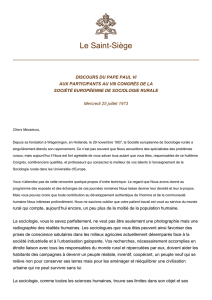Au sujet de l`historicité du regard scientifique

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
439
Au sujet de l’historicité du regard scientifique
On the historicity of the scientific outlook
Barthez Alice
INRA CESAER
26, Bd Dr Petitjean, B.P.87999, 21079 Dijon Cedex
alice.barthez @enesad.inra.fr
Résumé
S’intéresser à l’historicité de la science prémunit contre une vision
intemporelle et purement intellectuelle de la production scientifique. La
mise en lumière des rapports de forces et des conflits internes, pour le
monopole de l’autorité scientifique mais aussi des luttes entre réseaux au-
delà de l’institution, informe sur la réalisation du produit social qu’est la
« vérité scientifique ». Le cas de la Sociologie à l’INRA, au départ issue de
l’Economie Rurale et instituées ensemble dans la même unité, est
exemplaire de l’importance du lieu social d’où s’exerce le travail scientifique
pour comprendre la nature et les contenus de la production ainsi que les
transformations de la discipline elle-même.
Mots-clés : Science, sociologie, sociologie rurale, économie rurale, histoire
Abstract
An interest in the historicity of science precludes any timeless and purely
intellectual vision of scientific production. Examination of the balance of
power and intestine struggles for the monopoly of scientific authority but
also conflicts among networks extending beyond the institution are
informative about how ‘scientific truth’ as a social product is made. The
case of Sociology at the INRA, initially derived from the Rural Economics
and instituted together in the same unit, is a prime example of the
importance of the social locus where scientific work is conducted to our
understanding of the nature and contents of the output and of the
transformations in the discipline itself.
Key-words: Science, sociology, rural sociology, rural economics, history
Introduction
« Sociologue à l’INRA ? Ca n’existe pas ! Il y a des sociologues au CNRS mais pas à
l’INRA ! A l’Institut National de la Recherche Agronomique, on fait des recherches sur les
plantes, les animaux, mais pas sur les gens !» Cette remarque plusieurs fois répétée dès que

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
440
j’invoquais mon parcours, mettait une ombre à mon enthousiasme premier d’accéder enfin
à l’activité scientifique avec l’ascension sociale comme perspective. Se dire sociologue à
l’INRA dans les années 1970, n’était pas très crédible, comme si je n’étais pas dans la
« vraie » recherche.
Si l’on admet que : « L’univers « pur » de la science la plus « pure » est un champ social
comme un autre, avec ses rapports de forces et ses monopoles, ses luttes et ses stratégies,
ses intérêts et ses profits, mais où tous ces invariants revêtent des formes spécifiques »
(Bourdieu, 1976, p. 89), il est moins important de se préoccuper de la subjectivité de ses
agents que d’analyser ce qui se joue et comment on joue ? Pour cela, il ne suffit pas de s’en
tenir à la norme juridique ou administrative qui organise le champ mais à ces formes de
régularité qui vont parfois à l’encontre le la règle officielle tout en étant régulières. Enfin,
pour repérer les invariants propres au champ scientifique et en particulier à la recherche
agronomique (pourquoi ce terme, agronomique, pour aborder la sociologie), un travail
historique est nécessaire. De plus, appartenir à un collectif de recherche, comme toute
appartenance à un groupe, se négocie, parfois se marchande. Mais parce qu’il s’agit de
science, quels sont les termes du marché d’où s’organise la négociation ?
Il me faut remonter à une époque très antérieure à mon entrée à l’INRA, à la naissance de
l’institution et aux circonstances de sa création pour pouvoir prétendre à une certaine
objectivité. Sachant que le parti pris de l’objectivité est le seul capable de révéler quelque
chose de la trajectoire personnelle, il peut être difficile de rompre avec « l’illusion
biographique » pour découvrir une autre version de la réalité que celle que l’on s’est forgée
au fil de sa vie (Bourdieu, 1994). Le travail de recherche m’est apparu tout à coup colossal.
Je n’ai pu dépasser jusque là que les préliminaires en indiquant quelques pistes.
Dans quelles circonstances a été créé l’INRA1 ? A partir de quelles relations avec les
acteurs internes du champ scientifique ? Dans quelles relations avec les acteurs externes
influant sur la définition de la recherche scientifique ? Pour quelle place ?
1. Les débuts de la recherche agronomique en tant
que service à la disposition des agriculteurs
C’est avec l’utilisation des engrais au milieu du XIXème siècle que se créent les premiers
laboratoires de recherche destinés à l’agriculture comme une fonction de contrôle liée à la
répression des fraudes. Au départ, « la station agronomique » fonctionne comme un
laboratoire d’analyses. En 1878, on en compte en France 28, 82 en 1900. Peu à peu, les
directeurs de ces laboratoires investis du double titre de « chimistes » et « d’agronomes »
étudient la nature des sols et certains problèmes de nutrition végétale. En 1883, paraît leur
publication : Les Annales de la science agronomique française et étrangère devenant à
partir de 1930, « Les Annales Agronomiques ».
Ces stations ou laboratoires sont organisés par l’Etat, les départements ou les municipalités
avec une double mission : effectuer des recherches mais aussi éclairer les cultivateurs sur la
1 Pour cette partie historique j’ai amplement puisé dans l’ouvrage de Jean Cranney, (1996) chef du
Département d’Economie et Sociologie Rurales de 1984 à 1990.

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
441
composition de leurs terres et les protéger contre les fraudes notamment en matière
d’engrais, de semences. A l’issue de la guerre de 1914-18, la recherche
scientifique s’organise et se trouve répartie en 3 offices créés au niveau national dont
l’Institut des Recherches Agronomiques (IRA) intégré au ministère de l’agriculture comme
un « un office chargé de développer des recherches scientifiques appliquées à
l’agriculture » -art. 79 de la loi de finance, 30/04/1921- (Cranney, 1996, p. 31).
L’IRA est plus particulièrement rattaché à la Direction des Affaires sanitaires et
scientifiques et de la Répression des fraudes et son siège est fixé à Paris dans les locaux de
la Répression des fraudes. Les stations disséminées en France sont regroupées de manière à
n’avoir que des stations régionales bien équipées. Albert Demolon2 est nommé directeur de
l’IRA en 1928. En raison de son capital universitaire en plus de sa formation agronomique,
il se montre précurseur de l’introduction de la méthode scientifique dans les laboratoires
cherchant à élever la recherche agronomique au rang de recherche scientifique. Ainsi,
affirme-t-il : « l’agriculture est une véritable industrie biologique qui ne triomphera dans
la lutte pour son existence que si elle sait mettre à son service les immenses ressources de
la science… Il n’y a pas de savoir scientifique sans théorie, et pas de théorie sans
recherche désintéressée. » (Cranney, 1996, p. 51)
En 1934, la France est touchée par la crise économique et L’IRA disloqué. Les stations sont
rattachées selon leur spécialité à différentes directions du ministère de l’agriculture.
2. La lutte pour le monopole de l’autorité scientifique
En 1936, le gouvernement de Front Populaire tente de créer une structure interministérielle
pour la Recherche et sous le gouvernement Léon Blum apparaît un sous-secrétariat d’Etat à
la Recherche avec à sa tête Irène Joliot-Curie et puis le physicien, Jean Perrin.
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) est institué en 1939 (décret du
10/10/39) chargé de la coordination de la recherche française et en 1940, il obtient
qu’aucun centre de recherches ne puisse voir le jour sans son autorisation. La IIIème
République balayée laisse la place au gouvernement de Vichy. Avec la nécessité d’accroître
la production agricole en situation de guerre, le ministère de l’agriculture se préoccupe de
reconstruire la recherche agronomique. Laval parvenu au gouvernement, la recherche est
maintenue éclatée entre plusieurs ministères échappant au contrôle du CNRS. En 1943, Le
ministère de l’agriculture rassemble pour la première fois la recherche et l’expérimentation
2 A. Demolon : 1er initiateur des recherches effectuées en agronomie depuis le début du siècle.
Ingénieur agronome en 1901, il complète sa formation par des études universitaires : une licence ès-
sciences physiques puis en 1909 une thèse de doctorat en microbiologie des sols à la faculté des
sciences de Paris tout en exerçant son activité de recherche à la station agronomique de Laon. Un
incendie dû à la guerre 1914-18 le conduit à reprendre de nouvelles recherches sur les propriétés
physico-chimiques des sols et il obtient un second doctorat universitaire en sciences physiques en
1927. Il s’engage dans de nombreux contacts internationaux, épouse une géorgienne. Il devient
président de l’Association Internationale de la science du sol et membre de l’Académie des
Sciences en 1946.

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
442
sous l’autorité unique de la direction de l’enseignement3 et la nomination de son directeur,
Charles Crépin, soulève une vive réprobation des scientifiques du CNRS et d’une partie des
chercheurs agronomes qui se trouvent le plus directement liés par leur formation et leur
activité au CNRS et à l’université.
L’avènement de l’INRA se prépare sur un fonds d’opposition entre deux conceptions de la
recherche agronomique représentés par les deux prétendants à la direction de l’institut.
A la différence d’Albert Demolon qui jouit d’une grande notoriété dans le champ de la
science, Charles Crépin est remarqué dans les sphères administratives et gouvernementales
par ses engagements politiques et sa participation au développement du secteur agricole par
des recherches immédiatement utilitaires4. Sa nomination comme directeur du Service de la
recherche agronomique et de l’expérimentation en 1943 crée la déception de l’autre camp à
travers Demolon qui s’attendait à obtenir le poste soutenu par ses homologues
universitaires.
Tandis qu’au ministère de l’agriculture, Charles Crépin cherche à réorganiser la recherche
agronomique, le CNRS est chargé (par une ordonnance du gouvernement provisoire du
2 nov 1945) de « développer, orienter et coordonner toute la science française. » Il est
également chargé d’organiser un enseignement préparatoire à la recherche comprenant un
enseignement théorique, des travaux dans des laboratoires variés et à l’étranger. Ainsi est-il
appelé à jouer le rôle d’un centre national de formation des chercheurs.
Le ministère de l’Education Nationale par l’intermédiaire de ses scientifiques, s’érige
contre le projet Crépin défendu par le ministère de l’agriculture, visant à créer un institut de
la recherche agronomique totalement indépendant. Cette question de l’indépendance est
remise en cause : la recherche agronomique est-elle tellement spécifique qu’il faille en faire
un institut particulier ? Ou bien participe-t-elle avant tout de la recherche scientifique
auquel cas il n’y a pas lieu de la distinguer du CNRS reconnu en France comme
représentant le champ de la science ?
Les tenants de l’une et l’autre position s’affrontent, les partisans d’une recherche
agronomique autonome étant les administrateurs de l’agriculture et une partie des
chercheurs à l’image de Crépin, ingénieurs agronomes et participant à l’organisation
professionnelle de l’agriculture, tandis que de l’autre, se trouvent l’administration de
l’Education Nationale, le CNRS et ceux des chercheurs agronomes les plus reconnus pour
leur capital scientifique.
3 Jusque là, l’expérimentation des techniques agricoles mises au point par les stations et les
laboratoires du ministère avait été laissée à l’initiative des chaires professorales d’agriculture
(devenue en 1912 les Directions des Services Agricoles).
4 Crépin qui deviendra le premier directeur de l’INRA en 1946, est le fils d’un petit agriculteur du
Pas-de-Calais. Après son certificat d’études, il fréquente une école d’agriculture et réussit son
concours d’entrée à l’Ecole nationale d’agriculture de Grignon. Il y fait sa première année et puis
s’engage à 20 ans comme combattant volontaire à la guerre de 1914-18 et en revient blessé en 1916.
Il termine ses études à l’Ecole de Grignon et obtient une licence ès-sciences à la Sorbonne. Ses
préoccupations l’orientent vers l’organisation de la recherche agronomique au ministère de
l’agriculture. Sa participation à l’IRA en 1923 le conduit à fonder deux centres de recherches à
Clermont-Ferrand et à Dijon. Son activité scientifique à la station d’Epoisses à Dijon aboutit à la
création d’une nouvelle variété de blé : Etoile-de-Choisy.

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
443
En définitive, c’est la conception de Charles Crépin qui sera retenue avec le soutien du
ministre de l’agriculture de l’époque : Tanguy-Prigent qui n’est pas un scientifique mais un
agriculteur breton très tôt engagé dans la défense paysanne et le mouvement coopératif
agricole, mais aussi dans la politique. Il devient maire de son village, conseiller général et
puis député à 27 ans. Affirmant son hostilité au Régime de Vichy, il participe activement
au Mouvement de la Résistance et arrive au gouvernement provisoire en septembre 1944
appelé par de Gaulle pour être ministre de l’agriculture. Il y restera jusqu’en octobre 1947.
Outre la création de l’INRA, il fait voter un ensemble de lois en faveur des fermiers et des
métayers cherchant à réduire le pouvoir des hobereaux. Ainsi est-il particulièrement disposé
à mettre son pouvoir au service d’une recherche avant tout soucieuse du développement de
l’agriculture en période de pénurie alimentaire.
3. L’autonomie de l’INRA au prix de sa dévaluation
dans le champ scientifique
Les intérêts du champ politique se sont imposés au champ scientifique. La loi créant
l’INRA est promulguée le 18 mai 1946 après n’avoir rencontré aucune opposition à
l’Assemblée. L’exposé des motifs et le texte de loi sont ceux élaborés en 1944 sans tenir
aucun compte de l’avis des scientifiques qui pendant plus d’un an et demi ont cherché à
intervenir dans le projet. Ces derniers expriment publiquement leur réprobation de deux
manières :
- par une critique sévère du texte de loi, notamment au niveau du choix de son directeur qui
se trouve « limité aux seules personnalités scientifiques relevant de l’administration de
l’Agriculture » alors qu’il « doit avoir une autorité scientifique incontestable ». Ils
critiquent aussi l’organisation des centres et déplorent que la formation des jeunes
chercheurs soit à peine évoquée.
- en excluant l’INRA du champ scientifique. Désormais, le CNRS affirme une volonté
délibérée de ne jamais citer l’INRA et de ne jamais nommer un des chercheurs de
l’institution à son comité national à moins qu’il ne participe à l’enseignement universitaire
ou à une unité mixte.
A cela, le ministre de l’agriculture répond que la loi est bien celle qu’il a voulue. Tandis
que la recherche agronomique trouvait jusque là ses moyens matériels en grande partie
auprès d’organismes agricoles, dès l’institution de l’INRA, la contribution de l’Etat
s’accroît très fortement5.
En prenant appui sur les organisations professionnelles pour légitimer son autonomie,
l’INRA s’est éloigné des critères de référence qui fondent la science. Si le CNRS détient la
possibilité de ne pas citer l’INRA comme institut de recherche scientifique, l’inverse n’est
pas crédible. Pourtant comme l’évoque J. Cranney, « l’INRA n’est pas considéré comme un
organisme de développement : on ne lui confie officiellement aucun outil d’analyse pour les
contrôles ni aucun outil de gestion comme les statistiques et les études.» (Cranney, 1996,
5 Le nombre d’agents passe de 257 (dont 157 scientifiques) en 1946, juste avant la création de l’INRA
à 669 (dont 257 scientifiques) aussitôt après sa création. Les crédits de fonctionnement doublent et
ceux affectés à l’équipement sont multipliés par 7.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%