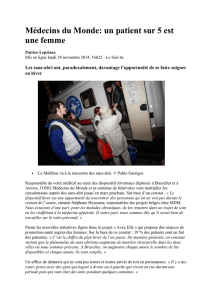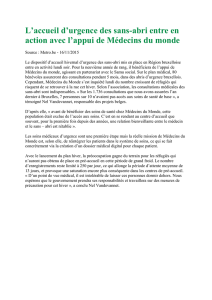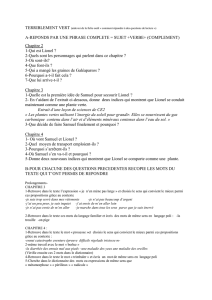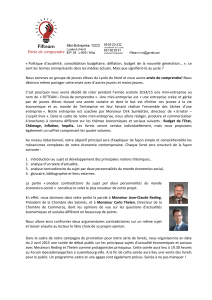changer la donne sociale

CHANGER
LA DONNE SOCIALE
MIEUX COMPRENDRE LES PERSONNES EN GRANDE
PRECARITE AFIN DE LEUR DONNER
NON PAS UNE LIBERTE FORMELLE
MAIS UNE LIBERTE REELLE DE CHOIX DE VIE
Lionel Thelen
Docteur en Sciences Politiques et Sociales –
Chercheur associé à Etopia & Chercheur associé au Centre d’études
sociologiques des Facultés universitaires Saint-Louis.
Décembre 2007

« Changeons la donne sociale » – etopia – Lionel Thelen 2007
-2-
« Changer la donne sociale » :
Mieux comprendre les personnes en grande précarité afin de leur donner non pas
une liberté
formelle
mais bien une liberté
réelle
de choix de vie
Lionel Thelen♣
Résumé
Cet article découle d’un séminaire Etopia intitulé : « Sensibiliser les publics précarisés aux
problématiques de l'écologie politique et/ou sensibiliser les mandataires et militants ECOLO aux
singularités des publics précarisés...? » ayant eu lieu en novembre 2007.
L’exorde de ce séminaire était la suivante :
« Les personnes précarisées se sentent souvent moins concernées par les problématiques environnementales,
parce qu'elles ont d'autres urgences et parce qu'elles considèrent que c'est à ceux qui consomment le plus de
prendre leurs responsabilités. Une fatalité ?
Dans l'autre sens, le parti ECOLO recrute peu de membres parmi cette catégorie de la population, qui a
par conséquent du mal à y faire entendre ses spécificités. Comment l'écologie politique et les personnes
précaires peuvent-elles se rencontrer et se comprendre? »
Deux thématiques pour une seule intervention donc. Nous essaierons, en ces lignes, de nous
centrer sur la première sachant que la seconde doit faire l’objet d’un débat soutenu au sein de
forums réunis à cet effet.
Cet article visera donc à expliciter plus avant les singularités inhérentes à la vie en grande
précarité afin de donner les outils à tout un chacun pour appréhender une réalité plurielle et
d’autant plus complexe que la plupart d’entre nous proviennent de couches de la population
relativement préservées des traits repris ci-après. Il doit être évident aux yeux de tous que
chaque individu plongé dans la grande précarité est unique et que les singularités en question
ne sont que les plus petits communs dénominateurs d’une galaxie de situations intrinsèquement
différentes les unes des autres.
A partir des singularités mises au jour, il sera montré que les politiques sociales actuelles se
révèlent inadaptées à prendre en compte les demandes et besoins émanant des membres les
plus fragilisés du corps social. Pour combattre cette tendance, il s’agit avant tout de restaurer un
rapport de confiance entre usagers et institutions, rapport bien mis à mal par l’optique du
« tout à l’emploi » et du contrôle généralisé tels que développés ces dernières années.
Dans ce but, des propositions se basant sur une opérationnalisation de la théorie des capabilités
de Sen apportent, en conclusion, une note résolument positive et ce, afin de changer la donne
sociale actuelle de la plus constructive des manières.

« Changeons la donne sociale » – etopia – Lionel Thelen 2007
-3-
TABLE DES MATIERES
1. Introduction 4
2. La restriction du champ des possibles 6
« S’interdire de » 6
Sommes-nous tous susceptibles de devenir des personnes précarisées ? 7
“Il faut être fort et heureux pour aider les gens dans le malheur” 8
3. L’habitus originaire : un espace potentiel appauvri, une créativité restreinte 8
La capacité de « se prendre au jeu » 9
Un rapport au monde sur le mode de la défiance 10
4. La perception du temps chez la personne précarisée 11
Le règne de l'immédiateté et de la monotonie 11
Les hommes sans à-venir 12
5. Les préférences adaptatives 13
La « précaritude » : un univers extrêmement contraignant 14
6. Activation, urgence & médicalisation 15
« L’activation» : On ne peut changer la société… Changeons le pauvre ! 16
La difficulté des « politiques » à comprendre les plus démunis 18
Un travailleur de plus = un bénéficiaire de moins 19
Le passage du social au psychologique 19
La violence institutionnelle 20
L’urgence 22
La médicalisation à outrance 23
Toute résistance devient preuve supplémentaire de pathologie 24
7. Changeons la donne : c’est à la structure qu’il faut s’attaquer 26
La théorie des capabilités 26
La méthode I.O.D. : « L’intervention sur l’offre et la demande » 28
8. Entre l’usager précarisé et le fonctionnaire : le
tiers-intervenant
29
Gagner leur confiance 29
Créer des liens personnalisés 30
L’aide sans le contrôle 31
Conclusion 31
Bibliographie 32

« Changeons la donne sociale » – etopia – Lionel Thelen 2007
-4-
1. Introduction
Beaucoup se font une idée erronée de ce que peut représenter la pauvreté pour ceux qui la
vivent. Simplement parce que nous sommes tous et toutes victimes de sociocentrisme, id est que
nous apprécions toute situation vécue par autrui avec un point de vue biaisé : le nôtre. Ainsi,
nous projetons, sur les personnes et situations qui nous sont rapportées par les médias, notre
propre manière de fonctionner, nos propres schèmes de perception et, par-là, nos propres
jugements. Certains vont blâmer les « pauvres », seront tentés de les « secouer », de les
« activer » ; d’autres vont les idéaliser, mettre en exergue la frugalité de leur vie, leur tempérance,
leur « capacité à se débrouiller avec trois bouts de ficelle », etc. Tous seront – à des degrés divers
– loin de la réalité vécue par les personnes dont ils parlent.
Bien sûr, il est capital de préciser qu’il y a une infinité de pauvretés différentes, ne serait-ce
qu’en raison du fait que tous la vivent et la ressentent de façon différenciée. Le chercheur est
tout autant incapable de rendre compte de cette diversité que le tout venant. Toutefois, pour
reprendre les termes de Goffman, ce qui importe – pour comprendre un phénomène social tel
que la pauvreté – c’est de prendre en considération « non pas les hommes et leurs moments mais
plutôt les moments et leurs hommes » (Goffman, 1974, 8). Phrase pouvant apparaître sibylline, elle
permet pourtant de recentrer le débat :
Ce qui est réellement important, au premier chef, c’est moins de comprendre la façon dont les
individus interprètent leur situation que de comprendre la logique qui sous-tend la majorité de leurs
actions. Cette dernière dépend étroitement des contraintes que fait peser sur les personnes ‘en
pauvreté’ l’environnement social, culturel et économique au sein duquel elles évoluent en
permanence. On peut dès lors réécrire la phrase de Goffman comme suit : ce qui importe c’est de
comprendre moins la manière dont les individus appréhendent et justifient leur manière de vivre que,
plutôt, la manière dont leur contexte de vie les contraint et, de la sorte, les façonne, le plus souvent, à leur
insu.
Ce qui est donc primordial pour le chercheur en sciences sociales, c’est de déconstruire les
mécanismes de coercition explicites mais, surtout, implicites qui, rapidement vont renforcer
une situation de pauvreté qui ne peut être, au départ, qu’accidentelle et ponctuelle et ce, pour
en faire un véritable mode de vie, un « métier de pauvre » qui, imprégnant toutes les
dimensions de la vie sociale de l’individu, devient structurel et donc pérenne.
Trop fréquemment, pourtant, pour comprendre et venir en aide aux populations défavorisées,
on continue à ne prêter attention qu’à des indicateurs extérieurs (revenu, accès à des
allocations/bénéfices sociaux,…) ou au seul discours tenu soit par les travailleurs sociaux soit
par les usagers, les personnes précarisées elles-mêmes. Tous ces apports sont capitaux et les
négliger serait erroné mais ils ne suffisent pas. Les phénomènes de pauvreté, de précarité, de
désaffiliation, de disqualification sociale – pour reprendre quelques-uns des termes usités en
sciences sociales ces 15 dernières années – sont pluriels et ne peuvent être assimilés que par une
approche écologique, c’est-à-dire holistique, qui tente de prendre en compte le plus d’éléments
possibles en vue d’en tirer une image puis un diagnostic d’ensemble. Dans ce sens, ne faire
attention qu’à l’explicite, c’est laisser dans l’ombre des (et rester dans l’ignorance de) pans
entiers des constituants majeurs du quotidien d’une personne précarisée.
Au cours de ces lignes, nous parlerons de personnes pauvres, sans-abri, précarisées au travail ou
sans, de personnes en grande détresse sociale, etc. Cela pour illustrer la variété de situations
vécues aux marges les plus défavorisées de nos sociétés. L’article vise à montrer ce qui lie toutes
ces situations et il sera donc demandé au lecteur de considérer les différentes appellations
usitées, moins comme des synonymes (ce qu’elles ne sont pas bien sûr) que comme les
différentes facettes d’une réalité vécue au quotidien dans l’extrême contrainte, où les marges de

« Changeons la donne sociale » – etopia – Lionel Thelen 2007
-5-
manœuvre individuelles sont réduites et où le mot « autonomie » apparaît des plus vain.
Cet article s’appuie sur plus de 10 années de recherche menées avec des populations précarisées
sinon extrêmement précarisées (sans-abri, sans-papiers, personnes vivant dans des bidonvilles ou
des squats, …) dans 5 pays différents : Belgique, Brésil, France, Portugal et Suisse. Alternant
entretiens semi-dirigés avec différents acteurs du monde associatif, avec les personnes
défavorisées elles-mêmes ainsi qu’avec des fonctionnaires d’institutions d’aide sociale, des
observations participantes avec les usagers ou tant que personne sans-abri moi-même, en servant
comme bénévole ou stagiaire dans différentes institutions d’assistance voire en recueillant des
histoires de vie, il a été tenté de donner justement une compréhension globale des phénomènes
précités. C’est donc sur plusieurs années de terrains et près de 150 entretiens et histoires de vie
que s’appuient ces quelques pages. Pour plus de détails, ne pas hésiter à se référer à l’ouvrage
qui a été tiré de ces recherches : « L’exil de soi. Sans-abri d’ici et d’ailleurs » paru aux Publications
des Facultés Universitaires Saint-Louis en 2006.
Partant de l’idée que la précarité, pour ceux qui la subissent, se caractérise avant tout par :
- La restriction du champ des possibles
Nous passerons en revue les points suivants afin d’expliciter le pourquoi de ce rétrécissement :
- L’habitus originaire : un espace potentiel appauvri et une créativité restreinte
- La perception du temps chez la personne précarisée ;
- Les préférences adaptatives
Nous essaierons ensuite de percevoir les traits saillants des politiques sociales généralement de
mise à l’heure actuelle, à l’heure où il est vu comme primordial d’activer tous les sans-emploi,
c’est-à-dire, pour l’essentiel, de les réinsérer sur le marché du travail :
- Urgence, activation & médicalisation : « On ne peut changer la société… Changeons le pauvre ! »
Enfin, en vue de donner des alternatives plausibles prenant en compte les points énumérés ci-
avant, nous mettrons en exergue les stratégies suivantes, bien connues et théorisées pour les
deux premières, tout aussi connue des travailleurs sociaux mais non encore réellement
formalisée pour la troisième :
- C’est à la structure qu’il faut s’attaquer : Théorie des capabilités et Méthode I.O.D.
- Une interface entre l’usager précarisé et le fonctionnaire en charge de l’aide sociale : le
tiers-intervenant
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%