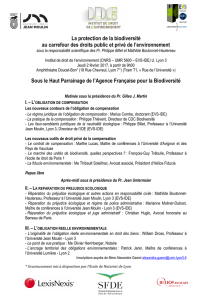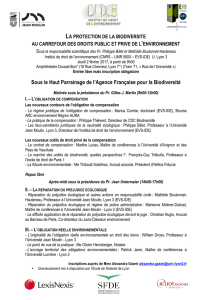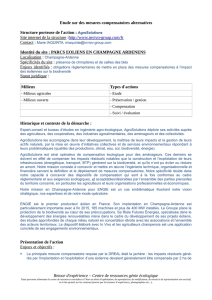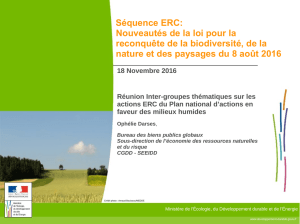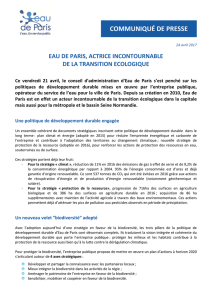Les mesures compensatoires pour la biodiversité

Service Patrimoine et Territoires
Unité patrimoine et impacts
Horaires d’ouverture : 8h30-12h00 / 14h00-17h00
Tél. : 33 (0) 4 42.66.66.00– fax : 33 (0) 4 42.66.66.01
BP 120 – Allée Louis Philibert – Le Tholone
t
13603 Aix-en-Provence cedex 1
w
ww.paca.ecologie.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-C
Ô
TE D’AZUR
Les mesures compensatoires pour la
biodiversité : la stratégie de la DIREN
PACA
Principes de mise en œuvre, actions
régionales et nouvelles perspectives
Aix-en-Provence, le 18 septembre 2008
D
irection régionale de l’environnement
P
rovence-Alpes-Côte d’Azur
La DIREN PACA est confrontée de plus en plus régulièrement à des aménagements ayant des
impacts résiduels sur la biodiversité, ceci s’expliquant à la fois par la richesse de la biodiversité
régionale et par les pressions toujours présentes des nombreux aménagements.
Dans ce contexte, la DIREN a souhaité dresser le bilan de sa connaissance sur la thématique
des mesures compensatoires pour la biodiversité, afin d’apporter les éléments méthodologiques
aux acteurs de la compensation : maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, services de l’Etat, …
Ce travail fait l’objet d’un rapport en cours de finalisation : « Les mesures compensatoires pour
la biodiversité : principes et projet de mise en œuvre en région PACA », en collaboration avec le
CETE Méditerranée.
En parallèle, la note de synthèse ci-jointe a été rédigé par Jennifer Rossetti, stagiaire vacataire
à la DIREN entre mars et août 2008.

www.developpement-durable.gouv.fr
2 -
SOMMAIRE
PROPOS INTRODUCTIF : ELEMENTS DE CONTEXTE ET PORTEE DU DOCUMENT.....3
I
Les mesures compensatoires : origine, définition, mise en œuvre
Les orientations de la DIREN PACA
..........................................................................5
1.1
Les fondements théoriques de la compensation : principes et définition..............................................5
1.2
Le cadre réglementaire français de la compensation............................................................................5
1.2.1
Les principes généraux de la compensation .................................................................................5
1.2.2
Les règles spécifiques de compensation.......................................................................................6
1.2.3
Les documents supports mentionnant les mesures compensatoires............................................7
1.3
Un constat : une difficile mise en œuvre en l’état des mesures compensatoires..................................8
1.4
Les préconisations de la DIREN sur la démarche à suivre en PACA pour une pratique vertueuse de
la compensation................................................................................................................................................9
II De nouvelles approches en matière de compensation : les actions innovantes en
région PACA........................................................................................................................12
2.1 Le rapport « Les mesures compensatoires pour la biodiversité. Principes et projet de mise en œuvre en
région PACA » ................................................................................................................................................12
2.2 Le comité de suivi « Biodiversité » dans la zone de Fos/Lavéra/Port Saint Louis....................................12
2.3 La matrice écologique du Port Autonome de Marseille (PAM) .................................................................13
2.4
CDC Biodiversité et le projet d’expérimentation nationale d’un nouveau mécanisme de compensation en
Crau .............................................................................................................................................................15
PROPOS CONCLUSIF
COMPENSATION ET BIODIVERSITE : QUEL AVENIR ?..................................................19
ANNEXES ............................................................................................................................20

www.developpement-durable.gouv.fr
3 -
PROPOS INTRODUCTIF : ELEMENTS DE CONTEXTE ET PORTEE DU
DOCUMENT
Jusqu’aux années 1970, la diversité de la vie n’a cessé d’augmenter sur Terre. Cependant, l’exploitation de la
nature par l’homme a contribué à inverser la tendance. Aujourd’hui, on estime qu’un tiers de la biodiversité
1
a
disparu depuis 1975, que 150 types d’organismes uniques s’éteignent chaque jour et que 60% des services
vitaux fournis à l’homme par la biodiversité sont en baisse.
Face à ce déclin sans précédent, il apparaît primordial, dans un contexte d’urbanisation, d’anthropisation des
milieux et de développement économique accélérés, d’appliquer efficacement les mesures existantes en
matière de protection de la biodiversité, voire de les repenser et de rechercher de nouvelles manières de
concilier logiques économiques et valeurs écologiques. Pour permettre un développement respectueux de la
nature, la réglementation actuelle qui repose sur la loi de 1976 sur la protection de la nature prévoit qu’ «
[…] il
est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités
publiques ou privées d’aménagement, d’équipement et de production doivent se conformer aux mêmes
exigences. […] (art. 1). Les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique
ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme
doivent respecter les préoccupations d’environnement. Les études préalables à la réalisation d’aménagements
ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent
porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les
conséquences. […] Le contenu de l’étude d’impact comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et
de son environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait et les
mesures envisagées pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement
.
(art. 2)
». Ces principes sont par ailleurs codifiés dans le Code de l’environnement et repris dans d’autres lois,
comme la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques.
Toutefois, la pratique de ces mesures compensatoires souffre de nombreux handicaps qui conduisent à une
faible mise en œuvre des mesures ou à une mise en œuvre peu pertinente alors que la perte de biodiversité
représente aujourd’hui un problème majeur. Or, cette érosion n’est pas encore irréversible et dépend des choix
politiques, économiques et sociaux à venir.
La biodiversité est aujourd’hui au cœur des réflexions. Au niveau international, le sommet de la Terre de Rio
de Janeiro de 1992 a marqué un tournant avec l’adoption de la Convention sur la diversité biologique qui
reconnaît pour la première fois en droit international que la conservation de la diversité biologique est une
préoccupation commune à l’ensemble de l’humanité et est consubstantielle au processus de développement.
La 9
ème
conférence des signataires de cette convention s’est tenue à Bonn du 19 au 30 mai 2008 et a
contribué, entre autres, à l’adoption de décisions en matière de lutte contre la biopiraterie, de protection des
milieux marins, de financement de mesures inter-étatiques visant à la protection de la nature et de culture
durable des plantes énergétiques. De son côté, l’Union Européenne a également pris des mesures en faveur
de la biodiversité : le réseau Natura 2000 dont l’objectif est de maintenir la diversité biologique des milieux, la
directive cadre dans le domaine de l’eau qui établit un cadre communautaire pour la protection et la gestion
des eaux, qui fonctionne par objectifs et non plus de manière sectorielle et qui introduit la notion de « bon état
écologique », ou encore la stratégie de Göteborg qui prévoit de stopper la perte de biodiversité d’ici 2010.
Nationalement, la France s’est dotée d’une stratégie pour la biodiversité en 2005, qui est une déclinaison de la
stratégie nationale de développement durable adoptée en 2003 et qui fait vivre le cadre et l’esprit établis par la
Charte de l’environnement adossée à la Constitution en 2005 ; cette stratégie pose comme objectifs principaux
l’arrêt de la perte de biodiversité d’ici 2010, la reconnaissance de sa valeur au vivant, l’amélioration de la prise
en compte de la biodiversité dans les politiques publiques et le développement de la connaissance scientifique.
Le Grenelle de l’environnement en 2007 a également contribué à remettre sur le devant de la scène les enjeux
liés à la perte de biodiversité en proposant quatre grands axes d’actions : stopper partout la perte de
1 La biodiversité représente l’ensemble des espèces vivantes sur Terre, les communautés formées par ces espèces et les habitats dans lesquels
elles vivent. La biodiversité renvoie donc à trois niveaux : la diversité génétique au sein des espèces, la diversité entre espèces et la diversité
des écosystèmes.

www.developpement-durable.gouv.fr
4 -
biodiversité, organiser l’action en faveur de la biodiversité, connaître et faire connaître la biodiversité (la
Fondation scientifique pour la biodiversité a été présentée le 26 février 2008), et agir pour sauver la
biodiversité planétaire au-delà des frontières françaises.
De nouveaux concepts écologiques ont émergé de ces différentes rencontres et réflexions. Ainsi, la tendance
va aujourd’hui vers une prise de conscience accrue de la valeur des services rendus par la nature à l’activité
humaine et économique, puisque la nature apporte de fait les éléments nécessaires à la vie et au
développement (eau, air, bois, ressources pharmaceutiques, fibres pour les vêtements, fertilité des sols ,
stockage de carbone…). De plus, l’amélioration des connaissances scientifiques sur les écosystèmes et les
espèces a permis de formuler de nouveaux modèles de préservation de la nature qui prennent désormais en
compte la « fonctionnalité des milieux » en intégrant les notions de corridors biologiques
2
ou de trames
écologiques vertes et bleues (réseau de corridors biologiques)
3
, qui constituent des outils efficaces de gestion
conservatoire des écosystèmes. Ces différentes notions ont été reprises dans un rapport du Sénat du 12
décembre 2007 intitulé « La biodiversité : l’autre choc ? l’autre chance ? » qui fait par ailleurs état de
propositions originales pour sauvegarder la biodiversité, telles que la rémunération des services écologiques
par l’instauration du principe « pollueur-payeur », la soumission des opérations d’aménagement impactant le
territoire à des critères d’éco-conditionnalité ou la mise en place d’un marché de la compensation des atteintes
au milieu naturel qui s’inspirerait du fonctionnement du marché des émissions de CO2.
A l’échelle locale et territoriale, la DIREN PACA, consciente des enjeux posés par le déclin de la biodiversité et
porteuse de cette nouvelle dynamique de réflexion autour de la préservation de la nature, entend se donner les
moyens de relever ce défi environnemental à l’échelle de son territoire, territoire particulier puisqu’il est à la fois
un haut lieu de biodiversité (54% du territoire en Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
30% en zones Natura 2000) et un espace qui subit de fortes pressions en terme de développement
économique et urbain.
La DIREN a donc décidé de produire un document destiné à servir de manuel pratique de la compensation en
PACA et à en garantir une réalisation effective et optimale.
L’objet de la présente note est de formuler la stratégie territoriale de la DIREN PACA en matière de
compensation et de fournir à tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures compensatoires
(maîtres d’ouvrage, acteurs de l’environnement (associations, établissements publics, conservatoires,
muséums…), préfectures, bureaux d’étude, collectivités territoriales…) une information claire et synthétisée sur
la démarche à suivre.
Ce document est, de fait, un outil pratique qui entend donner aux différents acteurs les éléments d’information
nécessaires pour comprendre ce qu’est la compensation et choisir de manière éclairée les moyens les plus
adaptés pour l’appliquer.
Par ailleurs, il a pour vocation d’afficher les ambitions de la DIREN PACA, de mettre en lumière sa vision
dynamique de l’environnement qui tend à s’émanciper des seuls cadres réglementaires et de présenter les
initiatives portées par le territoire dans cette optique.
2 Un corridor écologique ou biologique correspond à un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une
espèce ou un groupe d’espèces ; ces structures écopaysagères permettent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs sous-populations et
permettent la migration d’individus et la circulation de gènes. C’est par exemple le cas des corridors rivulaires ou ripisylves (espaces situés le
long des cours d’eau) qui servent à la fois d’habitats, de refuges et de couloirs de circulation à de nombreuses espèces.
3 Trame écologique : maillage écologique ou infrastructure naturelle, qui renvoie à l’idée de cohérence ou connectivité écologique. Les trames
sont des outils d’aménagement du territoire qui consistent à cartographier les territoires pour repérer les zones stratégiques, les corridors et les
zones tampons afin de créer une continuité territoriale. La trame verte désigne les espaces naturels terrestres, et la trame bleue désigne les
cours d’eau et les masses d’eau ainsi que les bandes végétalisées qui les longent. La mise en place d’une trame verte et bleue nationale est une
des propositions du Grenelle de l’Environnement.

www.developpement-durable.gouv.fr
5 -
I Les mesures compensatoires : origine, définition, mise en œuvre
Les orientations de la DIREN PACA
A partir des fondements et principes légaux de la compensation, la DIREN PACA a décidé d’établir des
priorités et de formaliser une démarche de mise en œuvre des mesures compensatoires, qui sont présentées
dans ce chapitre.
1.1 Les fondements théoriques de la compensation : principes et définition
Les mesures compensatoires sont des actions positives pour la biodiversité mises en œuvre pour
contrebalancer les impacts résiduels d’un projet sur l’environnement. Elles n’interviennent qu’après les
mesures d’évitement du dommage puis de réduction de l’impact et qu’après justification du projet.
La compensation repose sur quatre fondements :
L’objectif de « pas de perte nette » ou «
No net loss
»
: il s’agit de viser une logique de perte zéro de
biodiversité, c’est-à-dire d’atteindre une neutralité écologique des projets.
L’additionnalité
: les mesures compensatoires doivent aller au-delà de la non perte de biodiversité et aboutir à
un gain net de biodiversité ; elles doivent générer une additionnalité écologique supérieure à la perte de
biodiversité qui n’a pu être ni évitée ni réduite. Une mesure compensatoire est donc additionnelle si elle permet
d’atteindre un état écologique meilleur ou supérieur à l’état écologique antérieur à la mise en œuvre de la
mesure.
La faisabilité technique et foncière
: les mesures doivent être réalisables sur le plan technique, financier,
scientifique et foncier.
La pérennité
: les mesures compensatoires doivent être pérennes, c’est-à-dire garantir la durabilité de la
préservation et de la vocation écologique des espaces naturels qui font l’objet d’une compensation (mesures
d’acquisition foncière en vue d’une protection particulière des espaces, rétrocession à un organisme de
protection et de gestion des espaces naturels, mise en place d’une protection réglementaire (réserve, arrêté
préfectoral de protection de biotope…)) et préciser les modalités de suivi, de gestion et d’évaluation des
actions mises en œuvre.
Si ces concepts sont applicables à toute sorte de mesures compensatoires et donc à tous les projets, il est
important de se rappeler que les mesures compensatoires varient en fonction de la nature du projet et de ses
impacts.
1.2 Le cadre réglementaire français de la compensation
1.2.1 Les principes généraux de la compensation
La
loi du 10 juillet 1976
sur la protection de la nature est aux fondements du principe de la compensation, de
la législation en matière de préservation de l’environnement et de l’évaluation environnementale. Elle
représente un tournant dans le domaine de la protection de l’environnement, car elle dépasse la vision
utilitariste de la nature et élève au rang d’intérêt général la protection des espaces naturels et des paysages, la
préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres écologiques et la protection des
ressources naturelles contre toute menace de dégradation.
Cette loi crée l’
étude d’impact qui introduit la notion de compensation
: ainsi, la réalisation de certains
aménagements publics ou privés doit être précédée d’une étude permettant d’évaluer les conséquences du
projet sur l’environnement ; cette étude doit contenir l’analyse de l’état initial du site, l’étude des modifications
que le projet y engendrerait et les
mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer, réduire et
si possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement
.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%