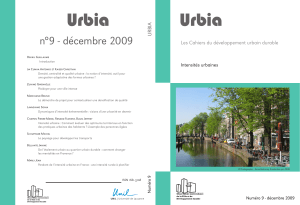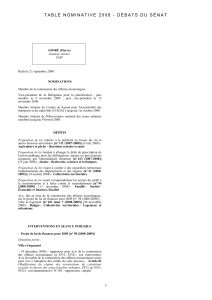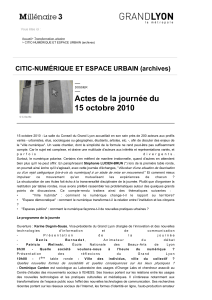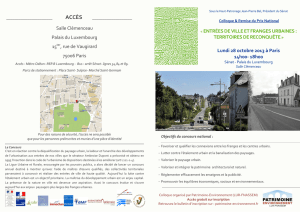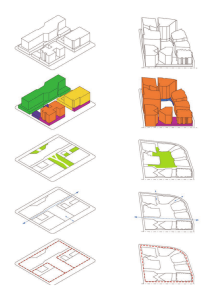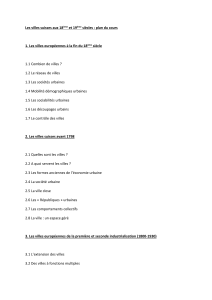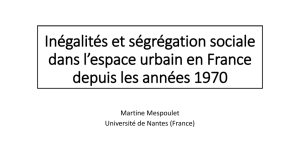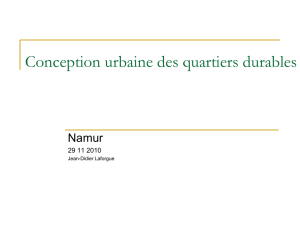VOIES URBAINES

Extrait du Vocabulaire français de l'Art urbain, par Robert-Max Antoni, sur www.arturbain.fr
Extrait du “Vocabulaire français de l'Art urbain”, par Robert-Max Antoni, sur www.arturbain.fr
VOIES URBAINES
VOIES URBAINES :
Du latin via, « voie », et
urbanus, « de (la) ville ».
Espace à parcourir pour aller
quelque part. Voies urbaines, à
l'intérieur d'une agglomération
(rue, avenue, boulevard, etc.).
Voies express, à circulation
rapide, dans les villes. Les voies
sur berges, à Paris.
D'une manière générale,
la voie publique est "tout
espace du domaine public
destiné à la circulation
(voies proprement dites,
places, etc.) dans les villes.
[…]. Partie d'une route de
la largeur d'un véhicule.
Route à trois, quatre
voies » (Le Robert).
Dès l'époque grecque, à
travers les cités-États, coexis-
tent deux modèles
d'organisation, le plan libre
(Pergame) et le plan ortho-
normé (Milet) (1). Ce der-
nier, datant du Ve siècle
av. J.-C., se fonde sur un plan
en échiquier. Son découpage
perpendiculaire délimite les
insulæ rectangulaires per-
mettant une lecture claire et
symbolique de l'espace. À la
même époque, les Romains
s'inspirent des principes
grecs. L'organisation viaire
découvre une place centrale
au croisement de l'axe
est/ouest (decumanus) et
nord/sud (cardo). Les voies
sont réglementées selon leur
usage. Les itinera désignent
les rues pour piétons, l'actus
sert pour le passage d'un
char et la via, pour celui de
deux chars. Leur largeur
varie de 4 à 8 m avec une
exception de 32 m pour la
Via Noua de Rome. Déjà, les
rues sont dallées et bordées
de trottoirs. Aoste révèle une
persistance de la trame viaire
romaine jusqu'à nos
jours (2).
La planification isotropique
est abandonnée dans les
villes chrétiennes du Moyen
Âge. Elles s'organisent au-
tour d'un lieu de culte ou
d'un château fort protecteur
suivant un plan circulaire.
Délimité par des enceintes,
l'espace urbain se compose
de voies très étroites et
irrégulières, comme l'illustre
la cité de Brive (3).
Au XVIIe siècle, on assiste à
l'élargissement des artères
principales grâce au principe
de l'expropriation immédiate.
Suivant une politique d'unifi-
cation, les dimensions sont
normalisées. Le plan officiel
des rues de Paris de
Verniquet permet d'établir
trois classes de voies : 10 m
et plus, de 8 à 10 m et moins
de 8 m. Parallèlement, la
hauteur des bâtiments est
définie. Sous le Directoire,
un arrêté codifie les dimen-
sions des rues entre 14 m et
6 m.
Durant la révolution indus-
trielle, 95 % du système
viaire français est mis en
place entre 1836 et 1886. La
voirie parisienne sert de
modèle. Rambuteau (1833-
1848) applique, sous la
Restauration, les premiers
plans d'alignement en
perçant et élargissant certains
axes. La voie urbaine est
traitée comme un équipe-
ment. Une partition horizon-
tale (les chaussées et les
trottoirs) et verticale (sol et
sous-sol) est implantée.
Haussmann (1853-1870) im-
pose un plan d'ensemble
systématique de la voirie
urbaine pour répondre aux
problèmes d'encombrements
dus à la circulation. L'art de
la voirie codifie l'espace
urbain et son paysage. La rue
est traitée comme une
composition (profil bombé,
revêtement, trottoirs et
caniveaux). Le boulevard et
l'avenue déterminent une
nouvelle typologie de voies
urbaines (8/9).
Les villes américaines quant
à elles sont planifiées suivant
le modèle de la trame de
Jefferson (Jefferson's Ordinance)
qui définit un quadrillage
rectiligne strict (7).
Cerda (1815-1876) propose
sa « teoria » fondée sur un
urbanisme de réseaux
précurseur des doctrines du
Mouvement moderne. Son
approche fonctionnaliste, la
première, différencie l'espace
du mouvement (la voirie) de
celui du séjour (les îlots)
suivant le concept de
« viabilité universelle », com-
me le montre le plan de
Barcelone (4). La ville se
compose d'un système de
voies orthogonales formant
les carrefours traités en pans
coupés et percées de voies
diagonales. Les voies particu-
lières sont réservées à l'accès
aux lotissements.
Ebenezer Howard (1850-
1928) publie en 1899 le
concept des cités-jardins
satellites en Angleterre. Leur
plan théorique partant d'un
rond-point central suit un
schéma radioconcentrique
avec une hiérarchisation des
voies (6).
Les CIAM approfondissent
la logique de la spécialisation.
En 1933, Le Corbusier
présente, au congrès d'Athè-
nes, sa théorie de « la ville
fonctionnelle ». Le système
viaire est requalifié selon la
vitesse et hiérarchisé suivant
trois fonctions fondamen-
tales : l'habitat, le travail et le
loisir. À Chandigar (5), il
applique le principe des
« sept V » composé de
sept voies adaptées à l'usage
et à la circulation modernes.
En préviligiant la vitesse et
en évitant les carrefours par
des voies en dénivelé, il
réduit le réseau viaire à une
monofonctionnalité circula-
toire avec perte d'orientation
et de liens avec le bâti.
La croissance de la motorisa-
tion dans les années qui
suivent la Seconde Guerre
mondiale bouleverse la
problématique des villes.
En 1969, les voies rapides
urbaines (autoroutes urbai-
nes) sont mises en place sur
les berges parisiennes. Le
boulevard périphérique se
substitue aux remparts
suivant un schéma circulaire.
Dans les années soixante-dix,
les rues piétonnes font leur
apparition pour restituer le
centre des villes aux
riverains. Avec l'évolution
des différents modes de
déplacements (transports en
commun, vélos, etc.)
surgissent les voies en site
propre employées notam-
ment au cœur des « villes
nouvelles » (10).
À l'inverse, l'essor de voies
mixtes réglementées telles
que les zones 30 (limitées à
30 km/h) ou les cours
urbaines sont des alternatives
à la spécialisation et à
l'encombrement de l'espace
urbain.
La réduction du station-
nement et de la circulation
automobile aux voies
urbaines ne peut que réhabi-
liter les espaces publics pour
les citadins. Cependant les
habitudes prises par nos
concitoyens et les nom-
breuses activités économi-
ques qui dépendent de
l'usage abusif de l'auto
constituent une résistance au
changement comportemen-
tal et économique. Seule une
réponse globale dans le
temps apportera une amélio-
ration de notre cadre de vie.
V. AVENUE, BOULEVARD,
CARREFOUR, COUR, ÎLOT,
LOTISSEMENT, ROND-
POINT, RUE, RUE PIÉ-
TONNE.
« Le point de départ comme le point d'arrivée de toutes
les voies est toujours l'habitation ou la demeure de
l'Homme. La communication entre ces deux points
extrêmes n'est généralement pas directe et elle doit
s'effectuer par des voies intermédiaires. Un système de
voies ressemble à un bassin fluvial. Les sources forment
des ruisseaux qui affluent vers des torrents. Ceux-ci
débouchent dans les rivières qui, à leur tour, se jettent
dans le fleuve qui mènera toutes ces eaux à la mer. De
même, l'Homme sort de sa maison en empruntant un
sentier qui le conduit à un chemin qui débouche sur un
chemin vicinal. Celui-ci mène à une route
départementale, puis nationale, et ainsi de suite,
jusqu'au rivage de la mer où les différentes voies se
disperseront sur cet élément navigable en toutes
directions pour desservir les divers points du globe. »
I. Cerda
1
/
1
100%