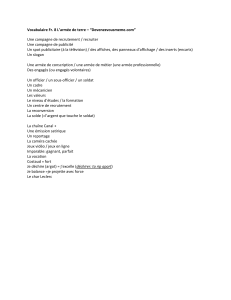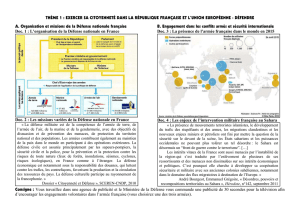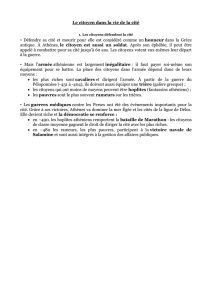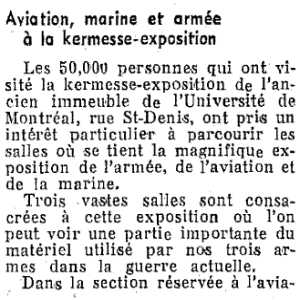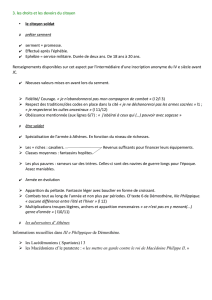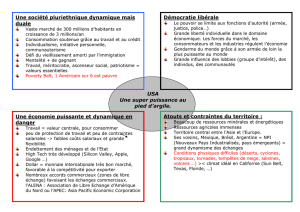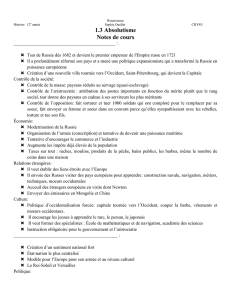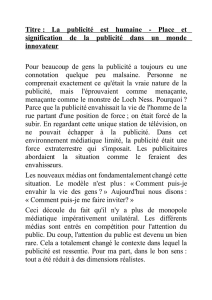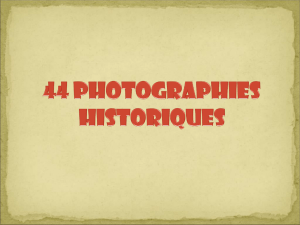Philippe Barrière, philippe

Philippe Barrière pour le site académique du Centenaire de la Grande Guerre de l’Académie de Grenoble Page 1
La conscription.
L’héritage de la Révolution française.
Edmond Louis Alexis Dubois de Crancé, dit Dubois-Crancé (1747-1814), élu du tiers état aux Etats généraux,
établit le 9 novembre 1790 un postulat majeur : « C’est maintenant un droit à tous les Français de servir la patrie.
C’est un honneur d’être soldat quand le titre est celui de défenseur de la constitution de son pays […]. Chaque
citoyen doit toujours être prêt à marcher pour la défense de son pays […]. J’établis pour axiome qu’en France tout
citoyen doit être soldat et tout soldat citoyen ou nous n’aurons jamais de constitution
1
».
La France entretient en effet de longue date un rapport particulier avec la chose militaire. Et c’est bien la Révolution
française qui a donné une nouvelle dimension à cette liaison étroite entre l’armée et la nation, laquelle culminera
pendant la Première Guerre mondiale. Sans l’avoir voulu – car les révolutionnaires souhaitaient rénover
profondément l’armée de la monarchie mais n’entendaient pas créer une nouvelle armée, ce que pourtant ils firent
finalement –, la Révolution française a inscrit le fait militaire au cœur de la République. Cette bifurcation de la voie
française vers une armée nationale est liée à l’histoire et aux contraintes « géostratégiques » auxquelles la France est
soumise. Ainsi aboutit-on à la construction d’un « modèle » français singulier parce que reposant sur un lien de
nature essentiellement politique entre la défense et une citoyenneté réinventée à partir de 1789. Le citoyen est
concerné par celle-ci même s’il n’est pas militaire de carrière ou professionnel de la guerre. Les formes – et d’abord
la question cruciale de l’étendue temporelle de ce devoir civique – firent l’objet d’un débat qui ne cessa pas, jusqu’à
la loi de… 1997. Avec la Révolution, mieux, avec la République (et notamment par la levée en masse décrétée le 23
août 1793), est inventée une première forme de service personnel obligatoire.
La troisième République, une nation armée.
A l’intérieur de ce cadre général (une armée de conscription nationale avec un service militaire obligatoire), c’est la
seconde crise marocaine (1911) qui pousse la France à accélérer sa préparation militaire.
Au vrai, le redressement avait commencé bien avant cette date, impulsé par deux nécessités : préparer la revanche
et parfaire la défense nationale. Il faut d’ailleurs retenir que globalement, la responsabilité de la défaite de 1870 a
été rejetée sur le régime impérial et les mauvais choix politiques opérés par Napoléon III. Aussi, on peut considérer
que l’armée en tant que telle échappe au discrédit général dont pâtit le Second Empire, alors même que
tactiquement, sur le terrain des opérations strictement militaires, les erreurs, fautes de commandement,
inadaptations, avaient été nombreuses. Mais les conservateurs et les progressistes, malgré des conceptions opposées
du service militaire, ont intérêt à préserver l’institution militaire. Du côté monarchiste, l’on fonde sur l’armée des
espoirs de reconquête du pouvoir et de contrôle social, sur le mode du sanglant épisode de répression de la
Commune. Les républicains quant à eux veulent ménager l’armée car ils entendent la réformer en la démocratisant,
afin surtout qu’elle ne fonctionne plus comme une manière d’Etat dans l’Etat. C’est ce qui explique le patient
travail législatif entrepris par la troisième République pour « républicaniser » l’armée.
Ainsi, la loi du 27 juillet 1872 instaure le principe d’un service universel d’une durée de cinq ans. Le tirage au sort
de bons ou mauvais numéros est maintenu et seuls les mauvais numéros sont astreints au service ; cela permet à
certains, contre rétribution financière, de trouver un remplaçant…Des aménagements sont aussi mis en place : les
(rares) titulaires du baccalauréat, à condition de se porter volontaires, sont ainsi assujettis à une seule année de
service… Quant aux ecclésiastiques, ils sont purement et simplement dispensés. Par ailleurs, une fois accompli leur
service militaire, les soldats sont versés dans la « réserve », ensuite dans la « territoriale » et enfin dans… la réserve
de la territoriale. Le calcul est simple : aux cinq ans de service s’ajoutent quinze ans pendants lesquels le citoyen est
en contact constant avec l’armée et reste potentiellement mobilisable. C’est cette réforme qui permet la création
d’une armée forte de 500 000 hommes, dans laquelle l’on reconnaît cette obsession française du nombre. Pour les
décideurs français en effet, depuis la levée des 300 00 hommes décrétée par la Convention en 1793, la clef du succès
réside en matière militaire dans la capacité du pays à dépasser l’ennemi au plan numérique. La victoire de la Prusse
sur l’Autriche à Sadowa, en 1866, qui fait forte impression sur toute l’Europe, réactive cette obnubilation.
Par ailleurs, il s’agit parallèlement de moderniser l’outil militaire. C’est dans cette perspective qu’une série de lois
(1873, 1874, 1875) précise l’organisation technique de l’armée, créant par exemple une Ecole supérieure de guerre,
couvrant le pays d’un dense réseau de casernes, préparant l’opinion pour l’instauration, enfin, d’un service universel
vraiment égalitaire, c’est-à-dire débarrassé du tirage au sort et des dispenses, mesures que l’opposition conservatrice
avait arrachées à des Républicains encore peu assurés au plan politique. Une fois le pouvoir entièrement entre leurs
1
Citation extraite de l’ouvrage d’Annie Crépin, op. cit. in bibliographie, p. 68. Souligné par nous.

Philippe Barrière pour le site académique du Centenaire de la Grande Guerre de l’Académie de Grenoble Page 2
mains (1877-1879), ces derniers ont les coudées plus franches. En 1889 – soit après dix ans d’âpres négociations au
sein des deux chambres – une nouvelle loi abaisse la durée du service à trois ans (et supprime le volontariat). Quant
aux fameuses dispenses, peu populaires en ces temps de République anticléricale (le slogan « Les curés sac au dos »
est alors très populaire), elles sont effectivement supprimées et remplacées par un service spécial d’un an.
Cependant, l’affaire Boulanger (le général « Revanche » s’appuie sur sa popularité acquise à la tête du ministère de
la guerre pour menacer la République d’un coup d’Etat aux relents bonapartistes) ainsi que l’affaire Dreyfus
prouvent que la « républicanisation » de l’armée n’est pas encore achevée au tournant du siècle. Les radicaux
remettent ainsi l’ouvrage sur le métier, faisant voter la loi de 1905 (suppression définitive du tirage au sort et durée
du service fixée à deux ans pour tous). En 1913 enfin, après des débats très vifs auxquels Jean Jaurès prend toute sa
part (son ouvrage, publié en 1910, L’Armée nouvelle
2
, milite pour une réforme en profondeur de l’armée) et dans le
contexte de montée des tensions que l’on connaît (les deux crises marocaines, la guerre des Balkans…), le service
est de nouveau porté à trois ans. La France s’estime alors prête à entrer en guerre.
La conscription en 1913 : « un processus d’acculturation, […] vecteur de nationalisation »
(Annie Crépin).
Néanmoins, notons ce fait essentiel : durant les quarante ans qui précède le premier conflit mondial, l’armée a
changé de place et de rôle. Non seulement elle s’est équipée (le fameux fusil Lebel de 1886, le non moins célèbre
canon de 75), modernisée dans son fonctionnement et démocratisée dans son recrutement (devenant, comme le
précise Jean-François Chanet « une armée permanente, où une minorité de cadres de métier se trouve placée sous
l’autorité du pouvoir civil et sous le regard des hommes du rang, leurs concitoyens, supposés gagnés par l’école aux
valeurs de la République ») mais elle s’est aussi muée en une seconde école de la République, en tout cas pour les
garçons. Pratiquant sans retenue l’autocélébration lors des fêtes et revues militaires (selon Jakob Vogel, son
historien, le défilé militaire parisien qui a initialement lieu à Longchamp réunit à partir de sa première occurrence en
1871 – il ne sera fixé au 14 juillet qu’à partir de 1880 – entre 150 000 et 400 000 personnes !), prises d’armes et
fêtes de garnison dans les villes de province, l’armée s’ancre profondément dans les pratiques sociales des Français
(satisfaire au rite de passage sociopolitique qui déclare le jeune homme « Bon pour le service » est indispensable) et
l’imaginaire républicain. Le défilé et la fête militaires sont ainsi des moyens forts de légitimer la République en la
situant dans la continuité historique des régimes précédents, permettant de présenter la puissance militaire française
à la fois comme une tradition ancienne d’excellence guerrière, un contrepoids à la défaite de 1870 et une
promesse de victoire à venir. Jules Grévy, premier président républicain de la République, ne dit pas autre chose
quand il s’exprime ainsi, sans ambages, dans son discours du 14 juillet 1880 :
« Le gouvernement de la République est heureux de se trouver en présence de cette armée vraiment nationale,
que la France forme de la meilleur partie d’elle-même, lui donnant toute sa jeunesse, c’est-à-dire ce qu’elle a de
plus cher, de plus généreux, de plus vaillant, la pénétrant ainsi de son esprit et des sentiments, l’aimant de son
âme et recevant d’elle, en retour, ses fils élevés à la virile école de la discipline militaire, d’où ils rapportent ans
la vie civile le respect de l’autorité, le sentiment du devoir, l’esprit de dévouement, avec cette fleur d’honneur et
de patriotisme et ces mâles vertus du métier des armes, si propre à faire des hommes et des citoyens ».
On comprend ainsi que l’armée est plus que le bras armée de la nation ; elle est une armée de citoyens-soldats prêts
à défendre leur patrie, au nom des idéaux de la République. Elle est, alors, vraiment devenue « l’arche sainte de la
nation »
3
. À l’été 1914, forte de cette triple certitude – être dans le sens de l’histoire, être soutenue par la nation, être
une armée moderne –, l’armée française ne doute pas : elle sait qu’elle dispose des moyens de mobiliser
instantanément près d’1,7 million d’hommes (réservistes inclus). La victoire ne saurait lui échapper…
2
Annie Crépin rappelle que le tribun socialiste « […] s’inspire du modèle suisse et préconise une armée de milice bien qu’il n’emploie pas
le terme. Les officiers de carrière, dont le nombre est retreint, doivent faire leurs études à l’université. L’instruction en caserne est réduite
à six mois mais doit être précédée d’une préparation effectuée dès l’âge de dix ans. Le “citoyen réserviste” est ensuite astreint à des
périodes d’exercices jusqu’à l’âge de quarante ans. Censée rapprocher armée et société, cette organisation est conçue comme un moyen
d’intégrer la classe ouvrière dans la nation ; elle relève aussi de la conception utopique – ou qui va se révéler telle – selon laquelle une
armée de réservistes ne peut être utilisée pour l’agression ou même pour l’offensive ».
3
L’expression est ancienne : « Toute armée à qui on dira qu’elle doit être l’arche sainte et être entourée d’un mur d’airain, cette armée ne
sera jamais nationale, quoique composée d’éléments nationaux », duc de Fitz-James, débat parlementaire à la Chambre des pairs, séance du
3 mars 1818 (autour de la loi de 1818, dite Gouvion-Saint-Cyr, qui établit un service de 6 ans par engagement volontaire).
1
/
2
100%