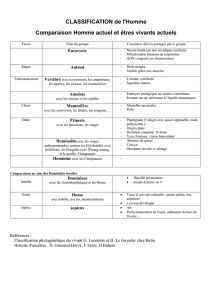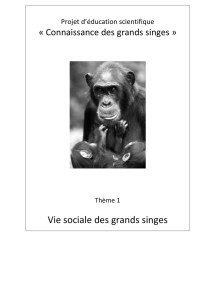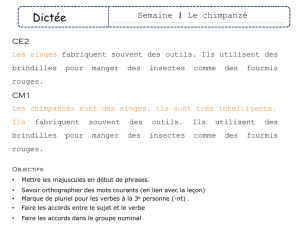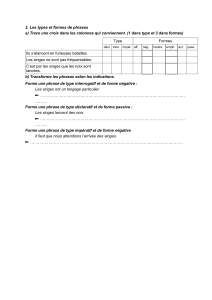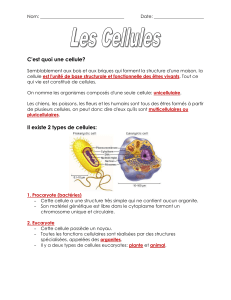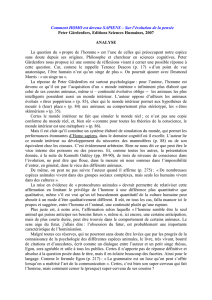Les philosophes et la «bêtise - Français et Philosophie en lycée

!
"!
Les philosophes et la «bêtise»
Philosophie magazine
Elisabeth de Fontenay, philosophe et auteur de Le Silence des bêtes, ouvre notre dossier par un constat et
une mise en garde. Oui, la frontière entre l’homme et l’animal s’efface et le débat entre « dualistes » et
« continuistes » n’a plus lieu d’être. Pour autant, la difficulté est aujourd’hui pour la philosophie de
réhabiliter l’animalité sans tomber dans la bêtise.
« Comme si l’homme avait été la grande pensée de derrière la tête de l’évolution animale. Il n’est
absolument pas le couronnement de la création : chaque être se trouve à côté de lui au même degré de
perfection », écrivait Friedrich Nietzsche. Par-delà ou en deçà de notre maîtrise du vivant, nous faisons
désormais, pour le meilleur et pour le pire, l’expérience d’une communauté de destin avec les animaux. Leur
proximité est à l’horizon de quelques-uns de nos problèmes les plus sensibles. Rappelons juste les épisodes
de la vache folle et de la grippe aviaire qui, avec le scandale des conditions industrielles et mercantiles
d’abattage et d’élevage, ont révélé le danger de contamination entre les espèces. On peut évoquer encore la
proche faisabilité de greffes d’organes animaux à des humains ou la création de chimères, animaux hybrides,
que rend désormais effective le génie génétique.
Les recherches scientifiques croisées des paléoanthropologues, des primatologues, des zoologues, des
éthologues et des généticiens, ce qu’on appelle la théorie synthétique de l’évolution (ensemble des théories
contemporaines de l’évolution), ne peuvent que ruiner, dans ses fondements implicites et bien-pensants, la
sacro-sainte foi humaniste et toujours quelque peu créationniste que nous avons dans l’unicité et la
prééminence de notre espèce. Ces disciplines achèvent de faire déroger l’homme, mettant fin à une
arrogance occidentale presque immémoriale.
Face à cette grande crise du propre de l’homme, les philosophes se trouvent en première ligne. Tous, depuis
le commencement grec, ont parlé de l’animalité, tantôt sans la thématiser explicitement, tantôt en lui donnant
une fonction capitale. Les uns, dualistes comme René Descartes et Emmanuel Kant, opposent
radicalement l’humain et l’animal. D’autres, comme Aristote, Gottfried Wilhelm Leibniz, Edmund
Husserl, se représentent une gradation de la sensibilité, de la mémoire, de la conscience, affirmant que
la nature ne fait pas de saut. Pourtant, ces continuistes n’hésitent pas à placer l’homme à part et au-dessus des
autres vivants, comme si le classificateur tendait à s’excepter de la classification. Un personnage du Politique
de Platon proclame drôlement que, si les grues avaient la parole, elles se placeraient d’un côté d’une ligne de
démarcation et mettraient tous les autres vivants, y compris l’homme, de l’autre côté...
Cette sape de la croyance au propre de l’homme passe aujourd’hui par l’écriture de philosophes
postmodernes, résolument anti-métaphysiciens, comme Gilles Deleuze et surtout Jacques Derrida. Il semble
néanmoins qu’il faille maintenir fermement disjointes deux interrogations hétérogènes : celle de l’origine de
l’homme (scientifique) et celle de la signification de l’humain (philosophique, politique). La philosophie,
pour autant qu’on s’engage par elle dans des expériences de pensée et qu’on y produit des concepts pouvant
susciter des normes, n’a pas à soumettre sa problématique aux révisions scientifiques et encore moins aux
conclusions éthico-politiques que certains paléoanthropologues, primatologues, généticiens, éthologues
proposent, ingénument et redoutablement parfois, de leurs résultats.
Ces tentatives de réduction – matérialistes et réactionnaires – de l’historique à l’éthologique ou du social au
« naturel » ne sauraient être ébranlées par de beaux discours sur le libre arbitre et la volonté. Seule une
argumentation philosophique et politique, attentive à ce qu’est un événement, au caractère tragique des
conflits de droit entre les êtres humains permet de ne pas sombrer dans la confusion et l’indistinction.
L’homme est décrit et expliqué par les scientifiques en tant qu’espèce mais, dans leurs pratiques éthiques et
politiques, les hommes se proclament, se déclarent, comme genre humain.
Sans doute est-ce à juste titre que l’ethnologue et philosophe Claude Lévi-Strauss a critiqué la notion de
droits de l’homme, trop ancrée dans une philosophie de la subjectivité, du propre, de l’être moral. Il
défendait le principe d’un droit de l’homme en tant qu’être vivant, droit de l’espèce humaine entre autres
espèces. Bien entendu, on ne peut plus faire taire l’exigence pressante d’un droit des animaux. Faudrait-il

!
#!
pour autant accueillir la réclamation exorbitante, donc injuste, d’une extension des droits de l’homme aux
chimpanzés, aux gorilles, aux orangs-outans ? Non, car prendre acte de la continuité oblige en même temps à
reconnaître qu’il y a des sauts qualitatifs, ce qu’on nomme l’émergence.
Oui, il faut prendre acte de l’épreuve infligée au consensus humaniste traditionnel, mais il faut affirmer
aussi avec la philosophie que le destin de l’humain ne se laisse pas déchiffrer à partir des seuls savoirs sur
l’origine de l’homme et les gènes. Sauf à reconstituer un propre d’ordre métaphysique ou théologique, on se
gardera bien de définir l’humain. On sait depuis longtemps qu’il n’y a pas d’essence de l’homme. Il n’est pas
sûr que celui qu’on a pu désigner comme l’animal symbolique puisse se définir par l’existence, l’être pour la
mort, l’expérience d’un monde, alors que l’animal se caractériserait par sa pauvreté en monde et sa non-
représentation de la mort. Il apparaît de plus en plus clairement que les animaux ont eux aussi des
comportements symboliques et des capacités de catégorisation, qu’ils se transmettent des savoir-faire. Tel est
le mauvais coup que portent la primatologie et l’éthologie à l’humanisme métaphysique.
Nous ne pouvons pas plus croire Montaigne disant qu’il y a parfois plus de différence d’homme à homme
qu’entre un animal et un homme que Descartes faisant du langage le critère absolu de l’humain. Il faut être
une brute pour refuser aux bêtes la souffrance, le langage, l’intériorité, la subjectivité, le regard. Mais ne
risque-t-on pas de sombrer dans la bêtise si l’on s’obstine à nier que les hommes ressentent, communiquent,
expriment, produisent autrement et mieux que les plus humains des animaux ?
Par ÉLISABETH DE FONTENAY
Philosophe spécialiste de la différence entre l’homme et l’animal, elle a publié une somme, Le Silence des
bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité (Fayard, 1998). Également auteur de Sans offenser le genre
humain. Réflexions sur la cause animale (Albin Michel, 2008), elle a écrit une préface magnifique au poème
de Lucrèce (trad. A. Ernout, Les Belles Lettres, 2009).
********************
Les$rapports$hommes/animaux$
$%&!'()%&!*+,-./&!0/(!(0+10+)&!%+!2%-+30+4!5%!,-6!7!&%!&.(+%)!4-)!)-440)(!-+8!-/.,-+8!9:%!;0/(%/-<=!
">>?@=!3%&!3)A-(+)%&!A()-/B%&!C+.!4-)30+)-.%/(!6%+)!%/D.)0//%,%/(=!4-)(-B%-.%/(!6%+)!D.%=!7!3%)(-./&!
AB-)5&!6%+)!)%&&%,26-.%/(=!%(!-D%3!C+.!.6&!%/()%(%/-.%/(!5%&!)-440)(&!&0+D%/(!30,46%8%&!5E-,0+)!0+!5%!
*-./%F! G/! H-.(=! 6%! &(-(+(! 4*.60&04*.C+%=! D0.)%! )%6.B.%+8=! 5%! 6E-/.,-6! 5-/&! 6%&! B)-/5%&! 3.D.6.&-(.0/&=! -!
60/B(%,4&! 0&3.66A! %/()%! 5%+8! 30/3%4(.0/&! H0/5-,%/(-6%&!I! l’animal-homme$ et$ l’animal-objet=! 40+)!
-20+(.)! %/! H./! 5%! 30,4(%=! 5-/&! 6-! 4%/&A%! 033.5%/(-6%! -3(+%66%=! 7! +/%! 30/3%4(.0/! 46+&! 30/H0),%! 7! 6-!
&3.%/3%!,05%)/%!I!celle$de$l’animal-être$sensible.$
!
La$ conception$ de$ l’animal-homme!D0<-.(! &+)(0+(! 5-/&! 6E-/.,-6.(A! 6%&! ()-.(&! C+.! 6-! )-44)03*-.%/(!
30/&.5A)-26%,%/(! 5%! 6E*+,-/.(A! 9J*-40+(*.%)=! #KKL@F! J%6-! )%40&-.(! &0+D%/(! &+)! 5%&! %))%+)&!
5E-44)A3.-(.0/! 5+! 30,40)(%,%/(=! 30,,%! 6E-&&.,.6-(.0/! 5%! 6-! 30,,+/.3-(.0/! -/.,-6%! 7! +/! D)-.!
6-/B-B%=!3-4-26%!4-)!%8%,46%!5%!&%!)AHA)%)!7!5%&!./H0),-(.0/&!4-&&A%&=!3%!C+.!/E%&(!C+%!()M&!)-)%,%/(!
6%! 3-&F! :%&! /0,2)%+&%&! -/-60B.%&! C+%! 6E0/! 40+D-.(! 02&%)D%)!%/()%! 6%! 30,40)(%,%/(! 5%! 6E%&4M3%!
*+,-./%! %(! 3%6+.! 5E%&4M3%&! )%6-(.D%,%/(! 4)03*%&! 5%! 6+.! 9%&&%/(.%66%,%/(! 6%&! ,-,,.HM)%&! %(! 6%&!
0.&%-+8@=!0/!4-&&-.(!-2+&.D%,%/(!7!+/%!.5%/(.(AF!
$$
:%! 3%! ()-.(%,%/(! 5%&! -/.,-+8! ).B0+)%+&%,%/(! 30,,%! 5%&! *0,,%&=! +/! 5%&! %8%,46%&! 6%&! 46+&!
&4%3(-3+6-.)%&!%&(!&-/&!50+(%!les$procès$d’animaux$du$Moyen-âgeF!$0)&C+E+/!-/.,-6!-D-.(!26%&&A!0+!
(+A!+/!*0,,%=!il$était$traduit$en$justice,$défendu$par$des$avocats$et$puni$s’il$était$jugé$coupable!
%(!AD%/(+%66%,%/(!4%/5+!%/!B)-/5%!40,4%!%(!%/!4+26.3F!:+!(%,4&!5%!$0+.&!NOO=!6EAD'C+%!5EP+(+/!-D-.(!
,',%!D0+6+!excommunier$les$rats!4-)3%!C+E.6&!()-/&,%((-.%/(!6-!4%&(%F!Q)R3%!7!6-!2).66-/(%!46-.50.).%!
5%! 6%+)! -D03-(=! S-)(*A6A,<! J*-&&-/A%=! 6%&! )-(&! A3*-44M)%/(! *%+)%+&%,%/(! 7! 3%((%! ./1+&(%!
30/5-,/-(.0/!T!9S)+/0.&=!">?L@!
$$

!
U!
S%-+30+4!5%!)%6.B.0/&!0/(!A(A!%/30)%!46+&!60./F!V+.&C+%!certains$dieux$avaient$des$traits$humains=!
d’autres$ dieux$ pouvaient$ avoir$ des$ traits$ animauxF! $%&! -/.,-+8! 5.D./.&A&! -20/5%/(! 5-/&! 6%&!
)%6.B.0/&! 5%! 6EGB<4(%! P/3.%//%=! 5%! 6EO/5%=! 5+! W0+D%-+XY0/5%=! %(! ,',%! 5-/&! 6-! Q)M3%! -/(.C+%F! Z/!
()0+D%!-+&&.=!5-/&!6E-&4%3(!5%&!5.%+8=!5%!/0,2)%+8!,A6-/B%&!%/()%!*0,,%&!%(!-/.,-+8=!30,,%!6%!5.%+!
./5.%/!5%&!,-)3*-/5&!%(!5%&!D0<-B%+)&=!Q-/%&*=!C+.!40)(%!&+)!+/!30)4&!*+,-./!+/%!('(%!5EA6A4*-/(=!0+!
6%! 5.%+!B)%3! V-/=! 40+)D+! 5%! 4-((%&! 5%! 20+3F! G/H./! .6! %&(! +/%! 3)0<-/3%! )%6.B.%+&%! ()M&! )A4-/5+%! C+.!
50//%!7!6E-/.,-6!+/%!-+()%!3-)-3(A).&(.C+%!*+,-./%!I!3%66%!5%!6ER,%F!JE%&(!la$métempsycose=!3)0<-/3%!
&%60/!6-C+%66%!6%&!R,%&!4%+D%/(=!-4)M&!6-!,0)(=!&%!)A./3-)/%)!5-/&!5%&!30)4&!*+,-./&!30,,%!5-/&!5%&!
30)4&!5E-/.,-+8F!J%((%!3)0<-/3%!H0/5-,%/(-6%!5%&! )%6.B.0/&!5%!6EG8()',%XZ).%/(!-!A(A!()M&!)A4-/5+%!
-+! 30+)&! 5%! 6E*.&(0.)%! 4-)(0+(! 5-/&! 6%! ,0/5%! %(! ,',%! 3*%[! 6%&! B)%3&=! 4+.&C+%! 6%! 3A6M2)%! 4*.60&04*%!
V6-(0/=!4-)!%8%,46%=!3)0<-.(!5-/&!6-!,A(%,4&<30&%F!
$$
J%!&(-(+(!de$l’animal-homme!-!5.&4-)+!5%!6-!4%/&A%!)%6.B.%+&%!033.5%/(-6%!-D%3!6E-)).DA%!5%&!)%6.B.0/&!
,0/0(*A.&(%&=!,',%!&E.6!5%,%+)%!%/30)%!5-/&!3%)(-./%&!,A(-4*0)%&!30,,%!\!6E-B/%-+! 5%! 5.%+!]! 5+!
3*).&(.-/.&,%F!$E-/.,-6X*0,,%=!3-4-26%!5%!4-)6%)!%(!5%!&%!30,40)(%)!%8-3(%,%/(!30,,%!+/!*+,-./=!
%8.&(%!3%)(%&!%/30)%!5-/&!6-!4%/&A%!033.5%/(-6%=!,-.&!7!(.()%!5%!H.3(.0/=!5-/&!6%&!H-26%&=!5-/&!6%&!5%&&./&!
-/.,A&!0+!5-/&!6%&!)0,-/&!5%!&3.%/3%XH.3(.0/F!Le#loup!5%!$-!;0/(-./%!0+!6%!Mickey!5%!^-6(!:.&/%<!/E0/(!
4-&!46+&!5E%8.&(%/3%!)A%66%!C+%!6%&!3*.%/&!5+!)0,-/!5%!J6.HH0)5!_.,-`=!C+.!&+33M5%/(!-+8!*0,,%&!5-/&!
6-!B%&(.0/!5%!6-!3.D.6.&-(.0/F!
$
L’animal$–$objet$$:$
$$
P! 6E0440&A=! 40+))-.(X0/! 5.)%=! &%! &.(+%! 6-! 30/3%4(.0/! C+.! D0.(! 5-/&! 6%&! -/.,-+8! 5%&! 021%(&F!
V-)-508-6%,%/(!3%((%!30/3%4(.0/!-!60/B(%,4&!30*-2.(A!-D%3!3%66%!5%!6E-/.,-6X*0,,%F!G/!%HH%(=!&.!6%&!
5%+8! 30/3%4(.0/&! /0+&! 4-)-.&&%/(! -+10+)5E*+.=! 7! 6E*%+)%! 5%&! 5)0.(&! 5%! 6E*0,,%=! 30,46M(%,%/(!
0440&A%&=!3%!/EA(-.(!4-&!6%!3-&!5+)-/(!(0+(%&!6%&!4A).05%&!5%!6E*.&(0.)%!0a!6E%&36-D-B%!A(-.(!4%)b+!30,,%!
+/%!4)-(.C+%!&03.-6%!\!/0),-6%!]!%(!0a=!4-)!&+.(%=!6%&!*0,,%&!%+8X,',%&!A(-.%/(!()-.(A&!30,,%!5%&!
021%(&F!
$$
_.! 50/3! +/%! 3%)(-./%! 30/H+&.0/! -! 60/B(%,4&! %8.&(A! %/()%! 6E-/.,-6X*0,,%! %(! 6E-/.,-6X021%(=! 3%((%!
30/H+&.0/! -! 5.&4-)+! 7! 6EA40C+%! ,05%)/%! %/! Z33.5%/(F! J%! &0/(! 4)./3.4-6%,%/(! 6%&! (*M&%&! 5%! René$
Descartes!%(! 5%! &%&! &+33%&&%+)&! C+.! &0/(! 7! 6E0).B./%! 5%! 6-! 30/3%4(.0/! ,05%)/%! 5%! 6E-/.,-6X021%(!
9J*-40+(*.%)=! #KKK@F! V0+)! :%&3-)(%&=! 6%! 30)4&=! 3%6+.! 5%! 6E*0,,%! 30,,%! 3%6+.! 5%! 6E-/.,-6=! &0/(! 5%&!
,-3*./%&F!Y-.&!6E'()%!*+,-./=!30/()-.)%,%/(!7!6E-/.,-6=!A3*-44%!7!&0/!&(-(+(!5%!4+)%!,-3*./%!4-)3%!
C+E.6!40&&M5%!-+&&.!+/%!R,%F!C’est$le$«$dualisme$»$cartésien$de$l’âme$et$du$corpsF!_+)!6%!46-/!5%!6-!
4*.60&04*.%! 4+)%=! :%&3-)(%&! /E-D-.(! 4-&! 30,46M(%,%/(! (0)(! %/! -&&.,.6-/(! 6%! 30)4&! 7! +/! &<&(M,%!
,-(A).%6F!c0+(%!6-!2.060B.%!,05%)/%!)%40&%!5%!H-.(!&+)!6%!40&(+6-(!C+%!6%!30)4&!%&(!+/!&<&(M,%!,-(A).%6!
-/-6<&-26%!%(!30//-.&&-26%!4-)!6-!&3.%/3%F!Y-.&!6E-+()%!*<40(*M&%!5%!:%&3-)(%&!&%60/!6-C+%66%!6E-/.,-6!
/%! 5.&40&-.(! 4-&! 5E+/%! \!R,%!]! -! -,%/A! &%&! &+33%&&%+)&! 7! ()-.(%)! 6%&! -/.,-+8! 30,,%! 5%&! %/(.(A&!
5A40+)D+%&!5%!&%/&.2.6.(A=!3%!C+.!-!30/5+.(!7!+/!5A&-&()%!,0)-6F!Z/!4%+(!4%/&%)!C+%!:%&3-)(%&=!,0)(!
)%6-(.D%,%/(! 1%+/%=! /E-! 4)02-26%,%/(! 4-&! %+! 6%! (%,4&! 5%! 4)A3.&%)! &+HH.&-,,%/(! 3%! 40./(! 5%! 6-!
&%/&.2.6.(A! 5%&! -/.,-+8F! Y-.&! 3E%&(! &+)(0+(! 6%! &+33%&&%+)! 5%! :%&3-)(%&=! Malebranche,!C+.! -! 40+&&A!
1+&C+E7!6-!3-).3-(+)%!6-!(*M&%!5%&!-/.,-+8X,-3*./%&F!JE%&(!6+.=!Y-6%2)-/3*%!C+.!2-((-.(!&0/!3*.%/!%(!C+.=!
C+-/5!6-!4-+D)%!2'(%!-20<-.(=!30/&(-(-.(!H)0.5%,%/(!:#«#Regardez,#c’est#exactement#comme#une#horloge#
qui# sonne# l’heure#!#»!:%4+.&=! 6%&! 40&.(.0/&! \!40&(X3-)(A&.%//%&!]! 0/(! %/D-*.! 6-! 4%/&A%! 033.5%/(-6%! %(!
6E.5A%! C+%! 6%&! -/.,-+8! &0/(! 5%&! ,-3*./%&! &-/&! -+3+/%! &%/&.2.6.(A=!50/3!5%&!021%(&=!5%&!3*0&%&=! <! %&(!
%8()',%,%/(!)A4-/5+%F!d+-/5!0/!%/(%/5!5.)%!I!\!P4)M&!(0+(!3%!/E%&(!C+E+/%!2'(%!T!]!40+)!1+&(.H.%)!6%&!
4.)%&! &AD.3%&! &+)! 6%&! -/.,-+8=! 3E%&(! +/%! -504(.0/! &03.-6%! 5%! 3%&! (*M&%&! 40&(X3-)(A&.%//%&! C+%! /0+&!
%/(%/50/&! H0),+6%)F! $-! &03.A(A! 5%! 30/&0,,-(.0/! -! 5E-.66%+)&! 30,46M(%,%/(! ./(AB)A! 3%&! (*M&%&! %/!
H-.&-/(! 5%! 6E-/.,-6X021%(=! +/! -/.,-6X,-)3*-/5.&%F! d+-/5=! 4-)! %8%,46%=! %/! H-3%! 5%&! ,0/(-B/%&! 5%!
3-5-D)%&!5E-/.,-+8!5%!6-!H.MD)%!-4*(%+&%=!0/!-HH.),%!I!\!JE%&(!(0+(!7!H-.(!6AB.(.,%!I!3%6-!30e(%!,0./&!3*%)!
5%!6%&!(+%)!C+%!5%!6%&!D-33./%)!T!]=!0/!/%!H-.(!C+%!()-/&40&%)!7!+/!50,-./%!A30/0,.C+%!6%!,05M6%!40&(X
3-)(A&.%/!5%!6E-/.,-6X021%(F!G(=!7!C+%6C+%&!%83%4(.0/&!9)A3%/(%&@!4)M&=!6%&!(%8(%&!1+).5.C+%&!30/&-3)%/(!
-+&&.!6%!&(-(+(!5E021%(!%(!5%!,-)3*-/5.&%!5%!6E-/.,-6!9P/(0./%=!#KKf@F!

!
L!
$$
L’animal$-$être$$$
$$
Y-.&=! ,',%! &.! 6%! ,05M6%! 5%! 6E-/.,-6X021%(! )%&(%! %/30)%! ()M&! 4)A&%/(! 5-/&! /0&! &03.A(A&! 033.5%/(-6%&=!
+/%!-+()%!30/3%4(.0/=!2%-+30+4!46+&!30*A)%/(%!-D%3!6%&!30//-.&&-/3%&!&3.%/(.H.C+%&!,05%)/%&!9W0+g(!
%(! J*-40+(*.%)=! #KKh@=! -! D+! 6%! 10+)! %(! &%! )A4-/5! 5%! 46+&! %/! 46+&!I! celle$ de$ l’animal-être$ sensible!
9S+)B-(=! #KKh@F! G/! %HH%(=! 6%&! 4)0B)M&! 5%! 6-! 30//-.&&-/3%! &3.%/(.H.C+%! 0/(! -,%/A! 7! +/%! ,%.66%+)%!
30//-.&&-/3%! 5%! 6-! ,-/.M)%! 50/(! \!H0/3(.0//%!]! 6%&! 30)4&! 5%&! -/.,-+8! %(! 6%! 30)4&! 5%&! *0,,%&F! J%&!
4)0B)M&!&0/(!5E-.66%+)&!H0/5A&!&+)!6-!)%3*%)3*%!2.060B.C+%!%84A).,%/(-6%!%66%X,',%=!50/(!6%&!4)./3.4%&!
0/(!A(A!5A3).(&!-+!NON%,%!&.M36%!4-)!J6-+5%!S%)/-)5!9S%)/-)5=!">i#@=!%(!50/(!6%&!2-&%&!&0/(=!30,,%!0/!
6E-!D+=!40&(X3-)(A&.%//%&!I!6%&!30)4&!D.D-/(&=!&<&(M,%&!,-(A).%6&=!&0/(!-/-6<&-26%&!%(!30//-.&&-26%&!4-)!
6E%84A).,%/(-(.0/F! Z)! 3%&! 4)0B)M&! 5%! 6-! 30//-.&&-/3%! &3.%/(.H.C+%! 0/(! 5A,0/()A! 6E%8()-0)5./-.)%!
)%&&%,26-/3%!5+!H0/3(.0//%,%/(!5%&!30)4&!-/.,-+8!%(!*+,-./&F!:-/&!(0+&!6%&!50,-./%&!9BA/A(.C+%=!
4*<&.060B.%=!4-(*060B.%=!)A-3(.0/&!A,0(.0//%66%&=!%(!,',%!3-4-3.(A&!3+6(+)%66%&!30,,%!6%!,-/.%,%/(!
5E0+(.6&!0+!6%&!3*0.8!%&(*A(.C+%&!9J*-40+(*.%)=!#KK>@j@!6E*0,,%!&E-DA)-.(!+/!-/.,-6F!Y.%+8!C+%!3%6-=!
6-!(*A0).%!5%!6EAD06+(.0/!,0/()-.(!C+%!6E*0,,%!A(-.(!+/!-/.,-6!4-)(.3+6.%)=!.&&+!5+!B)0+4%!5%&!4).,-(%&!
%(!4)03*%!4-)%/(!5%&!3*.,4-/[A&F!J%)(%&!6E'()%!*+,-./=!50(A!5E+/!3%)D%-+!()M&!4%)H0),-/(=!&E-DA)-.(!+/!
3*.,4-/[A!%83%4(.0//%66%,%/(!./(%66.B%/(=!%(!3%((%!./(%66.B%/3%!5%!6E\!*0,,%!&-D-/(!]!9Homo#sapiens@=!
30,,%! .6! &E%&(! /0,,A! 6+.X,',%=! 6+.! -D-.(! 4%),.&! 5%! 50,./%)! 6%! ,0/5%F! Y-.&! %/! 3%! C+.! 30/3%)/%! 6-!
&%/&.2.6.(A=!6-!3-4-3.(A!7!A4)0+D%)!5%!6-!50+6%+)=!6%&!5.HHA)%/3%&!%/()%!6E*0,,%!%(!6%&!9-+()%&@!-/.,-+8!
A(-.%/(!(0+(!7!H-.(!,-)B./-6%&!I!*0,,%!%(!9-+()%&@!-/.,-+8!&0/(!(0+&!5%&!\!'()%&!&%/&.26%&!]F!
$$
:E0a!H./-6%,%/(!6E.5A%=!H0)(%,%/(!A(-<A%!4-)!6-!&3.%/3%!,05%)/%=!C+%!6E-/.,-6!%&(!+/!\!'()%!&%/&.26%!]=!
()M&! 5.HHA)%/(! 5%! 6E*0,,%! 5-/&! &%&! 3-4-3.(A&! ./(%66%3(+%66%&=! mais$ semblable$ à$ l’homme$ dans$ son$
aptitude$ à$ ressentir$ la$ douleur$ (P+HH)%(!k-/!:%)!l%,4!%(!W0+g(=!#KK?@F!G/!-+3+/!3-&!+/!021%(=!-+!
&%/&! 40&(X3-)(A&.%/! 5+! (%),%F! O6! &E%/&+.(! C+%! 6E-/.,-6! 5%D)-.(! -D0.)=! 5-/&! 6-! 4)-(.C+%! %(! 5-/&! 6-! 60.!
9P/(0./%=!#KKf@=!+/!&(-(+(!4-)(.3+6.%)=!6.A!7!&-!/-(+)%!5E-/.,-6!&%/&.26%F!JE%&(!6-!)-.&0/!5E+/!,0+D%,%/(!
C+.!&%!5AD%6044%!-3(+%66%,%/(!%/!H-D%+)!5%!\!5)0.(&!5%!6E-/.,-6!]=!5)0.(&!C+.!&%)-.%/(!3%)(%&!5.HHA)%/(&!
5%&! 5)0.(&! 5%! 6E*0,,%=! ,-.&! 30/&-3)%)-.%/(! 36-.)%,%/(! 6-! 5.HHA)%/3%! %/()%! 6E-/.,-6! %(! 6-! 3*0&%!
9J*-40+(*.%)=!#KKL@F!!!
$%&!5)0.(&!5%!6E-/.,-6!5.HHA)%)-.%/(!5%!3%+8!5%&!4%)&0//%&!,0)-6%&!4-)! 6%!H-.(!,',%!5%! 6-!&%/&.2.6.(A!
5%&! -/.,-+8=! C+.! )A36-,%! 5%&! ,%&+)%&! 5%! 4)0(%3(.0/! 4-)(.3+6.M)%&F! O6&! &E%/! )-44)03*%)-.%/(! %/!
)%D-/3*%! 4-)! 6%! H-.(! C+%=! 30,,%! 5E-.66%+)&! 40+)! 3%)(-./&! *+,-./&! ./3-4-26%&! 5%! &%! )%4)A&%/(%)! %+8X
,',%&=!3%&!5)0.(&!/%!40+))-.%/(!'()%!5AH%/5+&!C+%!4-)!5%&!)%4)A&%/(-/(&!0+!5%&!,A5.-(%+)&!*+,-./&F!
d+-/(! -+! 30/(%/+!4)A3.&! 5%! 3%&! 5)0.(&=! &%60/! C+E.6! &E-B.)-.(! 5E-/.,-+8! AD06+A&! 0+! /0/! 5-/&! 6EA3*%66%!
4*<6A(.C+%=! 5E-/.,-+8! &-+D-B%&! 0+! 50,%&(.C+A&=! 5E-/.,-+8! 30,,+/&! 0+! %/! D0.%! 5%! 5.&4-).(.0/=! .6!
-44-)(.%/5)-! -+8! 6AB.&6-(%+)&! 5+! H+(+)! 5%! 6%&! H.8%)=! 5-/&! +/! ,0+D%,%/(! 2.%/! -,0)3A! 5A17! D%)&! 6%!
)%&4%3(!5%!6E-/.,-6=!%(!C+.!H%)-.(!&+.(%!-+8!/0,2)%+&%&!60.&!5A17!%/!46-3%!5-/&!6%&!4-<&!033.5%/(-+8F!

!
i!
Les dualistes et les continuistes
Les dualistes, partisans de la frontière homme-animal
La Genèse
C’est dans l’Ancien Testament qu’on trouve, avec la Création, le fondement théologique de la séparation
entre l’homme et l’animal. Au quatrième jour, Dieu crée les animaux aquatiques et les oiseaux ; au
cinquième jour, les animaux terrestres. Le lendemain, « Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute
la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre » (1, 20-27).
Le stoïcisme (env. IIIe au Ier s. av. J.-C.)
Pour les stoïciens, l’homme est capable d’actions produites par sa seule raison, alors que l’animal est
toujours contraint par la nécessité naturelle, par l’« instinct ». Doué d’une âme, capable de sensations,
l’animal reste exclu, de Chrysippe à Sénèque, de la société des êtres de raison qui regroupe les hommes et les
dieux. Cicéron écrit : « Le porc, que fournit-il en dehors de sa chair ? C’est pour qu’elle ne pourrît pas que
l’âme lui a été donnée en guise de sel » (De la nature des dieux, 44).
René Descartes (1596-1650)
Jusqu’à Descartes, personne ne nie que les bêtes aient une âme : la querelle porte sur la faculté de l’âme des
bêtes à accéder aux plus hautes fonctions de la raison humaine. Chez Descartes, l’âme n’a plus de fonction
vitale, son seul attribut est la pensée. Il assimile donc les animaux à des machines très sophistiquées,
produites par Dieu. Seul l’homme est doué d’une raison, dont la parole est la manifestation.
Emmanuel Kant (1724-1804)
Dans la Critique de la raison pratique, Emmanuel Kant fait de la moralité le critère de la différence radicale
qui sépare l’homme de l’animal. L’homme, contrairement à l’animal, est capable de choix rationnel et
d’action morale. Kant fonde l’humanité sur la loi morale, qui est comme la marque de Dieu en l’homme et
lui confère sa dignité.
Martin Heidegger (1889-1976)
L’homme n’est pas un animal « plus » (langage, raison…), c’est un existant, « toujours déjà » projeté dans un
monde. L’animal reste « pauvre en monde », qui ne se représente pas le monde dans son ensemble, mais
évolue dans un « environnement ». « La pierre est sans monde, l’animal est pauvre en monde, l’homme est
configurateur de monde » (Les Concepts fondamentaux de la métaphysique).
Les continuistes, opposants à la frontière homme-animal
Aristote (384–322 av. J.-C.)
Pour les Grecs antiques, tout ce qui vit est pourvu d’un principe vital, la « psyché », terme que nous
traduisons par « âme », du latin anima, d’où dérive « animal ». Dans le Traité de l’âme, Aristote explique que
la plante, qui n’est capable que de se nourrir et de se reproduire, est douée d’une âme végétative ; l’animal,
qui possède sensation, désir et mouvement, a une âme sensitive ; l’homme, enfin, a une pensée, donc une
âme intellective. De la plante à l’animal et à l’homme, il y a à la fois continuité et hiérarchie. De plus,
l’homme appartient aux espèces grégaires et se donne une organisation sociale, c’est pourquoi il est
un « animal politique » (Politique).
Plutarque (50-125)
Il s’est opposé aux théories stoïciennes sur la prééminence de l’homme. D’après ses observations, les
animaux font des actions qui témoignent d’une intelligence et d’une réflexion similaires à celles de l’homme.
Dans le dialogue « Que les bêtes brutes usent de raison » (Œuvres morales), il conclut à la supériorité de
celles-ci sur le plan de la fidélité, de la tempérance ou encore de l’amour pour leur progéniture.
Montaigne (1533-1592)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%