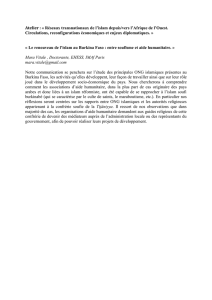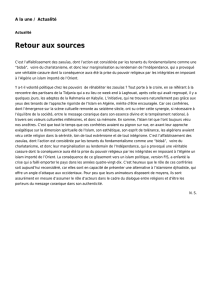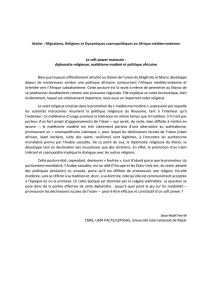confreries et pratiques traditionnelles

Page 1 sur 71
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATION ORIENTALES
CONFRERIES ET PRATIQUES
TRADITIONNELLES
DANS
L'ISLAM MAROCAIN DU
XIIE AU XXE SIECLE
PAR JALILA SBAÏ
MEMOIRE DE RECHERCHE ET D’ETUDES APPLIQUEES DE CIVILISATION ISLAMIQUE ET CULTURES
MUSULMANES.
SOUS LA DIRECTION DE : MONSIEUR GUY NICOLAS, PROFESSEUR, INALCO. SEPTEMBRE, 1993.

Page 2 sur 71
Système de transcription
Nous avons retenu la graphie française usuelle pour les noms des villes et des régions, Fès,
Marrakech, Meknès, Doukkala.
Il en est de même pour les termes passés dans le dictionnaire français : soufi, soufisme, Coran,
chérif.
Nous avons choisi la graphie de l'encyclopédie de l'islam pour les termes suivants :
zawiya, charifisme, Makhzan, Alawite, Ulamas, Mulud.
terme ou d'un nom propre varie suivant qu'elle est celle du parler
marocain, ou de l'arabe littéral.
Pour ces termes ou ces noms, nous avons préféré garder la prononciation en marocain pour la
graphie : chorfa, çandouk, rbia, etc.
Table de translittération
Consonnes :
b - z - q -
t - s - k -
th - sh - g -
j - ç - l -
h - d - m -
kh - - n -
d - gh - h -
dh - f - w -
r - y -
Voyelles :
a -
i -
u -
à - î - ou -

Page 3 sur 71
TABLE DES MATIERES
Système de transcription ......................................................................................................................................................................... 2
Table de translittération .......................................................................................................................................................................... 2
INTRODUCTION .........................................................................................................................................................5
P R E M I E R E P A R T I E ..........................................................................................................................................9
LES CONFRERIES MAROCAINES : ORIGINES DOCTRINAIRES ET DEVELOPPEMENT DU XIIÈ AU XXÈ
SIECLE ...................................................................................................................................................................9
CHAPITRE I ...............................................................................................................................................................10
LES RIBATS ET LES PREMIERES CONFRERIES ..........................................................................................................10
I. LES RIBATS : LIEU D'ELABORATION DE DOCTRINES ........................................................................................10
A. La conception de l'Islam chez les Almoravides .................................................................................................................. 10
B. La doctrine des Almohades ................................................................................................................................................. 12
II. LES ZAWIYAS ET LES PREMIERES CONFRERIES RELIGIEUSES ..........................................................................13
A. La naissance des premières confréries ............................................................................................................................... 13
B. Les confréries issues de la doctrine qadiri (voir tableau p.22) .......................................................................................... 16
CHAPITRE II..............................................................................................................................................................20
L'AGE D'OR DES ZAWIYAS ............................................................................................................................................20
I. LE CHARIFISME ..............................................................................................................................................20
A. La naissance du charifisme.................................................................................................................................................. 20
B. Conséquences du charifisme .............................................................................................................................................. 21
II. LE REVEIL RELIGIEUX : AL JAZOULI ET LE DEVELOPPEMENT DES ZAWIYAS ....................................................23
A. La doctrine de Jazouli et le Jihad ................................................................................................................................... 23
B. La fin des Saadiens et le pouvoir des Zawiyas .................................................................................................................... 24
CHAPITRE III.............................................................................................................................................................27
LES CONFRERIES MAROCAINES DU XVE AU XXE SIECLE ...........................................................................................27
I. LES CONFRERIES PROCEDANT DE L'ENSEIGNEMENT DE JAZOULI ...................................................................27
A. Les confréries nées du XVE au XVIIE siècle ..................................................................................................................... 27
B. Les confréries nées du XVIIIe au XXe siècle ......................................................................................................................... 31
II. LE MAKHZAN ET LES CONFRERIES AU XIX SIECLE ET AU DEBUT DU XX SIECLE ...............................................33
A. Une tentative d'introduction du wahabisme au Maroc .................................................................................................... 33
B. L'intervention du Makhzan dans les affaires internes des zawiyas ............................................................................. 34
DEUXIEME PARTIE PRATIQUES CONFRERIQUES CULTE DES SAINTS ET CHAMP RELIGIEUX ACTUEL ......................36
CHAPITRE I ...............................................................................................................................................................37
LES CONFRERIES ET LEURS PRATIQUES ............................................................................................................................37
I. La Tariqa Aissaouiya et la confrérie des Gnawa .............................................................................................37

Page 4 sur 71
A. La Tariqa Aissaouiya : .......................................................................................................................................................... 37
B. Le rite initiatique chez les Gnawa : ..................................................................................................................................... 39
II. Les pratiques des Aissaoua et des Gnawa .....................................................................................................40
A. Les pratiques extérieures des Aissaoua.............................................................................................................................. 40
B. Hadras et pratiques chez les Gnawa ................................................................................................................................... 43
CHAPITRE II..............................................................................................................................................................47
LES PRATIQUES LIEES AU CULTE DES SAINTS .....................................................................................................................47
I. La multiplicité des Saints ...............................................................................................................................47
A. La hiérarchie des Saints ....................................................................................................................................................... 47
B. Autres catégories de Saints : ............................................................................................................................................... 49
II. RITES ET USAGES RELATIFS AU CULTE DES SAINTS ..........................................................................................................52
A. Les ziaras individuelles ........................................................................................................................................................ 52
B. Les pèlerinages collectifs ..................................................................................................................................................... 55
CHAPITRE III.............................................................................................................................................................59
L'ACTUEL CHAMP RELIGIEUX AU MAROC.........................................................................................................................59
I. La contestation du pouvoir au nom de l'Islam................................................................................................59
A. Islam réformé de la première génération .......................................................................................................................... 59
B. Le mouvement islamiste ..................................................................................................................................................... 60
II. Le champ religieux au Maroc........................................................................................................................62
A. Le corps des Ulamas ............................................................................................................................................................ 63
B. Vers un nouveau champ religieux....................................................................................................................................... 64
CONCLUSION ...........................................................................................................................................................67
BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................................................69
ARTICLES ..............................................................................................................................................................69
OUVRAGES ...........................................................................................................................................................70

Page 5 sur 71
INTRODUCTION
Le monde musulman connait depuis un siècle des mouvements réformateurs : le pan-islamisme,
les réformateurs salafiyya et l'islamisme. Le pan-islamisme avait pour principale objectif la défense
du califat ottoman, en utilisant l'islam comme idéologie de l'union et de la mobilisation de
l'ensemble des musulmans. Les réformistes Salafiyya s'étaient surtout préoccupés du retour aux
sources de l'islam afin de les repenser en fonction des problèmes . Aujourd'hui,
l'islamisme qui est un mouvement de contestation politico-religieux vise la prise du pouvoir afin
de construire des Etats islamiques qui auraient pour seul fondement la chari'a.
Le Maroc n'a pas adhéré à ces mouvements ; certes il a eu des représentants comme Allal al Fassi
pour les Salafiyya, ou comme Abdessalam Yacine pour les Islamistes. Est-ce parce que le Maroc
a un commandeur des croyants (Amir al Muminin) descendant du prophète et chef spirituel de la
communauté ? Ou est- côté
a d'autres sensibilités religieuses, à savoir le culte des Saints, l'adhésion aux confréries et le profond
respect accordé aux Chérifs ou encore parce que le Maroc possède un corps de Ulamas pouvant
jouer un rôle d'intermédiaire entre l'Etat et le peuple ?
Les discours théologico-politiques des islamistes semblent pousser les Marocains musulmans vers
des pratiques traditionnelles.
En effet, les musulmans marocains qui sont sunnites de rite Malékite sont de plus en plus nombreux
à effectuer le pèlerinage à la Mecque. Leur vie religieuse est ponctuée par les fêtes coraniques de
l'Islam : outre la fête du mouton ou "Aïd al Kabîr", et la fête de la fin du ramadan ou "Aïd as
Saghir", les marocains célèbrent la fête de la nativité du prophète ou "Mulud", instaurée au Maroc
depuis l'époque Mérinide, et celle de "l'Ashura" fêtée le 10 Muharram et qui commémore le martyr
de Hussein à Karbala; les "ziaras" (visites) aux tombeaux des Saints pendant ou hors la période des
moussems
1
rythment aussi la vie religieuse des marocains.
Mais ce qui caractérise le plus l'Islam marocain, ce sont les confréries religieuses, qui sont en assez
grand nombre et estimés selon nous à vingt et une confréries.
Certaines recrutent dans les milieux lettrés ou aisés, dans les villes et les campagnes, telles la
Tijaniya et la Derqawiya. D'autres dans les milieux populaires, telles celles des Jilala et des
Aissaoua ; et quelques-unes recrutent exclusivement dans une catégorie particulière de la société,
ainsi les rma confrérie de tireurs, et les Gnawa confrérie de noirs.
Ces aspects qui caractérisent l'Islam marocain trouvent leur source dans le processus d'islamisation
du Maroc. Les conquêtes arabes du VIIe siècle eurent lieu dans un pays peuplé de tribus berbères.
Les Ghomara étaient installés sur le littoral méditerranéen, les Barghawta sur la côte atlantique
entre le détroit de Gibraltar et l'embouchure du Sbou, les Meknasa dans la région centrale, les
Masmuda sur le versant occidental du grand atlas et sur le littoral, les Haskura entre le Sebou et le
Souss, les Lemta entre le Sous et le Draa (Sahara occidental). La situation religieuse de ces tribus
1
Moussem : une fois par an, a lieu au tombeau de chaque Saint une sorte de fête patronale. Les moussems sont
aujourd'hui annoncés et filmés par les médias marocains qui en diffusent des extraits dans les journaux télévisés.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
1
/
71
100%