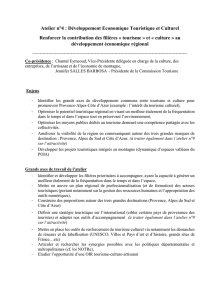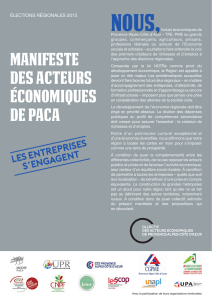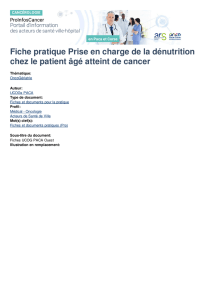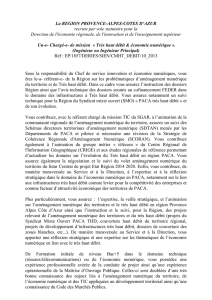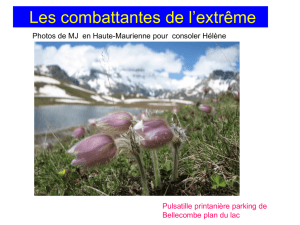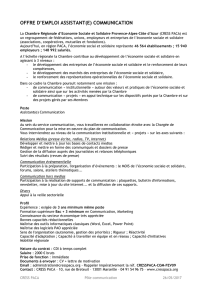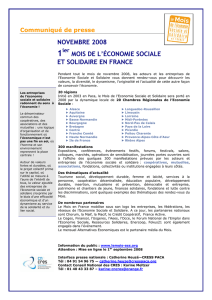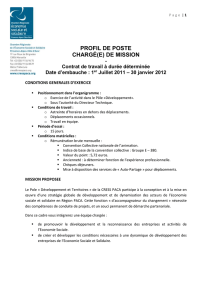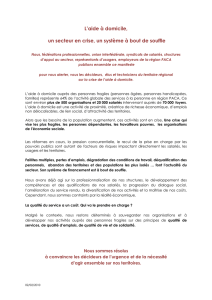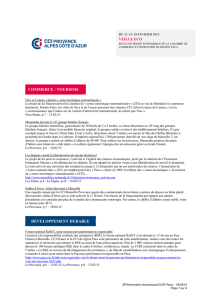De l`art et la manière de répondre aux nouveaux besoins sociaux

De l’art et la manière de répondre
aux nouveaux besoins sociaux :
Une démarche d’accompagnement
à l’innovation sociale en PACA
N°05
Septembre 2014
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a lancé en janvier
2013 un programme expérimental de soutien à l’innovation sociale dans
les territoires. Conçu autour d’une méthodologie innovante, reposant
sur l’identification, le prototypage et la mise en œuvre collective d’une piste
d’innovation sociale, ce programme a associé quatre territoires pilotes : Bretagne,
Limousin, Provence Alpes Côte d’Azur et Picardie, à travers la mobilisation des
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Ce
document constitue un point d’étape de la première année de mise en œuvre du
programme en Provence Alpes Côte d’Azur.
L’objectif du programme piloté par la
DGCS était triple :
Associer les services déconcentrés
de l’Etat à l’ingénierie de l’innovation
sociale dans les territoires, conformé-
ment aux missions d’un Etat « stra-
tège » et « facilitateur »,
Contribuer au renforcement, ou à
l’émergence, d’écosystèmes régio-
naux favorables à l’innovation sociale,
associant non seulement les collectivi-
tés territoriales et les acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire mais égale-
ment les associations et les usagers
ou bénéciaires présents et futurs,
Expérimenter des méthodes à travers
le repérage et l’accompagnement de
pistes d’innovation sociale concrètes.
Le programme s’est déroulé en 3
phases :
une formation initiale à destination
des agents de l’Etat ainsi que l’iden-
tication pour chaque territoire, d’un
champ d’innovation sociale privilégié,
Une phase d’accompagnement en
régions, articulée autour de l’organi-
sation de trois ateliers thématiques et
participatifs an d’assurer :
- l’identication concertée et l’évalua-
tion ex ante d’une piste d’innovation
sociale ;
- la mise à disposition de ressources
humaines, intellectuelles et nan-
cières en ingénierie de projet,
- le prototypage du dispositif d’innova-
tion sociale et sa mise en œuvre.
par
Nadine RICHEZ-BATTESTI
Maitre de conférences,
Aix-Marseille-Université,
Laboratoire d’économie
et de sociologie du travail,
Thomas GUERIN
Chargé de mission à
la chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire
Provence Alpes Côte d’Azur,
Léopold CARBONNEL
Responsable du pôle « observation,
contrôle, évaluation, ingénierie »,
à la direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
Provence Alpes Côte d’Azur
Isabelle FOUQUE
Chargée de mission à
la direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
Provence Alpes Côte d’Azur

23
Pour le projet de plateforme de matériaux solidaire porté par les
Compagnons Bâtisseurs, il s’agissait de permettre la collecte de maté-
riels et de matériaux auprès d’entreprises an de permettre le bouclage de
chantiers de réhabilitation thermique de foyers en précarité énergétique.
Ce projet reposait sur le diagnostic des logements et l’accompagnement
des familles en difcultés par les CBP mais également l’ensemble des opé-
rateurs locaux intervenant dans le champ de la Lutte contre la Précarité
Energétique (LPE), les dons des entreprises, enn le bouclage des chan-
tiers grâce à l’attribution des dons à travers une commission réunissant les
partenaires du projet.
Cette plateforme a pour objectif de récupérer des matériaux de construc-
tion, d’isolation thermique et des équipements de chauffage, de ventila-
tion, et d’économie d’eau (mais également de l’électroménager performant)
auprès des entreprises an d’en faire bénécier les personnes ayant de
faibles revenus.
Le second projet porté par l’association CitizenShip (envisageant une
conversion en entreprise d’insertion) visait le recyclage de container
maritime autour de divers usages notamment à des ns d’habitation ou
d’activités collectives.
Très vite ce projet, compte tenu des difcultés liées à son implantation
(contraintes liées au foncier), a nécessité un accompagnement fort des
pouvoirs publics. A donc été proposé par les services de la Préfète dé-
léguée à l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône le chantier de la
Savine qui, à travers la mise en place d’une « maison de projet » au cœur
de ce quartier difcile, offre l’opportunité d’une expérimentation du produit
« container » dans le secteur du logement social, bien que celle-ci, le cas
échéant, ne soit pas ciblée sur un usage d’habitation.
LIENS VERS LES SITES
Compagnons bâtisseurs www.compagnonsbatisseurs.org
Citizenship www.citizenship.fr
Pour en savoir plus, un lm a été réalisé par l’asso-
ciation Tabasco Vidéo et retrace les différentes étapes
sur les deux projets : http://www.paca.drjscs.gouv.
fr/De-l-art-et-la-maniere-de-repondre.html
1 - Les critères de sélection étaient les suivants : La réponse apportée à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, le caractère distinctement nouveau, sur ce territoire,
de la réponse apportée, et sa nature expérimentale, l’implication des parties prenantes dans la conception/la mise en œuvre, la capacité à produire un impact social tan-
gible, l’existence de porteurs de projets atypiques, ou de coopérations nouvelles entre des acteurs d’habitude cloisonnés, les partenariats entre acteurs publics, privés
de l’ESS seront privilégiés.
2 - Composition : DRJSCS PACA, SGAR (Préfecture de Région), Préfecture des Bouches-du-Rhône (PDEC), Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, Conseil
Régional PACA, Nadine Richez-Battesti (chercheure, LEST, Université Aix-Marseille), Fondation MACIF , ADEME, CCM.
3 - Les deux associations ont reçu chacune une subvention de 10 000 euros de la préfecture de région.
Numéro 05
Sept 2014
Numéro 05
Sept 2014
Enn, une phase de retours d’ex-
périence et d’évaluation .
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un
appel à pistes d’innovations sociales
a été lancé conjointement par la
DRJSCS, le Secrétariat Général aux
Affaires Régionales (Préfecture de
Région) et la CRESS PACA début
mars 2013. Une grille de critères
qualiant une innovation sociale,
élaborée par la CRESS, a été jointe
à l’appel1. Le choix s’est porté sur un
territoire ciblé (l’aire métropolitaine
d’Aix-Marseille) et sur le champ de
la précarité énergétique, riche en
besoins non satisfaits et en initia-
tives innovantes. Un comité de pilo-
tage, constitué à cet effet2, a rete-
nu deux projets (sur 8 propositions)
qui ont fait l’objet d’un accompagne-
ment spécique.
Retour sur la méthode
d’accompagnement
Au-delà du soutien nancier de
l’Etat à ces deux projets3, l’apport
majeur du programme consistait en
la mise à disposition d’une ingénie-
rie de projet spécique en innova-
tion sociale, mise en œuvre par le
cabinet Yellow Windows.
La méthode déployée est avant tout
une démarche de co-conception
inspirée du design de service. C’est
d’abord un travail collectif visant la
construction d’une communauté de
pratiques. Elle s’appui sur un certain
nombre d’outils et de méthodes
(penser visuellement, connaitre les
usagers,…) qui ont été mis en œuvre
au sein des 3 ateliers réalisés par
projet, soit : jeux de rôle, travail en
petits groupes, manipulation d’ob-
jets (lego, cartons), de magazines,
eurs de lotus (technique dérivée du
brainstorming qui favorise la pensée
créative à base de manipulation
de post it sur lesquels chacun peut
écrire et décliner des idées).
Malgré certaines réticences dans
leurs usages par les acteurs ces
techniques ont permis de position-
ner chacun de façon égalitaire et
créative.
Qu’est-ce que
le design de service ?
C’est une activité de conception
qui organise des informations et
des situations an d’en augmenter
l’efcacité, la perception et la
qualité. Le rôle du designer de
service est d’assurer l’utilisation
optimale d’un service
en soignant l’interface
et la relation entre l’usager
et le produit.
Il s’agit de partir de l’expérience
des utilisateurs pour mieux cerner
leurs besoins et développer
de nouvelles expériences
et de nouveaux services.
Les effets du programme :
quand la co-construction
renforce la crédibilité,
la cohérence et la faisabilité
des projets
Pour les Compagnons Bâtisseurs :
un modèle économique précisé
Le bilan de la mise en œuvre du projet
a en particulier mis en évidence une
évolution du cadrage vers l’élabora-
tion d’un véritable service intégré,
ont en particulier mis en évidence
l’évolution du cadrage du projet vers
l’élaboration d’un véritable service
intégré, à destination de trois caté-
gories d’usagers :
1. Les bénéciaires naux (foyers
à revenus modestes visant des
travaux de rénovation, en particulier
aux ns de réduire leur facture éner-
gétique) ;
2. Les artisans associés au fonc-
tionnement de l’entrepôt via le don
d’heures de travail, voire de maté-
riaux, en échange de l’accès à
de nouveaux publics solvables et
d’un accompagnement, via l’en-
trepôt solidaire, vers une montée
en compétences sur l’utilisation de
certains matériaux ;
3. Les entreprises de matériaux et
de BTP, qui voient leurs coûts de
stockage et d’enlèvement réduits, la
motivation de leurs équipes renfor-
cée, de même que leur connais-
sance de leurs publics et de leur
environnement, en échange de
dons de matériaux.
La mise en place d’une véritable
démarche de co-construction a
permis de crédibiliser le modèle
économique du projet aux yeux
de ses nanceurs (notamment la
Fondation MACIF) et de renfor-
cer sa dimension socialement inno-
vante. Le programme a ainsi favori-
sé le bouclage nancier du projet, à
80% pour les deux années de lance-
ment.
Pour CitizenShip : un essai gran-
deur nature pour exploiter les possi-
bilités offertes par la modularité du
container
L’expérience menée sur le site
de la Savine a permis de visuali-
ser et de tester auprès des habi-
tants et acteurs la proposition de
CitizenShip. La Maison de projet
de quartier à La Savine a été ainsi
caractérisée comme :
Un lieu original, novateur et expé-
rimental,
Un lieu ouvert, attractif et convivial,
Un espace collaboratif, s’appuyant
sur des compétences internes et
externes au quartier ;
Un espace dédié aux projets de
La Savine, allant au-delà du seul
projet de rénovation urbaine (projets
économiques et sociaux portés dans
ou avec le quartier),
Un lieu doté d’une identité forte,
constituant une référence pour
CitizenShip.
CitizenShip a ainsi été récemment
retenu comme mandataire d’un
groupement de professionnels du
bâtiment, pour réaliser la maison du
projet de la Savine (mo LOGIREM).
Associer les usagers et plus large-
ment les parties prenantes tout au
long du projet : pas si simple….
Dans l’un et l’autre projet, la problé-
matique de la place des usagers a
été centrale. Ils sont la base de la
réussite du programme et de la
démarche d’innovation sociale.
Les difcultés d’association des
usagers au sein des politiques
publiques ont été résumées par le
« Collectif Pouvoir d’agir » en quatre
points principaux :
- l’importance du choix des
sujets : c’est un choix qui doit
revenir aux usagers/habitants,
- la crainte de la perte du pouvoir
d’agir des techniciens : le parta-
ger avec les usagers permet de le
multiplier et non pas de l’amoin-
drir,
- la conance dans la capacité
d’agir des personnes et notam-
ment dans le plaisir de faire
ensemble et de réussir une action
collective,
- l’appréhension du conit alors
qu’il peut être source de résolu-
tion.

Ainsi, le projet mené sur la cité de la
Savine et porté par Citizenship offrait
des conditions favorables à cette
association, les habitants/usagers
ont d’abord été présentés comme
des menaces, des risques. Ils ont pu
par la suite, et au travers d’un atelier
réalisé sur la cité, participer active-
ment à la conception de leur maison
du projet. A noter cependant qu’il
s’agissait d’usagers/habitants choi-
sis, issus pour la plupart d’associa-
tions locales. Pour le projet de la
plateforme des matériaux solidaires,
la dénition précise des usagers du
service a pu aboutir à la n de l’ac-
compagnement, et a permis de
renforcer une stratégie de commu-
nication et d’adhésion au projet en
direction des entreprises et artisans.
Les enseignements
généraux du programme
Au-delà des effets de l’accompa-
gnement sur les deux projets sélec-
tionnés, quels enseignements peut-
on tirer de cette expérimentation, au
bout de 12 mois de mise en œuvre ?
Penser la « lière » et diversier
l’ensemble des parties-prenantes
tout au long du projet. A cet égard,
il a été pointé la difculté à mobiliser
les acteurs économiques autres que
ceux de l’ESS, faute de méthode et
de réseaux ;
Revisiter les modalités d’asso-
ciation des parties prenantes. Les
acteurs de l’économie sociale et
solidaire considèrent souvent qu‘ils
disposent de méthodes de partici-
pation, mais ils prennent conscience
aussi qu’ils peinent à mobiliser ou
remobiliser. Le design de services
ouvre des perspectives sur cette
remobilisation : travailler en petits
groupes, accéder à la parole, rendre
acteurs des personnes en retrait
jusque-là. Cette méthode permet la
participation et par les jeux de rôle
ouvre la possibilité pour les porteurs
de projet d’identier eux-mêmes les
faiblesses de leur produit/service.
Un tel programme met aussi en
évidence le caractère indispensable
de compétences spéciques et
d’un accompagnement tel que celui
offert par Yellow Window, a fortiori
la nécessité de former les acteurs à
ces méthodes ;
Renforcer la question de la
faisabilité et de la soutenabilité
des projets en considérant que
le modèle économique n’est pas
nécessairement unique (en termes
de taille, de nature des nance-
ments…). Elle permet enn d’envi-
sager et de mobiliser des ressources
hétérogènes complémentaires ;
Se doter de lieux de créativité «
hors-les-murs » : les lieux ne sont
pas neutres pour favoriser les dyna-
miques de créativité. Le fait d’être
hors les murs de l’action publique
traditionnelle et dans les murs entre-
preneuriaux (dans le cas de PACA :
La Friche, la Station Alexandre à
Marseille) modie le rapport au projet
et aux interactions entre les acteurs.
Se situer dans ces lieux a contribué
à faire de la mise en lien territoriale
et a renforcé les partenariats public-
privé notamment ESS ;
Se donner le temps de l’inno-
vation : faire ensemble, construire
des relations de conance prend
du temps. Cela induit ainsi inévita-
blement une contrainte à prendre en
compte dans les modalités d’accom-
pagnement ;
Positionner différemment les
services de l’Etat. L’innovation
suppose un décloisonnement des
secteurs et plus globalement impose
de revisiter la relation traditionnelle
public/privé. Il est attendu des
services de l’Etat (et des nanceurs/
décideurs publics en général)
qu’ils créent des espaces/temps
spéciques (aussi règlementaires et
nanciers) pour que se développent
des innovations. La contrepartie est
évidemment la question de l’éva-
luation (quels critères de réussite ?) ;
Enn en termes de perspectives,
se pose la question du changement
d’échelle : « comment passer du sur-
mesure au prêt-à-porter (sans aller
jusqu’à l’industrialisation) ? ».
A cet égard le transfert des méthodes
ne peut être imposé par en haut,
mais être approprié par l’ensemble
des parties prenantes.
En 2014, sur la base de ces
enseignements, le programme se
poursuivra en Provence Alpes Côte
d’Azur, dans la perspective d’une
consolidation et d’un élargissement
des partenariats, et de la poursuite
de la construction d’une culture
commune de l’innovation sociale.
4
Directeur de la publication : Jacques CARTIAUX, directeur régional
Responsable du Pôle Observation, contrôle, évaluation, ingénierie & Rédacteur en chef : Léopold CARBONNEL
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale PACA - 66 A, rue Saint-Sébastien - CS 50240
13292 MARSEILLE CEDEX 06 - Téléphone : 04 88 04 00 10 - Télécopie : 04 88 04 00 88
[email protected].fr - site internet : www.paca.drjscs.gouv.fr
Dépôt légal : Juillet 2014 - ISSN : 2119-761 X
Mise en page et Impression : INA PôleGraphique 06 21 93 82 10
Numéro 05
Sept 2014
1
/
3
100%