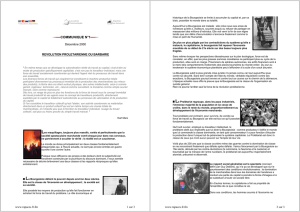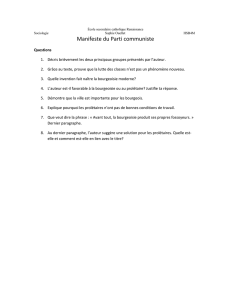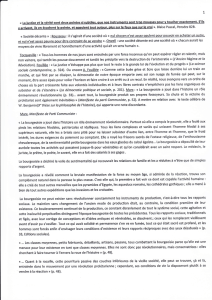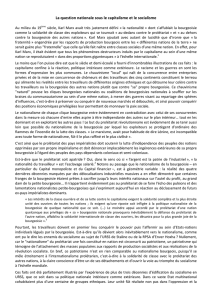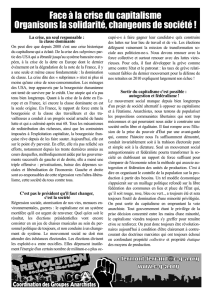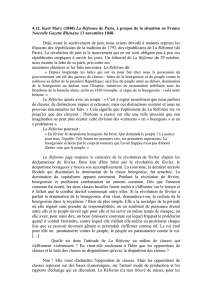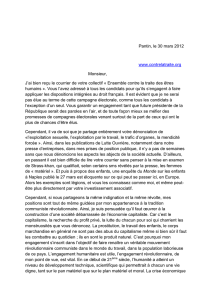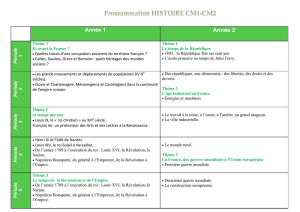1-En finir avec "la France", appareil politico


Les camarades maoïstes du Pérou n’ont de cesse de le répéter : pour pouvoir déclencher,
et mener victorieusement à son terme, la Guerre populaire dans un pays donné – comme
processus de négation du capitalisme par le communisme menant à la prise du pouvoir par
les exploité-e-s, après quoi l’on parle de socialisme ; les communistes de ce pays doivent
d’abord élaborer une PENSÉE. C'est-à-dire, une analyse profonde, méthodique, à la lumière
de la science marxiste la plus avancée de l’époque (qui, aujourd’hui, est le maoïsme), de la
réalité et de l’organisation sociale, politique, économique et idéologique/culturelle qui nous
entoure, dans laquelle et généralement CONTRE laquelle nous luttons ; et qui, en ce qui
nous concerne, porte le nom de ‘France’ ou ‘République française’. Élaborer une pensée,
cela veut finalement dire, tout simplement, comprendre la réalité qui nous entoure pour la
TRANSFORMER.
À partir de ce mot d’ordre, différentes interprétations sont possibles... L’on peut, comme
certains, étaler sur internet des cours magistraux d’histoire philosophique, littéraire et
artistique en général, de notre bonne vieille ‘France’ académique : finalement, rien de bien
plus que nos bons vieux programmes de lycée ou de fac, mais ‘avec un œil marxiste’. OU
ALORS, l’on peut se pencher, dans une démarche réellement antagonique (d’abord dans la
pensée, avant que celle-ci ne 'rencontre’ les masses et ne s’organise pour agir, devenant
ainsi force matérielle), sur le processus matérialiste historique, de luttes de classe, à
travers lequel s’est CONSTRUITE cette réalité. Tel va être l’objet de la longue étude qui va
suivre.
Appartenant à la Nation occitane, Servir le Peuple a depuis maintenant près de deux ans été
amené à se pencher longuement sur cette question : la question de la présence, au sein de
la ‘République française’ (assimilée, avec un trait d’égalité, à une prétendue ‘Nation’
française), d’un certain nombre de nations : Bretons, Basques, Occitans, Corses, Alsaciens
etc. ; et de l’émergence, depuis les années 1960, de revendications de ces nations
présentant un contenu démocratique, progressiste voire révolutionnaire. D’autre part, ce
n’est plus un secret depuis que quelques petites balances ont fait leur office, SLP est basé
dans la région de Lyon : une ville qui, par sa situation géographique et son rôle
économique, s’est souvent vue attribuer le titre de ‘capitale de la province’, véritable petite
‘antenne’ de Paris pour tout l’Est et le Sud-Est de l’Hexagone, et concentrant, à ce titre,
toutes les contradictions de la construction politique, économique et sociale ‘France’.
Nous en sommes, au bout du compte, arrivés à la conclusion que ce qu’on l’appelle
‘France’ (plus ou moins totalement, depuis une centaine d’années, identifiée à ‘la
République’), est en réalité et avant tout une CONSTRUCTION POLITICO-MILITAIRE au
service de la classe dominante (hier, une alliance entre la monarchie capétienne, une partie
de l’aristocratie et du clergé et une partie de la grande bourgeoisie ; aujourd’hui la grande
bourgeoisie devenue, depuis près de 150 ans, monopoliste) ; ainsi qu’une ARMADA
IDÉOLOGIQUE et culturelle en ‘appui’ à cette domination – mobilisant les masses derrière
cette classe dominante et ses plans.
Telle est la conclusion principale de notre analyse ; et non le fait d’avoir déterminé que
cette construction politico-militaire/armada idéologique renferme, rien qu’en Europe (sans
compter l’outre-mer), une demi-douzaine de peuples et donc de prolétariats, plus les
‘colonies intérieures’ de descendant-e-s de colonisé-e-s : les intérêts de ceux-ci sont de
toute manière identiques et indissociables, et distincts et antagoniques de ceux de la
bourgeoisie même la plus ‘couleur locale’ qui soit, même ‘beurgoise’ ou ‘black-bourgeoise’,
etc. Tel est le principal, et telle est, selon nous, la véritable rupture et le véritable
antagonisme de classe, assumé, avec la réalité sociale qui nous entoure et nous oppresse
en tant que personnes du peuple, et que nous voulons abattre en tant que
révolutionnaires ; réalité qui, quel que soit le sens dans lequel on tourne le problème,
converge toujours vers un seul et même mot pour en désigner la globalité : ‘France’.
Telle est, aussi, la vraie rupture, la ligne de démarcation qui démasque la pensée de gauche
petite-bourgeoise ‘radicale’ ; pensée qui toujours en appelle à ‘l’État’, à la ‘République’,
comme entité déifiée au dessus des classes ; et inévitablement, finit toujours par glisser
sur ‘la Nation’, ‘la France’ et sa ‘grandeur’, ‘patrie des droits de l’homme’ et ‘lumière’ pour

l’humanité qui ne serait pas, mais alors pas du tout, ce que ses actuels dirigeants en
donnent à voir... Un peu comme les rois, dans l’Ancien régime, n’étaient jamais mauvais
mais avaient de ‘mauvais conseillers’ ; la ‘République’, la ‘France’, n’a pour nos petits-
bourgeois ‘radicaux’ que de ‘mauvais gouvernements’. Cette petite-bourgeoisie est souvent
fonctionnaire (cadres moyens de l’administration ou des entreprises publiques,
enseignants), elle vit de l’appareil politico-militaire et idéologique ‘France’ : ceci explique
peut-être cela...
Et telle est, enfin, la grande rupture et le grand dépassement vis-à-vis des limites du
marxisme appliqué à la France depuis la fin du 19e siècle ; limites qui ont empêché la prise
de pouvoir révolutionnaire.
Mais, précisément en raison de ce qui précède (hégémonie idéologique de la classe
dominante, dont la ‘France’ est l’instrument, influence de la pensée petite-bourgeoise
‘social-républicaine’ sur les masses populaires, et limites de la conception du monde des
marxistes au siècle dernier), cette analyse se heurte aussi à de très nombreux
contradicteurs. Il est malheureux, par exemple, de voir des communistes, sans la moindre
analyse marxiste des classes en présence et de leurs contradictions, considérer que les
massacres de populations rurales, dès lors que menés par la ‘République’ – notamment en
Bretagne, Vendée, Anjou – étaient parfaitement justifiés, face à la ‘vermine contre-
révolutionnaire’, alors même que celui qu’ils considèrent généralement comme le ‘premier
communiste’, Gracchus Babeuf, les avait pourfendus en son temps ; et alors même que les
méthodes utilisées, en rien différentes de celles de la ‘pacification’ de la Corse sous Louis
XV ou de la ‘guerre des camisards’ sous Louis XIV, ou encore de la guerre napoléonienne
en Espagne, seront les mêmes qui seront reprises par Bugeaud et consorts lors de la
conquête de l’Algérie… Les communistes italiens de l’époque de Gramsci, eux, faisaient
parfaitement le parallèle entre la ‘pacification’ du Sud après l’Unité (1860-90) et les
‘prouesses’ de leurs troupes coloniales en Libye ou en Éthiopie. Et combien n’est-il pas
lamentable de voir des ‘maoïstes’ (en principe, les marxistes les plus avancés de notre
époque) nous expliquer que ‘La France est une nation, mettre en avant l’Occitanie
aujourd’hui, c’est vouloir faire tourner la roue de l’histoire à l’envers’, c’est ‘nier la lutte des
classes en France en niant la France’ ; ou ce ‘marxiste-léniniste plus-ouvrier-que-moi-tu-
meurs’ nous affirmer que 'les délires sur la libération de la Bretagne sont affligeants ; ce
sont des revendications féodalistes qui veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers’,
que ‘c'est nier tout le développement historique qui a conduit à la "nation" bourgeoise qui
est un "progrès" historique sur les régionalismes et sur le féodalisme ; voilà ce qui
s'appelle vouloir faire tourner la roue de l'histoire à l'envers’, et qu’il a ‘des collègues
ouvriers bretons’ que ‘sur la question (il) cite : « c’est des conneries de bobos
intellectuels »’ ; comme si toute la mise en avant, progressiste et même révolutionnaire, de
l’Occitanie ou de la Bretagne depuis les ‘années 68’ (1965-75), était une ‘lubie’ sortie d’on ne
sait où, peut-être sous l’effet de substances hallucinogènes (qui sait, à l’époque…), à moins
que ce ne soit le fruit d’un complot de l’impérialisme (comme les révoltes arabes ?)…Mais
ce ne sont là, hélas, que des opinions très et TROP répandues.
Très et trop répandues car, justement, les communistes luttant à l’intérieur des frontières
géographiques de cette ‘France’ n’ont jamais élaboré cette pensée, cette analyse profonde,
méthodique et antagonique de cette réalité sociale, politique, économique et culturelle
qu’on appelle ‘France’. Par exemple, les États modernes (ceux qui se sont constitués
depuis la fin du Moyen-Âge), ‘France’ en tête, se sont constitués autour d’une ‘nation
centrale’ et se sont, généralement, proclamés ‘États-nations’. Ce qui a amené, chez nombre
de communistes, une tendance à confondre cette proclamation avec la réalité, et à
confondre État et Nation alors que ces deux réalités, ni dans l’Antiquité (Grèce et Gaule
divisées en ‘cités’, Empire romain supranational), ni à l’époque moderne et contemporaine,
n’ont pratiquement jamais coïncidé. Tendance à confondre, par exemple, une expression
culturelle de la classe dominante, celle qui ‘pilote’ la construction politico-militaire, avec
une des ‘premières expressions’ d’une prétendue ‘culture nationale française’, comme le
PCMLM mettant en avant son ‘Enfin Malherbe vint’ (1674) de Nicolas Boileau – fils d’un
magistrat au Parlement de Paris, très-haut bourgeois plus-ou-moins anobli et représentant-

type de la classe dominante de l’époque, dont le royaume de ‘France’ était l’appareil
politico-militaire.
C’est donc pourquoi, loin de vouloir s’autoproclamer jefatura de quoi que ce soit, Servir le
Peuple a voulu apporter, modestement, sa petite pierre à l’élaboration de cette pensée qui a
tant fait défaut au mouvement communiste hexagonal, pour ‘éclairer la route’ de la
révolution prolétarienne. SLP affirme que la ‘France’ n’est pas une nation, mais au contraire
le cadre, et souvent la prison d’un ensemble de nations ‘constitutives’ : c’est bien, mais
quelles sont ces nations ; et où, quand, comment, par quel processus historique sont-elles
apparues ? Il affirme que la ‘France’ n’est pas une nation mais un ‘État moderne’, un
appareil politico-militaire et idéologique de domination d’une classe sur les masses du
peuple : c’est bien, mais là encore, où, quand, comment cet État moderne s’est-il
constitué ? Et comment tout cela converge-t-il vers la ‘France’ comme réalité sociale,
politique et économique qui nous entoure, et que nous voulons renverser et transformer ?
C’est ce que nous allons voir à présent.
Si l’on suit Ibrahim Kaypakkaya, selon lequel - dans sa très importante étude de la question kurde -
les populations humaines, sur un territoire donné, ‘accumulent’ les caractéristiques nationales
avant de ‘rencontrer’ l’aube du mode de production capitaliste qui les ‘transforme’ en nations au
sens moderne et marxiste du terme ; alors l’on peut dire que les nations actuelles d’Europe et de
Méditerranée sont ‘nées en l’An Mille’, apogée (entre 800 et 1200 de notre ère) du mode de
production et de la civilisation féodale, où de grands États féodaux faisaient resplendir la
renaissance médiévale, et où une économie mercantile très avancée commençait à ‘muter’ vers le
capitalisme, suivant le processus décrit par Marx et Engels : on ne cherche plus à vendre une
marchandise pour obtenir de l’argent et acheter une autre marchandise (M->A->M), mais on
investit de l’argent pour produire (ou acquérir) une marchandise, dont la vente (ou revente) va
rapporter plus d’argent (A->M->A’ supérieur à A).
Il serait absurde de vouloir (comme certains ‘identitaires’ et autres ‘néo-païens’) faire remonter les
nations actuelles à une époque antérieure à celle-là ; antérieure aux grands bouleversements
politiques, économiques, sociaux et démographiques (‘grandes invasions’) qui ont accompagné la
décadence et suivi la chute de l’Empire romain, entre globalement 250 et 800 de l’ère chrétienne.
Mais il est tout aussi absurde, sinon plus, de les faire naître à l’époque où Denis Papin (1647-
1712), en inventant la machine à vapeur, préparait déjà la révolution industrielle...
Concernant ce fameux Empire romain, voici ce que Friedrich Engels nous en disait dans L’Origine
de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884) : ″L'appartenance au monde romain, qualité
de fraîche date, n'offrait point de compensation: elle n'exprimait pas une nationalité, mais
seulement l'absence de nationalité. Les éléments de nations nouvelles existaient partout; les
dialectes latins des différentes provinces se différenciaient de plus en plus; les frontières
naturelles, qui avaient fait autrefois de l'Italie, de la Gaule, de l'Espagne et de l'Afrique des
territoires autonomes, existaient encore et se faisaient toujours sentir. Mais nulle part n'existait la
force capable de forger, avec ces éléments, de nouvelles nations. Nulle part il ne restait trace
d'une capacité de développement, d'une force de résistance et, moins encore, d'un pouvoir
créateur. (...) L'État romain était devenu une machine gigantesque, compliquée, exclusivement
destinée à pressurer les sujets. (...) Voilà où avaient abouti l'État romain et son hégémonie
mondiale : celui-ci fondait son droit à l'existence sur le maintien de l'ordre à l'intérieur, et sur la
protection contre les Barbares à l'extérieur. Mais son ordre était pire que le pire des désordres, et
les Barbares, contre lesquels il prétendait protéger les citoyens, étaient attendus par ceux-ci
comme des sauveurs.″
Cela est certes, peut-être, un peu exagéré : la tendance des villes, aux 4e-5e siècles, à se replier
et se fortifier, montre que les ‘barbares’ n’étaient pas tant accueillis à bras ouverts que cela. Et
c’est sans doute très rapidement, dès (en fait) la fusion de l’élément romain avec les populations
conquises que la langue populaire (vulgaire) a commencé à se différencier, tandis qu’en Orient et
en Afrique du Nord, la culture et la langue grecque, araméenne (toujours parlée par les chrétiens),
égyptienne (copte) ou amazighe n’ont jamais disparu (et reculé seulement, plusieurs siècles plus
tard, devant l’arabe). C’est ainsi que, dès les tous premiers siècles de l’ère chrétienne, il y a une

langue, une culture, une civilisation gallo-romaine, britto-romaine (Grande-Bretagne), ibéro-
romaine, italo-romaine, afro-romaine (Afrique du Nord) de manière nettement différenciée.
Ce qui varie, en revanche, c’est le degré de romanisation des provinces de l’Empire, qui s’étend, à
son apogée, des confins de l’Écosse à l’Égypte et au Sahara, et du Portugal à la Mésopotamie,
fixant sa frontière avec les ‘barbares’ germaniques sur le Rhin et le Danube. En Orient, on l’a dit,
les langues et les cultures pré-romaines restent intactes ; les premiers évangiles seront d’ailleurs
rédigés en grec, en araméen voire en copte, et non en latin ; et l’Empire d’Orient qui naîtra à la fin
du 4e siècle sera un Empire grec. Quant aux régions ‘périphériques’ de l’Empire, près du Rhin et
du Danube, en Grande-Bretagne et dans les Balkans, leur romanisation sera très superficielle, et
elles seront très facilement et rapidement germanisées (ou slavisées) aux 5e-6e siècles ; les
quelques îlots 'résistants’ de langue et culture latine étant appelés valachies (comme la province
roumaine) ou vallonies (Wallonie), de l’ancien germain wahl, désignant une population non-
germanisée (on le retrouve aussi pour les Celtes du Pays de Galles, Wales en anglo-saxon). La
romanisation sera également assez faible en Armorique (actuelle Bretagne), ce qui permettra aux
arrivants celtes grand-bretons du 5e siècle d’imposer leur langue celtique – le brezhoneg, qui reste
toutefois la plus ‘latine’ des langues celtes, ainsi ‘liberté’ se dit frankiz (‘franchise’), alors qu’en
gallois cela se dit rhyddid (rien à voir !) ; tandis que dans l’actuel Bassin parisien, elle sera
‘intermédiaire’, laissant fortement subsister les langues gauloises – formant un substrat du gallo-
roman médiéval et du futur ‘français’ – et également une grande place au superstrat des influences
germaniques (franque, alémanique), d’autant plus que l’on va vers le Nord ou l’Est…En revanche,
les régions fortement et anciennement (100 ans avant l’ère chrétienne) romanisées, que sont le
pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône et le bassin aquitain, sont le domaine de l’occitan –
avec, entre les deux, les langues 'transitionnelles' que sont les dialectes arpitans, le poitevin-
saintongeais, le bourbonnais voire le berrichon etc. Par ailleurs, jusqu’à la veille de l’An Mille voire
au-delà, existait certainement – comme en Afrique aujourd’hui – une distinction entre langues
vernaculaires (au territoire réduit, parfois une vallée voire un village), pour la vie ‘de tous les jours’,
et langues véhiculaires (pour la vie sociale ‘plus large’, notamment commerciale), les secondes
‘rétroagissant’ sur les premières pour les ‘standardiser’, mais en laissant de profondes variations
régionales que sont les dialectes d’oïl et d’oc, arpitans, ‘bas-bretons’, basques etc. d’aujourd’hui.
Une autre grande différenciation,
comme le souligne Engels, est celle liée aux frontières naturelles (le transport étant alors
essentiellement routier, et fluvial pour le transport ‘lourd’), aux zones montagneuses et peu
praticables en général, aux lignes de partage des eaux, qui délimitent les grands bassins d’unité
économique.
La Gaule romaine, que l’on voit ci-contre, tend ainsi à se différencier entre un ensemble Seine-
Loire (notre Bassin parisien), un ensemble au sud de la Loire, entre Massif central et Pyrénées
(bassin aquitain), la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, et un ensemble Rhin-Meuse
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
1
/
59
100%