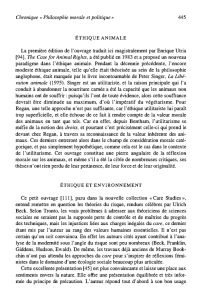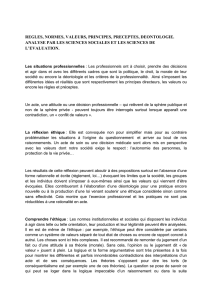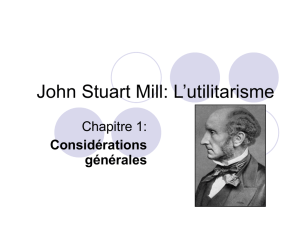1 Ethique, Foi et Santé Saint François Année 2015

1
Ethique, Foi et Santé Saint François
Année 2015-2016
Qu’est-ce que guérir ?
13 janvier 2016 – 3ème volet-
Catherine Radet
La santé face aux pressions économiques
I. Introduction
Le titre ainsi formulé rejoint davantage le « Comment guérir ? » Ce n’est pourtant pas une question si
éloignée du thème de l’année car le comment ne peut être fondé que sur le « qu’est-ce que guérir »,
en effet le but donne la direction et donc les moyens que l’on se donne. Par exemple, en cas de
céphalées (mal de tête), c’est peut-être plus simple, moins couteux d’investir dans un scanner, d’en
prescrire à répétition plutôt que de prendre le temps, un temps humain si précieux, pour écouter la
plainte somatique qui cache un mal autre, la source qu’il faut atteindre, sans compter le mal spi, le
vide spi… bien souvent à la racine de tous nos maux.
Pourquoi ce thème ? qui dit pressions économiques dit crise, or la santé est touchée par la crise et à
son tour contribue à la crise, par ses retentissements physiques, psychiques et spirituels, responsables
par exemple d’arrêts de travail, de chômage, de maladie chronique, dépression, avec des
conséquences de tout ordre : divorce, familles recomposées, enfants et adolescents en difficultés,
difficultés socioéconomiques, augmentation de la précarité… effet domino.
Il existe plusieurs angles pour aborder la question. En une soirée, il n’est pas possible de faire un
balayage général sur un sujet aussi vaste. Nous regarderons la question à partir de 4 spots ce qui ne
fera qu’effleurer le sujet mais suffisamment, j’espère, pour que chacun puisse se poser la question :
« qu’est-ce qui est à ma portée dans ce problème épineux de la santé aux prises avec la crise
économique ? »
II. Quelques aspects sous l’angle de l’économie
A. Economie de la santé et recherche :
L’économie de la santé est une discipline relativement récente dont on peut situer l’origine au début
des années 1960. Paru en 1963, l’article de Kenneth J. Arrow (prix Nobel d’économie 1972) fait office
de précurseur de la discipline. Les principes généraux y sont décrits. Un autre résultat connu comme
le paradoxe d’Arrow montre qu’il est impossible de définir l’intérêt général à partir des choix
individuels. A Chicago, Gary Becker (prix Nobel 1992) élabore une théorie du capital humain
mobilisant l’éducation, la formation et la santé en tant que capacités à développer puis à maintenir,
tels des investissements susceptibles d’engendrer des revenus accrus. Investir dans la santé est ainsi
proposé comme une source potentielle de richesse pour l’individu ou pour la nation. Des débats
s’ouvrent alors sur les applications de tout cela. Les débats viennent en France. Rappelons qu’en
France, dès 1945 sont promulguées les ordonnances Laroque sur la sécurité sociale qui mettent en
place l’assurance-maladie pour les travailleurs salariés. Le dispositif s’étant à l’ensemble de la
population française : la santé n’a pas de prix ! L’ampleur croissante des coûts sociaux et de la santé
conduit les responsables de la Comptabilité Nationale Française à s’intéresser de plus près aux logiques
de croissance des secteurs concernés. Les champs de recherche s’élargissent et les études deviennent

2
le support du processus de rationalisation des choix budgétaires et des dépenses publiques. La
question de la maîtrise des dépenses de santé qui mobilise une part croissante des budgets nationaux
comme des budgets familiaux, et déséquilibrent durablement les comptes de l’assurance-maladie (le
fameux trou de la sécurité sociale) est posée dès le début des années 1970. De multiples plans de
régulation financière visant à contraindre la demande ou réduire l’offre de soin se succèdent depuis.
Des appels d’offre sont lancés sur l’analyse de la croissance des dépenses de santé, la gestion et
l’organisation hospitalière etc. La recherche française en économie de la santé prend alors toute sa
place dans le développement international de la discipline, qui devient une branche reconnue des
sciences économiques et y apporte sa contribution autant théorique qu’appliquée.
Parallèlement à cela, les mécanismes collectifs de financement par l’assurance-maladie induit un essor
continu des soins, d’où une transformation considérable de la société, de son rapport au corps. Les
notions d’économie et de santé apparaissaient depuis longtemps antinomiques, les soins relevant de
la sphère privée, où à défaut de la charité publique, et la vocation du médecin était en apparence
dégagée de toute préoccupation mercantile. Aujourd’hui, confronté à cette situation économique et
médicale d’expansion de la demande de soins, et des moyens scientifiques et techniques d’y répondre,
le monde médical s’empare progressivement des outils du calcul économique et financier pour
déployer et justifier ses interventions de plus en plus coûteuses. La recherche va jusqu’à évaluer les
coûts indirects de la maladie, notamment les pertes de production induites par les arrêts de travail.
Médecins et économistes travaillent dorénavant ensemble. Les questions se
complexifient s’adaptant aux évaluations épidémiologiques. La recherche de l’efficience est devenue
le maître mot. La société évolue aussi : avec l’efficience médicale et l’allongement de l’espérance de
vie, le vieillissement de la population et la montée des maladies chroniques sont devenues les causes
principales de morbidité et de mortalité remplaçant les maladies infectieuses. Le coût sur les soins
ne fait que croître. Dans d’autres pays se discute l’accessibilité aux soins de médications coûteuses
telles que le traitement su SIDA par exemple. Les acteurs de soin se multiplient et la question de leur
coordination entre eux se posent de plus en plus. Des méthodes de travail nouvelles voient le jour :
réseaux, structures de concertation, maisons médicales, etc.
Le monde social et politique évolue également, élabore théories et méthodes. Les nouvelles lois de
santé érigent des Droits nouveaux : Droit des patients en matière de représentation, d’information,
de consentement éclairé, de partage de la décision tant au niveau individuel qu’institutionnel.
La notion de démocratie sanitaire apparait avec le nouveau millénaire. Le patient est de plus en plus
impliqué dans les choix des traitements, le déroulement des soins, leur accompagnement, jusqu’à être
coproducteurs des soins. Ce sont plus largement les conditions sociales de vie, de travail et
d’organisation économique, par les comportements individuels et collectifs qui sont interrogés comme
à l’origine de troubles morbides physiques ou psychiques facteurs de risque de cancer, de dépression
ou d’obésité. L’économie de la santé évolue donc vers un appel à la responsabilité individuelle dans
la préservation et le maintien de sa santé.
Maintenant, étudions les théories de la justice et les systèmes de santé.

3
B. Systèmes de santé, théories de la justice
1
Il existe plusieurs systèmes de santé dans le monde, basés sur des critères, des théories et principes
très différents selon les pays :
Le critère du marché, comme le système de santé nord-américain, basé sur la théorie
libérale de la justice. Le marché s’appuie la valeur première de la liberté.
Le critère de la solidarité, mais avec des différences, selon que cette solidarité
s’appuie sur les besoins individuels (systèmes dits bismarckiens en Allemagne,
Autriche, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas) ou sur l’utilité collective (systèmes dits
beveridgiens de solidarité utilitariste au Royaume-Uni, Danemark, Irlande, Finlande et
Suède). La France, comme l’Italie, le Portugal, la Grèce et l’Espagne sont des systèmes
mixtes. Tous ces pays ont en commun le besoin comme valeur première, ce sont les
théories solidaristes de la justice. Les droits réels se substituent aux droits formels.
L’utilitarisme donne priorité aux actions qui maximisent le bien-être pour un maximum
de personnes. Equilibre trouvé entre impôt consenti et l’intérêt général (niveau de
santé publique souhaité).
Chaque système comporte malheureusement des failles, produit des effets injustes et chaque système
tente de les corriger en introduisant un des autres critères des autres systèmes. Plus on élève le niveau
de santé d’une population, plus le seuil de tolérance devant la maladie baisse et plus augmente la
demande de santé. Doit-on et peut-on offrir à tout le monde tout ce qui est techniquement possible
en matière de biens de santé ? La couverture du risque engendre la prise de risque, et augmente le
besoin de soins. (C’est ce qu’on appelle un risque moral élevé, ou encore le risque de
déresponsabilisation des patients trop assisté). Les quelques mécanismes libéraux persistants (choix
du médecin, accès direct aux spécialistes, paiement à l’acte, liberté d’installation, etc) induisent
nécessairement une surproduction et une surconsommation massives du système de santé. Les
systèmes utilitaristes purs ont des effets « sacrificiels » (les laisser pour compte du système) et sont de
plus parfois inefficient par inertie bureaucratique et non incitatifs pour les médecins.
Des tentatives de corrections des dérives sont faites soit par des mécanismes de marché (en
introduisant par ex des systèmes concurrentiels entre caisse d’assurance), des systèmes pour favoriser
l’autonomie, le mérite, la responsabilisation de sa santé, augmenter la solidarité utilitariste par
limitation des demandeurs (accès indirects aux spécialistes) et/ou des offreurs (numérus clausus) …
Chaque mécanisme de corrections comporte également des effets pervers complexes.
En France : (toujours selon l’analyse de Suzanne Rameix)
Obligation morale des médecins :
Coté médecin, les conséquences des options françaises sont considérables : leur responsabilité est
immense. Un système solidariste suppose des médecins « vertueux » puisqu’ils ont la charge d’évaluer
les besoins médicaux qui sont – qui devraient être – le seul critère de production et d’allocation des
soins et, d’autres part, de prodiguer les soins correspondant à ces besoins, et ceux-là seulement. De
lourdes obligations pèsent sur eux : détermination du besoin « objectif », évaluation, comparaison
(médecine et autres actions, préventif et curatif, etc.) interdiction de tout soin inutile, compétence
1
Suzanne RAMEIX : Théories de la justice et système de santé. In : Collège des enseignants de sciences humaines
et sociales en médecine et santé : Médecine, santé et sciences humaines. Manuel. Les Belles Lettres, Paris 2011,
p 472-484

4
maximale, devoir de résistance à la demande et à l’offre, participation à l’évaluation du coût, obligation
à efficacité égale de prodiguer le soin le moins coûteux.
Responsabilité du politique et des citoyens :
Le système français est hétérogène, « mille-feuille » : des origines libérales conservées, une évolution
solidariste assurantielle puis une évolution solidariste utilitariste (tutelle de l’Etat sur la santé publique
depuis 1945…) puis à nouveaux des outils libéraux. Qu’est-ce qui est pris en charge par la solidarité
et pourquoi ? Quels mécanismes de marchés sont admis et pourquoi ? Comment le critère du mérite
joue-t-il et pourquoi ? Si les choix ne sont pas clairement posés et connus de tous, médecins et
patients, offreurs et demandeurs, prescripteurs et payeurs, le système ne peut que dysfonctionner. La
relation médicale doit s’instaurer dans un cadre économique transparent, seul gage d’une
responsabilisation de tous les acteurs concernés.
Lien entre morale individuelle et morale collective. Beaucoup de nos problèmes ne sont-ils pas
ultimement les problèmes d’une société qui refuse la mort ?
III. Principes éthiques :
A. Théories morales
Dans l’ouvrage de référence des bioéthiciens
2
, écrits par Beauchamp et Childress, plusieurs théories
morales sont étudiées et passées en revues, chacune des cinq théories est minutieusement
décortiquées pour éliminer ce qui est inacceptable et garder au contraire les éléments pertinents et
acceptables pour une démarche de réflexion en bioéthique et en pratique clinique. Aucune des cinq
théories est à elle toute seule la panacée. La connaissance de tous les aspects, avec ses défauts et
avantages sont utiles car une grande partie de la littérature portant sur ce domaine fait appel aux
méthodes et aux conclusions qu’elles mettent en jeu.
Ces théories sont les suivantes : l’utilitarisme, le kantisme, l’individualisme libéral, le
communitarisme et l’éthique de la sollicitude (ethics of care). Ces théories ont été élaborées selon
des critères et des conditions précises, pensées par des philosophes et s’appliquent dans des domaines
variés. Certaines conviennent mieux que d’autres selon le champ d’application, par exemple
l’utilitarisme est un meilleur modèle pour la politique publique que pour l’éthique médicale clinique.
Dans une conception populaire jusqu’à la fin du XX° siècle, les fonctions d’une théorie morale étaient
de prescrire et de justifier les normes générales, en tant que système. Dans une conception plus
récente et moins définie, la tâche de l’éthique est de réfléchir de façon critique, sur les normes et les
pratiques morales réelles.
Une théorie doit remplir les 8 conditions suivantes :
- Clarté dans sa globalité et dans ses parties
- Cohérence : une théorie doit avoir une cohérence interne.
- La complétude et l’exhaustivité et qui peut justifier toutes les valeurs morales énoncées.
- L’économie : mieux vaut une théorie comprenant quelques normes de base qui génère un
contenu moral suffisant qu’un ensemble de normes sans contenu.
- La force de l’explication : vision suffisante pour nous aider à comprendre la vie morale : son
but, son statut objectif ou subjectif…
2
Tom L. Beauchamp et James F. Childress Les principes de l’éthique biomédicale. Médecine et Sciences Humaines. Les Belles Lettres, Paris
2008 p 483 – 548.

5
- La force de la justification : une théorie doit également fournir des motifs pour justifier la
conviction exprimée.
- La fécondité, c’est-à-dire lorsqu’elle engendre des jugements nouveaux.
- Réalisable.
Voici un court aperçu de 2 d’entre elles :
1. Kant et la morale déontologique du devoir.
La norme morale est posée par l’homme : l’autonomie. Avec lui, il n’y a plus aucune finalité externe
qui puisse être normative. On ne peut partir que de l’homme. L’analyse de Kant à propos des normes
morales s’enracine dans le pouvoir exclusif de la raison humaine. Dans les Fondements de la
métaphysique des mœurs (1785), Kant cherche comment nous pouvons être moraux. Dans la première
section, il part des jugements moraux de la conscience commune. Ce qui est bon en soi pour elle, c’est
« une bonne volonté » (p. 87). Il n’existe qu’une seule chose qui puisse être tenue comme bonne sans
restriction, c’est la « bonne volonté ». En effet, tous les autres talents et qualités ne sont pas bons en
eux-mêmes : ils peuvent être mauvais s’ils sont au service d’une volonté mauvaise. Qu’est-ce qu’une
bonne volonté ? C’est une volonté d’agir par devoir, et non pas conformément au devoir. Quel est le
principe, la loi morale qui doivent déterminer la volonté ? D’abord, « je dois toujours me conduire de
telle sorte que je puisse vouloir que ma maxime devienne une loi universelle » (p. 103).
Donc la moralité d’un acte se juge à la possibilité d’universaliser la maxime qui en est à l’origine. Kant
écrit alors : « Il n’y a qu’un impératif catégorique et c’est celui-ci : agis uniquement d’après la maxime
qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle ». Cette intransigeance
formelle nous conduit à l’idée d’autonomie, c’est-à-dire à l’autolégislation de la conscience morale.
Mais comment la volonté est-elle liée pratiquement à cet impératif qu’elle construit ? Pourquoi
devrait-elle s’y plier ? Il faut une fin qui la détermine et l’on sait que cela ne peut être une fin subjective
fondée sur des mobiles nés de nos penchants. Ce ne peut être qu’une fin objective. Quelle est donc
cette fin en soi, objective, qui doive entraîner la volonté à agir ? C’est le respect de l’humanité :
« Supposons qu’il y ait quelque chose dont l’existence en soi-même soit une valeur absolue, quelque
chose qui comme fin en soi, peut être le principe de l’impératif catégorique… Or, je dis : l’homme en
tant qu’être raisonnable, existe comme fin en soi et non pas simplement comme moyen dont telle ou
telle volonté puisse user à son gré » (p. 148). Les choses ont un prix mais l’homme a une dignité ; les
choses dont des moyens et n’ont qu’une valeur relative, les personnes sont des fins objectives et ont
une valeur absolue. La formule de l’impératif devient alors : « Agis de telle sorte que tu traites
l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours et en même
temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen » (p. 150). Cette formulation est
essentielle pour Kant dans la mesure où elle équilibre le formalisme du premier énoncé. Le respect de
l’humanité « humanise » pour ainsi dire et tempère la sécheresse de la première formulation de
l’impératif catégorique. Pourquoi l’homme est-il une fin en soi ? Parce qu’il est l’auteur de la loi à
laquelle il obéit.
L’éthique kantienne est :
Déontologique : la recherche de ce qui doit être remplace l’ontologie, la connaissance
de ce qui est.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%