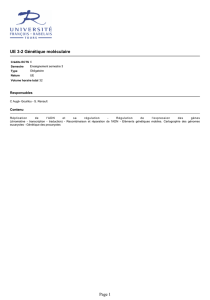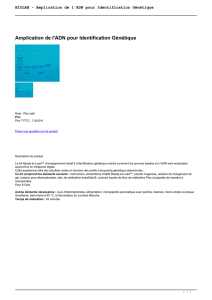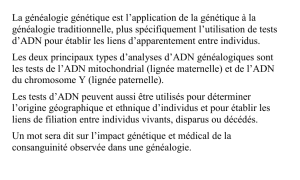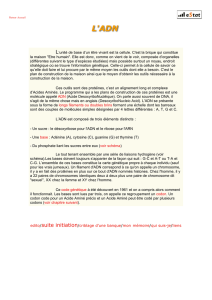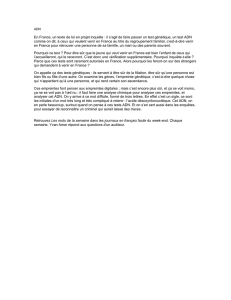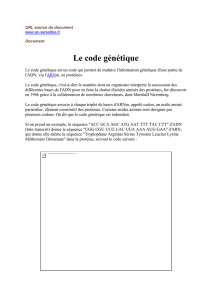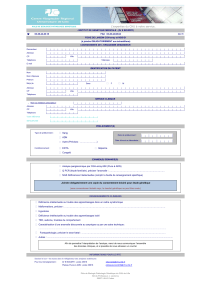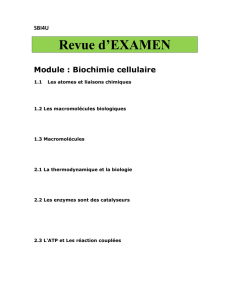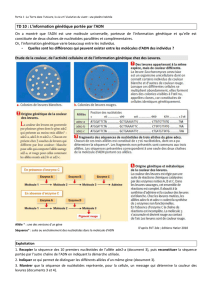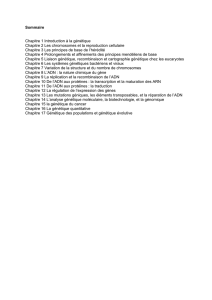Micronoyaux et polymorphismes génétiques

revue générale
Micronoyaux et polymorphismes génétiques :
de l’exposition à la susceptibilité
Micronuclei and genetic polymorphisms: from exposure to susceptibility
G. Iarmarcovai
A. Botta
T. Orsière
Laboratoire de biogénotoxicologie
et mutagenèse environnementale
(EA 1784 ; IFR PMSE 112),
Faculté de médecine,
Université de la Méditerranée, Marseille
Article reçu le 29 décembre 2006,
accepté le 24 avril 2007
Résumé.Le concept de susceptibilité génétique et d’interactions entre facteurs
de risque génétiques et environnementaux est un nouvel axe de recherche de
l’épidémiologie moléculaire des cancers. Les micronoyaux peuvent être, soit le
témoin d’une instabilité génétique, soit un biomarqueur d’effet mettant en
évidence des dommages chromosomiques induits par des agents
mutagènes/cancérogènes. Son association à l’hybridation in situ fluorescente
différencie les micronoyaux contenant des fragments chromosomiques
acentromériques (cassures chromosomiques) et ceux contenant des chromoso-
mes entiers centromériques (pertes chromosomiques). Un champ actuel
d’investigation est d’associer aux biomarqueurs de susceptibilité génétique,
capables de rendre compte de la susceptibilité aux cancers et de différences
interindividuelles dans la réponse à une exposition génotoxique, le test des
micronoyaux, témoin d’une interaction entre l’environnement et le matériel
génétique de la cellule. Les modulations des dommages à l’ADN et plus
particulièrement de la fréquence et du contenu centromérique des micronoyaux
par le polymorphisme génétique de gènes impliqués dans le métabolisme des
xénobiotiques (activation ou détoxification), dans la réparation des lésions de
l’ADN ou dans le métabolisme des folates commencent à être documentées. Le
micronoyau est un biomarqueur intégrant de nombreux facteurs de variation
(sexe, âge, tabagisme), d’où l’intérêt de l’associer à l’étude du polymorphisme
génétique des individus pour une meilleure définition de sa situation en terme
de prévention et/ou prédiction du risque cancérogène.
Mots clés :épidémiologie moléculaire, biomarqueurs, mutagenèse, risque
cancérogène, susceptibilités génétiques
Abstract.The concept of genetic susceptibility and interactions between
genetic and environmental factors of risk is a new trend in molecular epidemio-
logy studies of cancers. Micronuclei are biomarkers of chromosome damage
due to genetic instability or exposure to environmental mutagens or carcino-
gens. The micronucleus assay in combination with fluorescent in situ hybridi-
zation discriminates between micronuclei containing acentric chromosome
fragments (chromosome breakage) and micronuclei containing whole chromo-
somes (chromosome loss). A recent approach is to associate the biomarkers of
genetic susceptibility, which take into account cancer susceptibility and interin-
dividual differences in the response to a genotoxic exposure, and the micronu-
cleus assay, which serves as a biomarker of interactions between the environ-
ment and the genetic material of the cell. Information is being gathered on how
DNA damage and more particularly the frequency and centromeric content of
micronuclei depend on the polymorphisms of genes implicated in xenobiotic
metabolism (activation or detoxication), DNA lesion repair, or folate metabo-
lism. For biomonitoring purposes, numerous confounding factors (age, sex,
Tirés à part : G. Iarmarcovai
abc
Ann Biol Clin 2007 ; 65 (4) : 357-63
doi: 10.1684/abc.2007.0133
Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007 357
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

tobacco consumption) influence the micronucleus biomarker, and thus associa-
ting genetic polymorphisms to micronuclei would be useful to better define the
prevention and prediction of cancer risk.
Key words:molecular epidemiology, biomarkers, mutagenesis, cancer risk,
genetic susceptibility
L’objectif de l’épidémiologie moléculaire des cancers est
de pouvoir déterminer les rôles respectifs des facteurs
environnementaux et génétiques dans l’initiation et la pro-
gression des tumeurs, afin de mettre à profit ces connais-
sances pour le développement de stratégies de prévention
des cancers [1]. Les biomarqueurs utilisés sont générale-
ment classés en trois catégories : 1) biomarqueurs d’expo-
sition évaluant la pénétration d’une substance exogène
dans l’organisme par le dosage de la substance elle-même
ou de ses métabolites dans les fluides biologiques, les
tissus ou les cellules ; 2) biomarqueurs d’effet témoignant
d’une interaction entre les agents génotoxiques et le maté-
riel génétique de la cellule (tests de génotoxicité) ; 3) bio-
marqueurs de susceptibilité permettant de rendre compte
des différences interindividuelles dans la réponse à une
exposition génotoxique [1]. Le concept de susceptibilité
génétique et d’interactions entre facteurs de risque généti-
ques et environnementaux est un nouvel axe de recherche
de l’épidémiologie moléculaire des cancers [2].
Le micronoyau en tant que
biomarqueur : quelle signification ?
De l’utilité de ce biomarqueur
Dans le cadre des relations santé-environnement, le
domaine de la toxicologie génétique s’est révélé être
essentiel puisque la détermination des facteurs environne-
mentaux susceptibles d’interagir, directement ou non,
avec le patrimoine génétique des cellules est devenue
nécessaire dans le cadre de la prévention du risque cancé-
rogène. Compte tenu de la grande diversité des anomalies
susceptibles d’être induites au niveau d’un patrimoine
génétique, il n’existe pas un, mais plusieurs tests de géno-
toxicité susceptibles de révéler tels ou tels types de lésions
ou de mutations. Une mutation, conséquence de l’incapa-
cité des systèmes de réparation à restaurer fidèlement
l’ADN, est une modification stable et irréversible de
l’ADN.
Le test de numération des micronoyaux (MN) représente
un moyen d’évaluer les mutations chromosomiques de
structure et de nombre. Il s’agit donc d’un test adapté à la
mise en évidence de remaniements génomiques comple-
xes consécutifs tant à des cassures chromosomiques qu’à
des altérations des protéines se traduisant par des anoma-
lies chromosomiques quantitatives. Son protocole aisé,
son interprétation non ambiguë et son coût modéré expli-
quent l’utilisation sans cesse croissante de ce test qui, de
surcroît, est particulièrement indiqué dans la détermina-
tion des événements aneugènes [3, 4]. En plus de sa capa-
cité à détecter les micronoyaux (cassures et pertes chro-
mosomiques), le test des micronoyaux avec blocage de la
cytodiérèse peut apporter d’autres mesures de génotoxi-
cité et de cytotoxicité : 1) chromosomes dicentriques
(réarrangement chromosomique) ; 2) bourgeonnements
nucléaires (amplification génique) ; 3) inhibition de la
division cellulaire (par la mesure de l’index de division
nucléaire) ; 4) nécrose et apoptose. Le test des micro-
noyaux avec blocage de la cytodiérèse peut de ce fait être
considéré comme un « cytome » essai couvrant les
champs de l’instabilité chromosomique, de la dysfonction
mitotique, de la prolifération cellulaire et de la mort cellu-
laire [5].
Micronoyaux et risque cancérogène
L’hypothèse de la prédictivité des micronoyaux sur le ris-
que cancérogène est supportée par une récente analyse des
résultats de différentes cohortes européennes (projets
HUMN et CancerRisk Biomarkers) qui a montré que les
sujets ayant une fréquence des micronoyaux élevée
avaient plus de risque de développer un cancer 12 à 15 ans
après la réalisation du test [6]. Cette association était pré-
sente dans toutes les cohortes nationales et pour la majo-
rité des localisations cancéreuses, et notamment pour les
cancers gastro-intestinaux et uro-génitaux [7].
Test des micronoyaux :
de la toxicologie génétique
à la biosurveillance
Le test des micronoyaux avec blocage de la cytodiérèse est
la méthode de choix pour évaluer la fréquence des micro-
noyaux dans les cellules humaines cultivées ex vivo ainsi
que sur les lignées cellulaires, car l’identification des cel-
lules micronucléées et leur dénombrement sont limités
revue générale
Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007358
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

aux cellules qui ont subi un seul cycle cellulaire, ces der-
nières étant aisément identifiables car elles sont binucléées
[8] (figure 1, partie gauche). La terminologie test des
micronoyaux employée tout au long de l’article renvoie à
cette méthode. La limitation de la détermination des
micronoyaux au sein des cellules binucléées permet de
s’affranchir d’un facteur de variation majeur : les cinéti-
ques de division cellulaire non optimales, fréquentes face
à un environnement génotoxique.
Test des micronoyaux in vitro
Le test des micronoyaux peut être réalisé sur un grand
nombre de types cellulaires, qu’il s’agisse de lignées cel-
lulaires ou de primocultures, pour documenter in vitro la
toxicité de produits chimiques. Des exemples de cellules
couramment utilisées dans le cadre des applications
in vitro sont les cellules ovariennes de hamster chinois
(cellules CHO), les cellules de lymphomes de souris telles
que les L5178Y, les fibroblastes de hamsters chinois (cel-
lules V79). Appliqué in vitro à des lymphocytes en cul-
ture, le test des micronoyaux permet d’évaluer les anoma-
lies chromosomiques de nombre et de structure induites
par des substances génotoxiques. Les micronoyaux repré-
sentent tantôt la conséquence des lésions primaires de
l’ADN non létales et non réparées conduisant à des cassu-
res chromosomiques, tantôt des dysfonctionnements des
structures protéiques impliquées dans la bipolarité du
fuseau mitotique (disjonction et migration des chromoso-
mes fils) induisant des pertes de chromosomes entiers [6].
Test des micronoyaux in vivo
Les micronoyaux peuvent être, soit le témoin d’une insta-
bilité génétique, soit un biomarqueur d’effet mettant en
évidence des dommages chromosomiques induits par des
agents mutagènes/cancérogènes [9]. L’association de
l’hybridation in situ fluorescente permet de différencier
les micronoyaux contenant des fragments chromosomi-
ques acentromériques (MNC-) résultant de cassures chro-
mosomiques et ceux contenant des chromosomes entiers
centromériques (MNC+) résultant de pertes chromosomi-
ques [10] (figure 1, partie droite). L’utilisation de sondes
centromériques spécifiques permet aussi d’approcher les
phénomènes de non-disjonction chromosomique [5]. Le
test des micronoyaux a été employé dans diverses études
auprès de sujets professionnellement exposés à des orga-
nochlorés, aux cytostatiques, aux hydrocarbures aromati-
ques polycycliques, aux rayonnements ionisants [9].
Le test des micronoyaux est un biomarqueur empreint
d’une grande variabilité. Il existe d’abord une variabilité
inter-laboratoire (différences de protocole et/ou de critères
de lecture) [11] et une importante variabilité interindivi-
duelle liée à des facteurs propres à l’individu (sexe, âge)
ou à son mode de vie (tabagisme, alcool, habitudes ali-
mentaires) [12]. La prise en compte de ces facteurs peut se
faire par l’utilisation d’un questionnaire standardisé et par
la constitution, parallèlement aux sujets malades ou expo-
sés professionnellement, d’un groupe témoin apparié sur
ces facteurs de variation et ne différant que pour ce qui
concerne le paramètre étudié.
Prélèvement de
sang périphérique
Sang total
en culture
Stimulation de
la prolifération des
lymphocytes T
(activation mitogénique
par la phytohemagglutinine M)
Mitose
Inhibition de
la division
du cytoplasme
en fin de mitose
(blocage de la cytodiérèse
par la cytochalasine B)
Lymphocytes
binucléés
micronucléés
Formation d’un
ou de plusieurs
micronoyaux
Détermination
du contenu
centromérique
des micronoyaux
MN
MNC-
MNC+
Hybridation
in situ
fluorescente
Figure 1. Principe du test des micronoyaux, avec blocage de la cytodiérèse, associé à l’hybridation in situ fluorescente de sondes
pancentromériques. Pour chaque sujet, 1 000 lymphocytes binucléés sont observés et les cellules micronucléées contenant un ou
plusieurs MN (jusqu’à 6 MN) sont comptabilisées selon les critères définis par Fenech [29]. Pour chaque cellule micronucléée, le
nombre de MN est enregistré, de même que la présence ou non de centromères dans les MN (MNC- ou MNC+) et le nombre de spots
de fluorescence (correspondant chacun à un centromère donc à un chromosome) au sein de chaque MNC+. MN : micronoyaux ;
MNC- : fragments chromosomiques acentromériques ; MNC+ : chromosomes entiers centromériques.
Micronoyaux et polymorphismes génétiques
Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007 359
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Origine des lésions de l’ADN
et polymorphisme génétique
Lésions de l’ADN et anomalies chromosomiques
Les agents mutagènes/cancérogènes subissent en général
plusieurs transformations métaboliques dans l’organisme,
ce qui peut conduire à leur élimination mais aussi parfois à
la formation de composés capables d’altérer les macromo-
lécules cellulaires. Pour lutter contre certaines agressions
d’origine endogène liées à l’hydrolyse spontanée et aux
produits du métabolisme cellulaire oxydatif, à savoir les
espèces radicalaires (ion superoxyde, radical hydroxyle, eau
oxygénée), la cellule est dotée de systèmes enzymatiques
(superoxyde dismutase, glutathion peroxydase, catalase)
chargés d’éliminer ces produits, ainsi que de petites molé-
cules sentinelles (scavenger) capables de capter ces espèces
radicalaires. Ces biotransformations ont lieu selon deux
phases réactionnelles, dites phase I responsable des phéno-
mènes de toxification/fonctionnalisation (comme les cyto-
chromes P450 mono-oxygénases) et phase II responsable
des phénomènes de détoxification/conjugaison (comme les
glutathion S-transférases, N-acétyl-transférases, sulfotrans-
férases) catalysées par les enzymes du métabolisme des
xénobiotiques [13]
. Il s’ajoute à ces enzymes des protéines
de transport de phase III assurant le transfert des métaboli-
tes dans la cellule ou hors de la cellule, par exemple la
protéine P-gp (codée par le gène MDR1 pour multidrug
resistance) et les protéines de la famille ABC (ATP bin-
ding cassette) [13].
La molécule d’ADN est une structure dynamique sujette à
de constants changements. Ces variations sont consécuti-
ves, d’une part, à des erreurs spontanées et, d’autre part, à
des lésions de l’ADN induites par des agents physiques ou
chimiques (ultraviolets, radiations ionisantes, produits
chimiques) qualifiés de génotoxiques. Les cellules ont
donc développé des systèmes de surveillance et de répara-
tion pour maintenir l’intégrité de leur matériel génétique
(réparation par réversion directe, réparation par excision
des nucléotides, réparation par excision des bases, répara-
tion des cassures double brin) [14].
Les systèmes enzymatiques de réparation par réversion
directe (direct reversal repair ou DRR) éliminent les
lésions en catalysant la réaction inverse à celle qui a
conduit à former ces lésions. Ces systèmes de réparation
ont pour avantage d’être hautement spécifiques, ce qui est
également un désavantage puisque leur adaptabilité sera
limitée. Le système de réparation par excision des nucléo-
tides (nucleotide excision repair ou NER) constitue un
système de défense majeur contre les effets des rayonne-
ments ultraviolets solaires. Il peut reconnaître un grand
nombre de lésions de l’ADN et joue un rôle important
notamment dans la réparation des adduits volumineux
(bulky adducts) entraînant une distorsion de la double
hélice [15]. Le système d’excision des bases (base exci-
sion repair ou BER) est le mécanisme de réparation le
plus important vis-à-vis des lésions oxydatives de l’ADN,
qu’elles soient générées lors du métabolisme cellulaire
normal ou à la suite d’exposition à des agents exogènes.
Ce système d’excision-resynthèse permet de réparer, de
façon rapide et fidèle, les lésions d’une base et les cassures
simple brin, le brin intact étant utilisé comme modèle
[14]. Les voies de réparation des cassures double brin
(double strand break repair ou DSBR) sont la recombi-
naison homologue, processus de réparation fidèle, et la
religation directe des extrémités de l’ADN, processus de
réparation fautif pouvant conduire à des erreurs (recombi-
naison illégitime), ainsi qu’à une perte de matériel généti-
que (délétions). En fait, la mise en œuvre de ces processus
de réparation des cassures double brin chez les mammifè-
res varie selon les phases du cycle cellulaire [16]. Des
capacités de réparation des lésions de l’ADN, variables
selon les individus, peuvent expliquer une sensibilité dif-
férente de chacun aux agents mutagènes/cancérogènes et
une prédisposition au cancer [17].
Anomalies chromosomiques
et polymorphisme génétique
À chacune des étapes de la cancérogenèse, depuis la plus
précoce (la génotoxicité) jusqu’à la plus tardive (le clone
tumoral constitué), l’environnement et l’hérédité sont en
étroite interaction. Un champ actuel d’investigation est
d’associer aux biomarqueurs de susceptibilité génétique,
capables de rendre compte de la susceptibilité aux cancers
et de différences interindividuelles dans la réponse à une
exposition génotoxique, le test des micronoyaux, témoin
d’une interaction entre l’environnement et le matériel
génétique de la cellule (figure 2) [2, 18]. Les modulations
des dommages à l’ADN et plus particulièrement de la
fréquence ou du contenu centromérique des micronoyaux
par le polymorphisme génétique de gènes impliqués dans
le métabolisme des xénobiotiques (activation ou détoxifi-
cation), dans la réparation des lésions de l’ADN ou dans le
métabolisme des folates commencent à être largement
documentées [6]. Une récente analyse poolée étudiant
l’influence des polymorphismes génétiques de GSTM1
(Glutathion S-transférases de classue mu 1) et GSTT1
(Glutathion S-transférases de classe thêta 1) sur la fré-
quence des micronoyaux sur lymphocytes périphériques a
montré que les sujets GSTT1 nuls avaient des taux moins
élevés de micronoyaux que ceux GSTT1 positifs [19].
Nous avons également mis en évidence que les individus
GSTM1 positifs présentaient des taux plus élevés de
MNC- comparés à des individus GSTM1 nuls, le poly-
morphisme génétique pouvant également influencer le
mécanisme de formation des micronoyaux et donc le
contenu centromérique des micronoyaux [20, 21].
revue générale
Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007360
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Le polymorphisme génétique correspond à l’existence de
variations dans la séquence de l’ADN à un locus donné.
Ces variations peuvent siéger dans des exons et éventuel-
lement modifier la phase de lecture du gène. Elles sont
donc susceptibles de moduler l’activité des enzymes
impliquées dans le métabolisme des xénobiotiques ou
dans la réparation des lésions de l’ADN [22], mais n’ont
pas de conséquences pathologiques du fait d’une dysfonc-
tion du gène ou de la protéine, ce qui les différencie des
mutations à proprement parler. Globalement, il n’existe
pas de « bon » ou de « mauvais » polymorphisme. Un
même polymorphisme pouvant être « à risque » dans une
situation et inversement « protecteur » dans une autre sui-
vant les types d’exposition et de métabolisation mis en
œuvre. Par ailleurs, la prévalence de certains génotypes
apparaît dépendante de l’ethnie [23].
Polymorphisme génétique
et biomarqueurs de susceptibilité
Méthodes d’analyse
Plus de 99 % du génome est commun à tous les humains.
La fraction restante, bien qu’infime, est essentielle parce
que les variations dans la séquence des acides nucléiques
qu’elle comporte influencent la susceptibilité aux mala-
dies, leur expression clinique et leur évolutivité. Un indi-
vidu porte deux allèles d’un même gène, identiques ou
différents, définissant l’état constitutionnel du gène. Ces
gènes peuvent présenter des variations de deux types : les
polymorphismes de répétition et ceux atteignant un seul
nucléotide. Les premiers qui sont les plus fréquents affec-
tent le nombre des répétitions en tandem d’une même
séquence nucléotidique, encore appelée minisatellite (dix
à quinze nucléotides) ou microsatellite (un à quatre
nucléotides) selon l’étendue de la répétition. Ce nombre
est variable d’un individu à l’autre et se transmet hérédi-
tairement. Les polymorphismes affectant un seul nucléo-
tide (single nucleotide polymorphism ou SNP) consistent
en des variations de base dans un nucléotide, l’une rem-
plaçant l’autre. Il s’y ajoute, beaucoup plus rarement, des
délétions totales ou partielles du gène aboutissant à un
défaut de fonction et des amplifications aboutissant à des
gains de fonction (tableau 1) [13, 24].
L’identification de ces polymorphismes a initialement
reposé sur le dot blot et le Southern blot, techniques se
caractérisant, respectivement, par le dépôt ou le transfert
Biomarqueurs
de susceptibilité
Polymorphisme des gènes
de réparation de l’ADN
Mutations géniques et chromosomiques
Biomarqueurs
d’effet
génotoxique
Expansion clonale
Cancer précoce
Cancer généralisé
Alimentation
Mode de vie
Facteurs environnementaux
Expositions environnementales
et professionnelles
Polymorphisme et induction
des gènes du métabolisme
Bioactivation/détoxification des génotoxiques
Biomarqueurs
d’exposition
Probabilité
de
progression
Efficacité
des
interventions
Lésions endogènes
de l’ADN
Lésions exogènes
de l’ADN
+
Figure 2. Inter-relations des composantes environnementales et génétiques dans le processus de cancérogenèse : place des
biomarqueurs d’exposition et d’effet génotoxique en fonction des polymorphismes des gènes du métabolisme et de réparation de
l’ADN. Les tests de génotoxicité sont susceptibles de quantifier (i) l’intensité des lésions primaires à l’ADN, non encore prises en
charge par les systèmes de réparation de l’ADN et (ii) les mutations géniques et /ou chromosomiques, modifications irréversibles et
transmissibles de l’ADN.
Micronoyaux et polymorphismes génétiques
Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007 361
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%