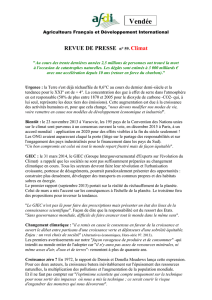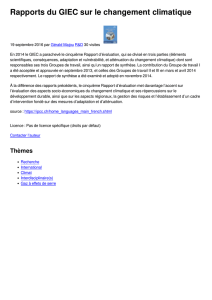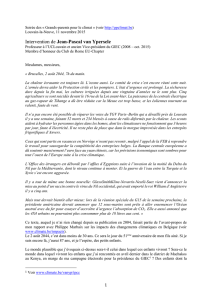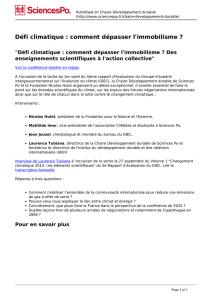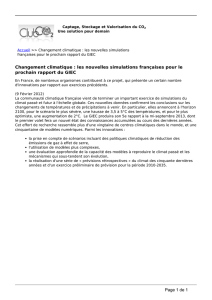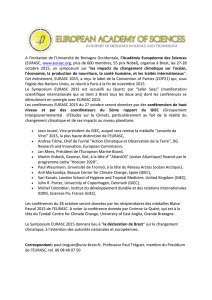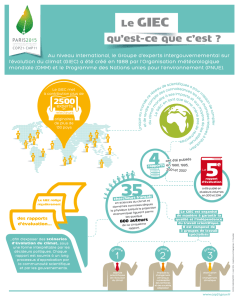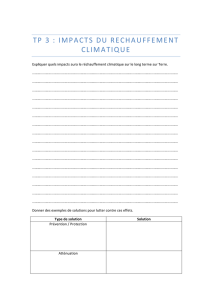Le changement cLimatique entre image et texte1

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ENTRE
IMAGE ET TEXTE1
Nicole d’Almeida et Ana Carolina Peliz2
Cet article présente les résultats d’un travail de recherche consa-
cré à la référence au Groupe Intergouvernemental sur l’Evolu-
tion du Climat (GIEC) dans la presse française (l’analyse d’un
corpus de presse de la presse française concernant la publication
des rapports du groupe (1990, 1995, 2001 et 2007) et dans trois
lms marquants (A. Gore 2006, Y. Arthus Bertrand 2009, N.
Hulot 2009).
La mobilisation de ce corpus écrit et audiovisuel permet de
cerner les contours de la conguration de la question du chan-
gement climatique. Elle permet d’envisager différentes mises
en scène d’une même question et différentes conceptions de la
nature. Elle permet aussi de repérer l’émergence d’une commu-
nauté interprétative polyphonique qui reprend à sa manière les
travaux de ce dénisseur primaire qu’est le GIEC et en fait un
thème dominant de l’agenda national et international.
1 Ce texte est la synthèse de travaux en cours dont nous proposons ici de présenter les
principaux résultats.
2 Nicole d’Almeida est professeure à l’université Paris-Sorbonne, Celsa, laboratoire
GRIPIC ; Ana Carolina Peliz est doctorante à l’université Paris-Sorbonne, GRIPIC.
Recherches en communication, n° 35 (2011).

18 niCoLe d’aLmeida- ana CaroLina PeLiz
Cette analyse permet de comprendre comment la citation-scé-
narisation des travaux d’un groupe d’experts publicise et fait
évoluer d’une question de la sphère purement scientique vers
la sphère politique, sociale et économique en lui conférant une
plus grande répercussion et visibilité.
Cet article est consacré à la publicisation de la question du change-
ment climatique, à l’introduction et circulation dans la sphère publique
d’une question d’abord scientique devenue très vite une question
scientico-politique. Nous nous intéresserons ici à l’installation sociale
de la question climatique et aux différentes congurations médiatiques
revêtues. Le point d’appui de cette analyse est la médiatisation des
travaux du GIEC1, instance située à la jonction de la production scien-
tique et de la décision politique, instance experte dont les rapports
ponctuent l’agenda national et international et suscitent des représenta-
tions particulières de la vie et de l’activité des hommes.
La perspective est communicationnelle, elle concerne l’introduc-
tion, la publicisation et la qualication du thème du changement clima-
tique : les manières de dire et congurer ce changement, de le nommer-
montrer en suscitant des représentations sociales, des questions, des
polémiques, etc.
Deux médias seront pour cela retenus correspondant à deux modes
d’exposition (cinéma et presse écrite), à deux types de public (large
et plus restreint), et à deux perspectives : internationale (des lms à
grand retentissement) et nationale (des titres de la presse quotidienne
française).
Mobiliser un corpus écrit et audiovisuel est à la fois difcile et
intéressant. La difculté consiste à maîtriser l’hétérogénéité des corpus
mais cette hétérogénéité est précisément ce qui nous intéresse ici.
L’objectif est en effet d’analyser des mises en scène de la question
climatique où se croisent paroles, textes, images et chiffres et de repérer
l’émergence d’une communauté interprétative qui se fait à plusieurs
1 Créé en 1988 à la demande du G7 par une agence de l’ONU (le PNUE) et
l’organisation mondiale de la météorologie, le GIEC reçoit de ces instances une
lettre de mission très précise. Les chefs d’état demandent aux chercheurs des
« informations d’origine scientique, technique et socio-économique nécessaires
pour mieux comprendre les fondements scientiques des risques liés au changement
climatique d’origine humaine ». Le GIEC publie son rapport tous les 5 ans environ
(1990, 1995, 2001, 2007), le cinquième rapport étant attendu en 2014.

19
Le ChangemenT CLimaTique enTre image eT TexTe
voix, selon plusieurs médias, tout ceci se déroulant dans un cadre
commun et international de référence. La circulation, la thématisation,
la mise en discussion du changement climatique suscitent au l des
ans l’entrée en scène d’acteurs toujours plus nombreux : de l’échelon
international au national et local, du niveau scientique au niveau poli-
tique et économique, des structures intergouvernementales aux ONG et
leaders d’opinion.
Analyser un corpus cinématographique permet de mesurer le
lancement « grand public » d’une question, son extension (l’élargisse-
ment d’une question scientique vers une question sociale), sa publici-
sation selon divers modes, d’analyser la multiplicité des images lancées
dans l’espace public et des représentations proposées à l’opinion des
publics. Analyser un corpus écrit permet de cerner plus précisément
la sélection-interprétation d’un discours produit par des scientiques,
d’isoler des fragments de discours suspendus de leur espace d’origine
et tissés avec d’autres discours. Cet article se situe donc délibérément
dans le balancement entre images et textes, invitant les auteurs à tenir
sur un plan méthodologique une position d’équilibriste et les incitant à
produire une interprétation uniée d’éléments hétérogènes.
L’environnement au cinéma
« Regarder un lm c’est comme feuilleter un atlas historique »,
cette remarque de W. Benjamin (2000, p. 441) concerne particulière-
ment bien les lms traitant de l’environnement.
Rappelons que l’environnement au cinéma n’est pas une théma-
tique nouvelle : en 1956, le commandant Cousteau reçoit à Cannes la
palme du documentaire pour « Le monde du silence » consacré à la
biodiversité marine. D’autres réalisations suivront, leur multiplication
survenant à partir des années 2000 : multiplication des genres (docu-
mentaires-lms-ctions) et des lieux de production (tous les pays de la
planète). Ce qui est nouveau depuis quelques années, c’est la répétition,
la multiplication industrielle de cette thématique largement déclinée sur
le plan éditorial, cinématographique, télévisuel et électronique. Dans ce
tout éditorial et ce tout visuel qui circule à travers la planète se jouent
une vision du monde (Weltanschaung), une interrogation lancinante sur
son présent et son avenir, une thématisation de la vie et des activités
humaines. Ce ot-ux d’images marque un souci de qualication de
l’existant, de détermination du sens de l’activité voire de la place des

20 niCoLe d’aLmeida- ana CaroLina PeLiz
hommes. Dans la foulée de la thèse de S. Gruzinski (1999), concernant
la puissance de l’image dans le métissage des représentations, nous
retrouvons ici l’extraordinaire capacité des images à traverser les fron-
tières culturelles d’univers que tout oppose, leur plasticité qui autorise
tous les emprunts et suscite la création d’idiomes planétaires.
Les raisons du choix du corpus lmique retenu sont liées à la
personnalité de leur auteur et à leur audience. A. Gore réalise une
conjonction imprévue en obtenant à la fois deux Oscars à Hollywood
(2006) pour son lm Une vérité qui dérange et le Prix Nobel de la paix
2007 en partage avec le GIEC. Y. Arthus Bertrand effectue au printemps
2009 le lancement (multi)médiatique mondial du lm Home, soutenu
en cela par un grand groupe économique (PPR). Enn, la contribution
de N. Hulot en octobre 2009 dans Le syndrome du Titanic se situe à la
jonction du médiatique et du politique, elle s’inscrit dans la foulée du
Pacte écologique, tremplin des élections présidentielles de 2007. Ce
corpus a donc été choisi en raison de sa valeur exemplaire.
Le statut de ces lms pose problème dès lors qu’ils ne relèvent ni
du cinéma du réel, ni du cinéma de ction mais constituent un genre
particulier dans lequel s’entrecroisent des récits documentaires1, des
reportages, des récits personnels et des citations de travaux scientiques
et de personnalités. Le traitement que nous proposons de ces trois lms
n’est pas strictement textuel ou stylistique, sa visée est interprétative : il
s’agit de comprendre la constitution d’une communauté de préoccupa-
tions par le repérage de procédés communs et unités de sens communes
dans lequel s’effectue le passage du monstratif au démonstratif.
Trois points de vue sont mobilisés dans ce corpus, tous trois parti-
cipant d’une visée pédagogique dès lors que « le passage de l’inten-
tion narrative à l’intention didactique est le passage d’une pertinence
d’ordre temporel à une pertinence d’ordre logique » (Jacquinot, 1977,
p. 83). Le point de vue d’Al Gore est celui de l’homme fait, détaché
et engagé à la fois : celui qui a accompli une mission politique, a pris
connaissance des dernières avancées de la science. Relatant une expé-
rience familiale douloureuse il renaît d’une certaine manière au monde
en enseignant, prenant la posture d’un conférencier présenté face à son
public, équipé d’un ordinateur où il puise les informations énoncées.
C’est le point de vue de l’homme éclairé par l’action politique et par la
1 Nommés « documenteurs » par Agnés Varda.

21
Le ChangemenT CLimaTique enTre image eT TexTe
connaissance scientique, de nombreux tableaux et graphiques accom-
pagnent son propos. C’est aussi le point de vue de l’homme éclairant,
pédagogue face à un public, prédicateur diront certains. Le point de vue
de Y. Arthus Bertrand est celui de la planète vue du ciel : point de vue de
Sirius (position de hauteur et de distance), point de vue du Créateur qui
en son septième jour contemple l’œuvre accomplie et qui au 77° jour
contemple le désastre. La référence est ici clairement faite à la Genèse
et à la création du monde, point sur lequel s’ouvre le lm. Le choix est
celui d’un point de vue divin ou transcendant, la planète est montrée
et ses dégâts désignés. L’œil est extérieur et lointain, ce point de vue
reprenant une posture classique et quasiment théologique selon laquelle
c’est de loin que se mesure la beauté du monde ou les outrages qui lui
sont causés1. A l’opposé, le point de vue de N. Hulot est intérieur, il est
celui du témoignage et de la confession dans une perspective didactique
« donner la conscience de notre inconscience ». Le point de vue est
immanent, le sort de la planète est vécu, il est l’objet d’une expérience
intérieure, d’un œil intérieur qui se porte sur le monde (cf l’œil de l’af-
che du lm), organe de l’intellect, de la compréhension : l’œil qui voit
et décrypte le monde , l’œil qui regarde regarder et s’étonne du regard
des autres totalement tendu vers les médias et oublieux de l’essentiel
(la prolifération d’extraits TV, radios, publicités nous renvoie à notre
condition moderne d’êtres assujettis à l’écran). La dimension théolo-
gique est fortement présente dans ces lms (mobilisant tour à tour la
posture du divin-observateur, du prédicateur-éducateur et du pécheur
repenti) ce qui ne l’empêche pas de s’articuler avec une dimension
scientique et politique tout aussi clairement assumée.
Une même certitude anime ces trois lms : le changement clima-
tique est assimilé sans détour au réchauffement climatique d’une part,
les hommes et leurs activités sont responsables d’autre part.
La question de la différence entre hypothèse et preuve, incerti-
tude et certitude n’apparaît aucunement dans ces lms qui citent les
travaux du GIEC mais sans en reprendre la prudence, sans évoquer
les indices de conance établis par les experts internationaux : prati-
quement certain supérieur à 99%, extrêmement probable au dessus de
95%, très probable supérieur à 90%. Rappelons que l’indice retenu et
conrmé dans le résumé du GIEC à l’intention des décideurs publié en
1 Cf. Leibniz, Essais de Théodicée (1710) : les imperfections de la création sont liées
à une erreur du point de vue généralement trop proche.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%