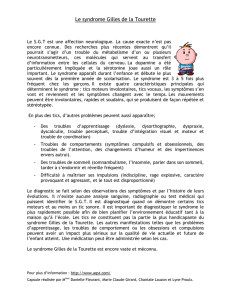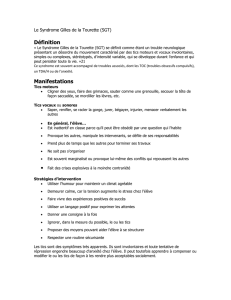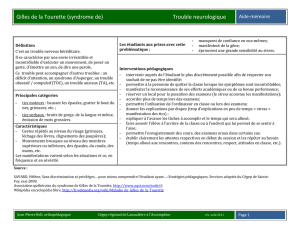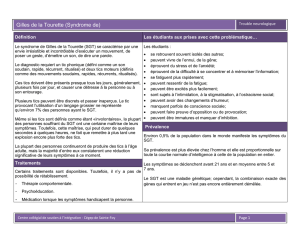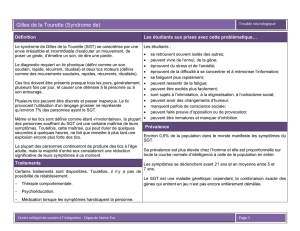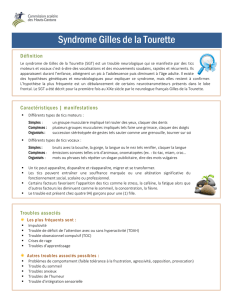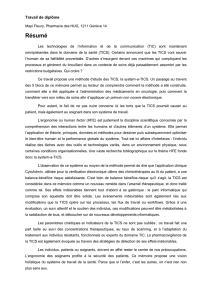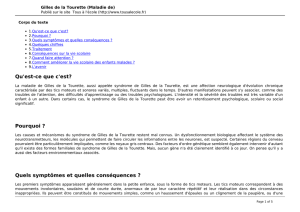Lire l`article complet

194 | La Lettre du Neurologue • Vol. XVII - no 7 - septembre 2013
MISE AU POINT
Le syndrome
Gilles de la Tourette
Gilles de la Tourette syndrome
A. Hartmann*
* Centre de référence national
maladies rares “syndrome Gilles de
la Tourette”, pôle des maladies du
système nerveux, et UPMC/Inserm
UMR S975 ; Centre de recherche
de l’institut du cerveau et de la
moelle épinière, hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, Paris.
Le syndrome Gilles de la Tourette (SGT) est un
syndrome neuro-développemental rare, repré-
sentant la forme la plus sévère d’un ensemble
plus vaste de maladies caractérisées par des tics.
Les tics sont des manifestations motrices et vocales
anormales, brèves, soudaines, non rythmiques,
involontaires, stéréotypées et répétitives, dont
la présentation (plasticité des tics), la fréquence
(périodes d’exacerbation entrecoupées de rémis-
sions/évolution en dents de scie) et la complexité
sont extrêmement variables d’un patient à l’autre
et au cours de leur vie. Les tics apparaissent généra-
lement entre 5 et 7 ans, avec un pic de sévérité entre
9 et 11 ans (1). La sévérité des symptômes varie de
formes légères − sans retentissement marqué sur
la scolarité et l’intégration sociale −, à des formes
plus sévères − souvent associées à des troubles
psychiatriques comme des troubles obsessionnels
compulsifs, une hyperactivité, des troubles de
l’attention, des actes d’automutilation ou des crises
de rage. Bien que les comorbidités psychiatriques
soient fréquentes (environ 90 % des patients), les tics
constituent le symptôme principal et la condition
sine qua non du SGT. Ils permettent sa classication
dans le cadre nosographique des pathologies du
mouvement (diagnostic différentiel) [tableau I].
Épidémiologie
Les caractéristiques épidémiologiques de la maladie
sont encore aujourd’hui mal connues. Les chiffres
disponibles sont très variables et dépendent de
l’âge au moment de l’évaluation et des difcultés
diagnostiques liées à la variabilité et à l’hétéro-
généité de la présentation clinique. La prévalence
varie en fonction des classes de population : elle est
actuellement évaluée entre 0,3 % et 0,8 % de la
population infantile et adolescente (2) sur la base
des critères diagnostiques du DSM IV-TR (tableau II).
Le prol évolutif de la maladie, assez singulier, se
fait vers une aggravation de la symptomatologie
à l’adolescence, puis vers une amélioration, voire
une rémission complète à l’âge adulte : seuls 25 %
des patients atteints d’un SGT gardent un handicap
modéré à sévère une fois l’âge adulte atteint (3).
Ce pronostic favorable est à souligner auprès des
patients mineurs et de leurs parents.
Tableau I. Diagnostic différentiel des tics.
• Myoclonie
• Dystonie
• Chorée
• Dyskinésies paroxystiques
• Hémiballisme
• Spasmes hémifaciaux
• Stéréotypies
• Maniérisme
• Compulsions
• Akathisie
• Syndrome des jambes sans repos
• Épilepsie
Tableau II. Critères DSM IV-TR du SGT.
• Début avant l’âge de 18 ans
• Présence de tics moteurs multiples
• Au moins un tic vocal à un moment quelconque
del’évolution (pas nécessairement simultanément
auxticsvocaux)
• Les tics surviennent à de nombreuses reprises au cours de
la journée, presque tous les jours ou de façon intermittente
pendant plus d’une année durant laquelle il n’y a jamais
eu d’intervalle sans tics de plus de 3 mois consécutifs
Les tics ne sont pas dus aux effets normaux d’une substance
(par exemple, des stimulants) ou à une autre maladie

La Lettre du Neurologue • Vol. XVII - no 7 - septembre 2013 | 195
Points forts
»
Le syndrome Gilles de la Tourette (SGT) est une maladie caractérisée par la présence de tics moteurs et
vocaux, même si les comorbidités psychiatriques sont fréquentes et souvent au premier plan du handicap
lié au SGT.
»
Le SGT débute dans l’enfance avec un pronostic favorable, à savoir une rémission des tics chez les trois
quarts des patients atteignant l’âge adulte.
»L’étiologie du SGT est organique, vraisemblablement liée à un déficit de migration neuronale et sous-
tendue par une transmission génétique complexe.
»
Une variété de traitements existent aujourd’hui pour traiter les tics : neuroleptiques de dernière génération,
injections de toxine botulique, thérapies cognitivo-comportementales et stimulation cérébrale profonde.
Mots-clés
Tics
Syndrome Gilles de la
Tourette
Aripiprazole
Toxine botulique
Thérapies cognitivo-
comportementales
Highlights
»
Gilles de la Tourette
syndrome (GTS) is a disease
characterized by the pres-
ence of motor and vocal tics,
although psychiatric comor-
bidities are frequent and
often determine the handicap
induced by the syndrome.
»
GTS begins in childhood
with an overall favourable
prognosis, since around 75%
of patients go into remission
once they reach adulthood.
»
GTS etiology is organic, most
likely due to deficits in neuronal
migration and linked to a
complex genetic transmission.
»
A variety of treatments is
available nowadays for treating
tics: last generation neurolep-
tics, botulinum toxin injections,
cognitive-behavioural thera-
pies, deep brain stimulation.
Keywords
Tics
Gilles de la Tourette
syndrome
Aripiprazole
Botulinum toxin
Cognitive-behavioural
therapy
Physiopathologie
Anatomie
Au niveau anatomique, 2 structures cérébrales,
ainsi que les circuits les reliant, ont été mises en
cause : les ganglions de la base et le cortex. Au sein
même des ganglions de la base, une défaillance des
mécanismes de sélection des programmes moteurs
a été avancée (4). Ainsi, lors de l'exécution d’un
programme moteur, d’autres programmes concur-
rentiels sont inhibés au niveau du globus pallidus
interne et de la substance noire pars reticulata. Si
ce mécanisme d’inhibition striatal est altéré, tics
et autres comportements répétitifs peuvent alors
survenir. Deux études post mortem récentes plaident
en faveur d’un tel mécanisme, en mettant en évidence
une diminution du nombre d’interneurones GABAer-
giques parvalbumine-positifs et cholinergiques dans
le striatum, particulièrement dans le noyau caudé,
et une augmentation de ces mêmes neurones
dans le segment interne du globus pallidus (5). Les
auteurs expliquent les variations de densité de cette
catégorie de neurones par une défaillance dans la
migration tangentielle des interneurones GABAer-
giques et cholinergiques au cours de l’embryogenèse.
Il en résulterait par conséquent une défaillance du
contrôle inhibiteur au niveau du striatum et du
pallidum. Ce défaut d’inhibition pourrait s’étendre
au cortex et a été indirectement conrmé par des
études électrophysiologiques (6), qui ont montré
la diminution de l’inhibition intracorticale chez des
patients atteints d’un SGT. Inversement, certaines
anomalies corticales (en particulier certaines varia-
tions de l’épaisseur corticale en fonction de l’âge des
patients et de la durée de la maladie) détectées par
différentes méthodes de neuro-imagerie suggèrent
des mécanismes compensatoires ou, en cas de défail-
lance de ces mécanismes, peuvent servir comme
biomarqueurs potentiels lorsqu’il y a persistance
des symptômes à l’âge adulte (7).
Génétique
La génétique du SGT est probablement extrêmement
complexe. Plusieurs modèles de transmission ont été
proposés après l’étude de familles présentant des
tics de sévérité variable. Certains de ces modèles
reposent sur l’hypothèse d’un gène majeur (avec
une pénétrance incomplète et une expressivité
variable), et d’autres favorisent celle d’une trans-
mission mixte, semi-récessive/semi-dominante. Des
études récentes favorisent plutôt l’hypothèse d’une
hérédité polygénique avec un effet additif de gènes
impliqués ; cette suggestion n'est d'ailleurs pas en
contradiction avec l’existence d’un gène majeur dans
certaines familles. Des études de liaison génétique
fondées sur ces hypothèses ont été menées au sein
de familles de patients atteints d’un SGT, et ont
permis l’identication de plusieurs loci, c’est-à-dire
des régions du génome potentiellement ségrégant
avec la présence des tics dans les familles. Mais aucun
gène responsable n’a été rapporté à ce jour. Plus
récemment, des études d’association réalisées sur
l’ensemble du génome (GWAS) chez des milliers de
patients versus des milliers de sujets témoins ont mis
en évidence des régions du génome qui pourraient
contenir des facteurs de susceptibilité au SGT. Mais
ces résultats doivent être reproduits et validés par
d’autres équipes (8). Une deuxième approche a
consisté à caractériser des anomalies chromoso-
miques visibles au caryotype ou par des techniques de
cytogénétique dans des cas sporadiques de SGT. Ces
études ont également permis de proposer plusieurs
régions chromosomiques candidates. Une étude a
identié des mutations du gène SLITRK1 (SLIT and
NTRK-like family, member 1) comme responsables
du SGT chez un petit nombre de patients (9).
Néanmoins, plusieurs études récentes n’ont pas
pu conrmer l’implication réelle du gène SLITRK1
dans de larges cohortes. Son rôle dans le SGT reste
donc controversé. Plus récemment, une étude de
liaison a permis d’identier un gène potentiellement
impliqué dans une famille avec plusieurs membres
atteints de SGT : il s’agit du gène HDC, codant la
L-histidine décarboxylase, une enzyme impliquée
dans le métabolisme de l’histamine (10). La mutation
identiée correspond à une perte de fonction de
l’allèle muté censée réduire la quantité de protéine
fonctionnelle. Toutefois, aucune autre mutation dans
ce gène n’a été trouvée chez un grand nombre de
patients. D’autres études sont donc nécessaires pour
valider le rôle de ce gène dans l’étiologie du SGT.

196 | La Lettre du Neurologue • Vol. XVII - no 7 - septembre 2013
Le syndrome Gillesde la Tourette
MISE AU POINT
Traitements
Principes
Le traitement des tics repose autant sur le bon sens
que sur des études contrôlées qui, du fait de la rareté
du SGT, restent malheureusement peu nombreuses.
Dans un premier temps, conseiller et instruire le
patient, sa famille et son environnement scolaire ou
professionnel sur la nature des tics, les comorbidités et
le pronostic reste un premier pas essentiel. Dans une
grande partie des cas, ces mesures simples, accompa-
gnées d’un suivi régulier, sont sufsantes. La décision
de traiter un tic repose sur 4 critères :
➤
problèmes sociaux (isolement social, moqueries,
etc.) ;
➤
problèmes émotionnels (syndrome dépressif
réactif, phobie sociale, etc.) ;
➤
problèmes fonctionnels (lecture, écriture, etc.) ;
➤douleurs, blessures ou incapacité physique.
Approches pharmacologiques
Pour tout détail sur les traitements pharmaco-
logiques (tableau III), nous préconisons en parti-
culier les recommandations européennes récemment
publiées (11). Historiquement, le traitement des tics
est avant tout fondé sur l’utilisation des neuro-
leptiques, en premier lieu l’halopéridol. Parmi les
neuroleptiques “classiques” (en raison de leur afnité
particulière pour les récepteurs D2), le pimozide
semble être aussi efcace que l’halopéridol et présente
moins d’effets indésirables, notamment la sédation et
la prise de poids, ainsi que la survenue de syndromes
extrapyramidaux. Depuis peu, les neuroleptiques
“atypiques” sont généralement favorisés, en raison
d’un blocage moins puissant des récepteurs D2 et d'un
antagonisme des récepteurs 5-HT2A et 5-HT2C, ce
qui réduit le risque de syndromes parkinsoniens et de
dyskinésies tardives. Parmi eux, le rispéridone offre
le meilleur niveau de preuve. Néanmoins, les effets
secondaires métaboliques (glucose, lipides, prolactine)
sont à surveiller de près. Le risque de dépression liée
aux effets anti sérotoninergiques de cette molécule
est également à prendre en compte.
Au cours des dernières années, l’aripiprazole a
été considéré comme une molécule de première
intention dans le traitement des tics, même s’il ne
possède pas d’autorisation de mise sur le marché
(AMM) pour cette indication. Étant un agoniste
partiel des récepteurs D2 et 5-HT1A, et un anta-
goniste des récepteurs 5-HT2A, il offre un mécanisme
d’action particulier. Les études ouvertes conduites
à ce jour (11) suggèrent une efcacité remarquable
de cette molécule avec un effet sédatif et orexigène
bien moindre que tout autre neuroleptique. Aussi,
beaucoup de patients insistent sur les effets compor-
tementaux favorables de l’aripiprazole, à savoir un
effet tranquillisant sans sédation (12). À noter,
néanmoins, un risque d’akathisie et d’irritabilité (en
début de traitement) plus important que pour les
autres neuroleptiques. Malheureusement, aucune
étude contrôlée n’a été conduite pour l’aripiprazole
dans le traitement des tics et la molécule tombera
dans le domaine public en 2014. Néanmoins, une
formule à libération prolongée (prise hebdoma-
daire) est actuellement à l'essai chez l’enfant et
chez l’adulte avec des résultats attendus n 2013
(ClinicalTrials.gov : NCT01418352 et NCT01418339).
Finalement, nous insistons sur l’utilité potentielle
de la toxine botulique dans le cas de tics isolés.
La toxine botulique offre l’avantage d’une inter-
vention ciblée et restreinte dans le traitement de
certains tics sévères et potentiellement dangereux
(notamment ceux de la nuque). Il a également été
proposé qu’une injection dans les cordes vocales
pouvait être efcace dans les cas de tics vocaux
importants (13). Phénomène intéressant, on a pu
Tableau III. Approches pharmacologiques dans le traitement des tics (adapté de Scahill et al.,
2006).
Neuroleptiques Support
empirique
Doses de début
(mg)
Doses thérapeutiques
(mg/j)
Halopéridol A 0,25-0,5 1-4
Pimozide A 0,5-1,0 2-8
Rispéridone A 0,25-0,5 1-3
Fluphénazine B 0,5-1,0 1,5-10
Tiapride B 50-150 150-500
Olanzapine C 2,5-5,0 2,5-12,5
Sulpiride C 100-200 200-1 000
Aripiprazole C 2,5-5,0 5-20
Autres
Clonidine B 0,0025-0,05 0,1-0,3
Guanfacine B 0,5-1,0 1-3
Toxine botulique B 30-300 U/site d’injection
Tétrabénazine C 12,5-25 25-150
Baclofène C 10 40-60
Patch de nicotine C 7 7-21
Mécamylamine C 2,5 2,5-7,5
Niveau de preuve
Catégorie A : preuve bonne concernant l’efficacité et la tolérance à court terme, fondée sur au moins 2 études
randomisées contre placebo
Catégorie B : preuve moyenne concernant l’efficacité et la tolérance à court terme, fondée sur au moins 1étude
randomisée contre placebo
Catégorie C : preuve minimale concernant l’efficacité et la tolérance à court terme, fondée sur des études ouvertes
et l’expérience clinique cumulative

La Lettre du Neurologue • Vol. XVII - no 7 - septembre 2013 | 197
MISE AU POINT
observer que les sensations prémonitoires semblent
diminuer, voire disparaître, après injections répétées.
Approches psychothérapeutiques
Les approches psychothérapeutiques sont proposées
en cas de tics légers à modérés pour les patients ne
souhaitant pas, ou ne supportant pas, les traitements
pharmacologiques classiques. Parmi les nombreuses
techniques étudiées à ce jour, c’est en premier lieu la
technique dite “inversion d’habitude” (Habit Reversal
Training [HRT]) qui a obtenu un niveau de preuve élevé.
Une autre technique, appartenant aussi au registre
cognitivo-comportemental, est celle de l’“Exposure
Response Prevention” (ERP) qui consiste à l’habituation
graduelle de la suppression des tics tout en évitant
le phénomène de rebond. Ces techniques cognitivo-
comportementales (TCC) constituent un grand espoir
dans la prise en charge de nos patients ; leur appli-
cation à travers tout le territoire français nous semble
être une priorité dans les années à venir. En raison
de leur importance, nous les détaillons ci-dessous.
◆Technique d’inversion d’habitude
Dans le traitement des tics, le HRT est la technique
psychothérapeutique qui a bénécié du plus grand
intérêt dans la littérature à ce jour (14). Le HRT est
une thérapie à composantes multiples : il comprend
une phase de prise de conscience des tics (self-
management), une phase principale d’inversion des
habitudes, et, enn, une phase de généralisation et de
soutien psychosocial. L’inversion des habitudes, qui
constitue le cœur de la technique, consiste à élaborer
et à mettre en place un geste antagoniste qui entre
en compétition avec le mouvement du tic. L’objectif
est de rendre impossible la réalisation motrice du tic.
Il s’agit donc d’une contraction musculaire incom-
patible avec le mouvement du tic : par exemple, une
contraction des mâchoires avec les lèvres serrées
l’une contre l’autre face à un tic d’ouverture de la
bouche ou de bâillement, ou encore, une exion du
cou vers l’avant pour désamorcer un mouvement de
tête vers l’arrière. Ce mouvement doit être instauré
dès que l’individu perçoit la sensation prémonitoire,
et maintenu pendant 1 à 3 minutes, ou jusqu’à ce que
disparaisse la sensation de gêne. À terme, la résis-
tance à la réalisation du tic permettrait la diminution
de l’envie de “tiquer”, parfois jusqu’à la disparition
totale du tic. En général, il est proposé entre 8 et
15 séances, d’une durée d’une heure environ, à une
fréquence hebdomadaire dans un premier temps,
puis bimensuelle. La durée de la thérapie va dépendre
principalement de la facilité de l’individu à ressentir la
sensation prémonitoire et du nombre de tics à traiter.
Dans cette thérapie en effet, le rôle de la sensation
prémonitoire est fondamental, puisque c’est sur
elle que repose la mise en place de la technique
d’inversion des habitudes. Par ailleurs, le HRT s’inté-
resse au traitement des tics de façon sérielle, ces
derniers ayant été hiérarchisés par le patient selon
leur caractère invalidant lors des premières séances.
Ainsi, cette technique sera davantage recommandée
à des patients capables de ressentir la survenue de
leurs tics et qui n’en présentent pas un grand nombre.
À ce jour, 14 études de cas et 8 essais contrôlés et
randomisés ont investigué le bénéce du HRT (14).
L’efcacité sur la réduction de la sévérité des tics varie
de 30 à 100 %. Aucun phénomène de substitution
n’a été rapporté. Les 2 plus importantes publications
en termes de critères méthodologiques et de taille
des échantillons résultent d’études américaines
récentes portant sur des populations d’enfants (15)
et d’adultes (16). Dans la première étude, 126 enfants
et adolescents (âgés de 9 à 17 ans) présentant des
tics chroniques ou un SGT dans des formes sévères
à modérées ont été randomisés en 2 groupes : un
groupe bénéciant d’une thérapie comportementale
reposant sur la technique du HRT et un groupe suivant
le même nombre de sessions en thérapie de soutien
et psycho-éducation (8 sessions sur 10 semaines).
Plus de la moitié des enfants du groupe d’étude ont
présenté une amélioration signicative de la sévérité
de leurs tics et de leur fonctionnement psychosocial,
contre moins d’un tiers dans le groupe témoin. Parmi
les enfants répondant au traitement, 87 % ont
maintenu le bénéce de la thérapie 6 mois après la n
du traitement. Le même paradigme d’étude a été suivi
dans la seconde publication chez 122 adultes. À l’issue
des 8 sessions, 38 % des patients ayant bénécié de
la thérapie comportementale ont vu une amélioration
de la sévérité des tics contre 6 % des patients avec
la thérapie de soutien. Comme dans la précédente
étude, la thérapie comportementale a également eu
des retentissements positifs sur la qualité de vie et
le fonctionnement psychosocial.
◆Technique d’exposition préventive
Une autre technique, appartenant également au
registre cognitivo-comportemental, est celle de
l’exposition préventive (ERP). Les TCC reposent
sur l’association négative entre une sensation
désagréable (urge to do) et la réalisation du tic qui
vient soulager cette tension. Mais la réalisation du
tic va réactiver la survenue de la sensation de urge to
do. La technique ERP contraint les patients, de façon

L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
Le syndrome Gillesde la Tourette
MISE AU POINT
graduelle, à se confronter à leurs sensations prémo-
nitoires désagréables en retenant la réalisation des
tics. La thérapie commence en général par 2 séances
d’entraînement au cours desquelles l’individu apprend à
réfréner ses tics sur des périodes de plus en plus longues
grâce à des techniques de relaxation. Lors des séances
suivantes, le patient et le thérapeute incitent aux sensa-
tions prémonitoires sur des périodes de plus en plus
prolongées (exposition) an d’accroître la capacité
de résistance aux tics (prévention de la réponse). Le
patient apprend ainsi à tolérer et à gérer les sensations
de urge to do par un phénomène d’habituation, ce qui,
à terme, permet de diminuer voire de supprimer l’envie
de “tiquer”. Avec cette technique, aucun phénomène
de rebond n’a été observé (17). À ce jour, la principale
étude contrôlée est celle d’une équipe hollandaise qui
a montré une efcacité similaire entre la technique
du HRT et celle de l’ERP dans une population de
43 patients âgés de 7 à 55 ans (18). D’autres essais
sont en cours. L’avantage principal de cette technique
est qu’elle permet de traiter l’ensemble de la sympto-
matologie des tics de manière simultanée. Elle est par
conséquent conseillée à des patients souffrant de tics
multiples. Le deuxième avantage est qu’elle fonctionne
tout aussi bien chez les patients qui ne ressentent que
peu ou pas les sensations prémonitoires, notamment
les enfants, très réceptifs à cette technique.
Approches neurochirurgicales
Au cours des 20 dernières années, la stimulation
cérébrale profonde (SCP) a fait la preuve de son
efficacité dans un grand nombre de pathologies
du mouvement, à commencer par la maladie de
Parkinson. La SCP offre une promesse thérapeutique
considérable dans le traitement des tics pharmacoré-
sistants. Contrairement à la maladie de Parkinson, le
SGT n’est pas une affection neurodégénérative ; une
amélioration durable de la symptomatologie peut
donc être envisagée sans modication des paramètres
de stimulation au cours du temps. Les cibles testées
sont le globus pallidus interne (territoire sensori-
moteur et limbique), le thalamus (noyaux médians
et intralaminaires), la capsule interne (bras antérieur)
et le noyau accumbens (19).
Les résultats obtenus sont encourageants, mais il
est nécessaire de rappeler l’absence d’études rando-
misées, contrôlées et en double aveugle, même si
plusieurs essais sont en cours à l’heure actuelle. Parmi
les questions à résoudre gurent celles des comorbi-
dités, de la dénition de la pharmacorésistance, de la
qualité de vie (au-delà d’une simple réduction des tics)
et de l’âge de l’intervention. Concernant ce dernier
point, il est important de rappeler que, en l’absence
de critères pronostiques clairs pour l’évolution du
SGT, les enfants et les adolescents sont susceptibles
d’avoir une amélioration spontanée et substantielle
lors de l’entrée à l’âge adulte. Ainsi, une conférence
de consensus stipule d’attendre l’âge de 25 ans avant
l’intervention (20). Néanmoins, dans des formes
juvéniles très sévères entraînant une désocialisation et
une déscolarisation complète, la question d’une SCP
reste posée, d’autant plus qu’il s’agit d’une technique
réversible. Ces considérations relèvent aussi bien du
domaine médical qu’éthique et nécessiteront une
attention particulière dès que les résultats d’études
cliniques contrôlées seront disponibles. ■
1. Leckman JF, Zhang H, Vitale A et al. Course of tic seve-
rity in Tourette syndrome: the first two decades. Pediatrics
1998;102(1 Pt1):14-9.
2. Knight T, Steeves T, Day L et al. Prevalence of tic disor-
ders: a systematic review and meta-analysis. Pediatr Neurol
2012;47(2):77-90.
3. Bloch MH, Peterson BS, Scahill L et al. Adulthood
outcome of tic and obsessive-compulsive symptom severity
in children with Tourette syndrome. Arch Pediatr Adolesc
Med 2006;160(1):65-9.
4. Albin RL, Mink JW. Recent advances in Tourette syndrome
research. Trends Neurosci 2006;29(3):175-82.
5. Kataoka Y, Kalanithi PS, Grantz H et al. Decreased
number of parvalbumin and cholinergic interneurons in
the striatum of individuals with Tourette syndrome. J Comp
Neurol 2010;518(3):277-91.
6. Orth M, Amann B, Robertson MM et al. Excitability
of motor cortex inhibitory circuits in Tourette syndrome
before and after single dose nicotine. Brain 2005;128(Pt
6):1292-300.
7. Worbe Y, Gerardin E, Hartmann A et al. Distinct structural
changes underpin clinical phenotypes in patients with Gilles
de la Tourette syndrome. Brain 2010;133(Pt12):3649-60.
8. Scharf JM, Yu D, Mathews CA et al. Genome-wide associa-
tion study of Tourette’s syndrome. Mol Psychiatry 2012;doi:
10.1038/mp.2012.69. [Epub ahead of print]
9. Abelson JF, Kwan KY, O’Roak BJ et al. Sequence variants
in SLITRK1 are associated with Tourette’s syndrome. Science
2005;310(5746):317-20.
10. Ercan-Sencicek AG, Stillman AA, Ghosh AK et al. L-histi-
dine decarboxylase and Tourette’s syndrome. N Engl J Med
2010;362(20):1901-8.
11. Roessner V, Plessen KJ, Rothenberger A et al. European
clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disor-
ders. Part II: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc
Psychiatry 2011;20(4):173-96.
12. Budman C, Coffey BJ, Shechter R et al. Aripiprazole in
children and adolescents with Tourette disorder with and
without explosive outbursts. J Child Adolesc Psychophar-
macol 2008;18(5):509-15.
13. Porta M, Maggioni G, Ottaviani F et al. Treatment of
phonic tics in patients with Tourette’s syndrome using botu-
linum toxin type A. Neurol Sci 2004;24(6):420-3.
14. Frank M, Cavanna AE. Behavioural treatments for
Tourette syndrome: an evidence-based review. Behav Neurol
2013;27(1):105-17.
15. Piacentini J, Woods DW, Scahill L et al. Behavior therapy
for children with Tourette disorder: a randomized controlled
trial. JAMA 2010;303(19):1929-37.
16. Wilhelm S, Peterson AL, Piacentini J et al. Randomized
trial of behavior therapy for adults with Tourette syndrome.
Arch Gen Psychiatry 2012;69(8):795-803.
17. Verdellen CW, Hoogduin CA, Keijsers GP. Tic suppres-
sion in the treatment of Tourette’s syndrome with exposure
therapy: the rebound phenomenon reconsidered. Mov Disord
2007;22(11):1601-6.
18. Verdellen CW, Keijsers GP, Cath DC et al. Expo-
sure with response prevention versus habit reversal in
Tourettes’s syndrome: a controlled study. Behav Res Ther
2004;42(5):501-11.
19. Müller-Vahl KR. Surgical treatment of Tourette
syndrome. Neurosci Biobehav Rev 2012;doi:pii: S0149-
7634(12)00165-0. 10.1016/j.neubiorev.2012.09.012. (Epub
ahead of print)
20. Mink JW, Walkup J, Frey KA et al. Patient selection and
assessment recommendations for deep brain stimulation
in Tourette syndrome. Mov Disord 2006;21(11):1831-8.
Références bibliographiques
1
/
5
100%