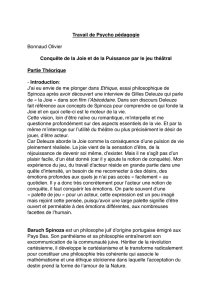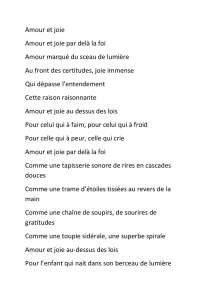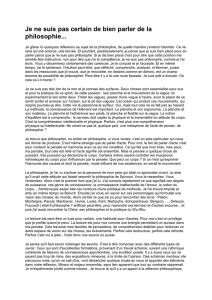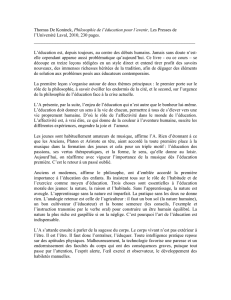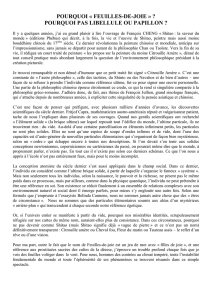Conclusion La philosophie est du désir d`en

100
Conclusion
La philosophie est du désir d’en savoir un peu plus,
elle est donc un certain savoir. C’est le savoir que j’existe.
Découvrir qu’il s’agit de savoir, c’est la clé, c’est le sésame.
Constater qu’il s’agit d’une énigme ne provoque aucun blo-
cage. C’est un savoir énigmatique qui n’est pas fait pour
être compris, mais pour être su. Il est fait de résonances.
Il ne s’apprend pas, il s’écoute. La philosophie est l’oreille
pour cette écoute. L’oreille n’a pas à être ne, il n’y a pas
à éduquer son ouïe. Elle ne doit que s’abandonner. Mon
existence vibre et m’offre ainsi de quoi penser, m’offre la
pensée. La vibration est créatrice. Un paysage qui vibre
produit de la beauté, un humain qui vibre produit de l’hu-
manité, mon existence qui vibre produit de la pensée. La
philosophie nous pousse donc à dire « je ». Au fond, elle
dit toujours « je ». « On », « nous », « l’Être », « la pensée »,
sont des substituts du « je ». Mais elle n’est pas de l’égo-
centrisme, ni de l’égotisme. Car il s’agit de résonances, pas
de différences. Je suis différent de toi, mais ce n’est pas
cela qui compte. Je voudrais juste vibrer comme toi ou je

101
voudrais que tu vibres comme moi. Il n’y a pas d’exclu-
sivité de la résonance. Et pourtant elle m’est plus propre,
cette résonance, que toute différence qui me distingue de
toi. Mais de ce qui m’est le plus propre, tu n’es pas exclu.
Nous sommes tous formés d’une résonance qui a su ou
a pu s’entretenir. Le lm de Marcel Trillat, 300 jours de
colère, raconte l’occupation de leur lieu de travail par les
123 salariés d’une usine textile du groupe Mossley, en liqui-
dation judiciaire. Ils s’accrochent désespérément à leur tra-
vail. Ils s’accrochent aussi passionnément à un lieu. Un lieu
de bruits assourdissants qui se sont brusquement tus, de
machines infernales qui ne tournent plus. On y voit une
ouvrière qui revient à son poste de travail. Elle reproduit le
geste qu’elle devait faire des milliers de fois en une journée.
On imagine les cadences et le vacarme d’enfer. Elle évoque
les allergies, la poussière qui attaquait les yeux. Mais elle
ajoute : « J’ai commencé là-dedans… J’avais dix-sept ans…
J’ai trouvé ça fascinant… C’était beau… » Elle ne veut pas
dire qu’elle trouvait ce travail « intéressant ». Elle veut dire
que ce travail, c’était son lieu, son point de joie et d’ivresse,
son vertige inme à elle. Il pouvait être harassant, ininté-
ressant, dangereux peut-être, mais elle y trouvait sa réso-
nance, son énigme. Elle avait mis sa vie à l’unisson d’une
impression première de beauté qui était sa découverte à
elle. Qui aurait imaginé qu’il y eût là de la beauté, en tout
cas cette beauté dont elle parle avec émotion ?
Comme cette ouvrière, nous nous sommes mis un jour
à vibrer. La source de cette vibration pouvait être une idée,
un lieu, une rencontre, une lecture, une musique. À cette

102
occasion, nous avons surpris le monde, nous lui avons sur-
pris un aspect, un visage, un paysage. Une facette n’était
tournée que vers nous, parce qu’elle naissait de notre seule
présence, du seul et simple fait de notre existence. Il y a
toujours un moment où nous saisissons dans les choses
une beauté à laquelle nous ne pouvions pas nous attendre.
Beauté surprise et qui nous surprend. Ainsi Swann, le per-
sonnage de Proust, capte un jour dans les traits d’Odette
une ressemblance avec le visage d’une lle de Jéthro dans
la fresque de Botticelli. Il lui trouve alors une beauté qu’il
n’attendait pas chez cette femme qu’il n’avait jamais trouvée
vraiment belle et qui n’était pas son genre. Comme Swann,
nous sommes tous les inventeurs d’une forme insoupçon-
née de beauté. Nous ne savons vivre qu’à partir de notre
trouvaille à nous. Il n’y a pas d’autre solution. La philo-
sophie est le résultat de cette absence absolue d’alterna-
tive : on ne peut penser qu’en faisant vibrer notre trouvaille,
qu’en faisant reluire une beauté qui ne vient au monde que
par nous. C’est ce que Socrate cherche à dire à Alcibiade.
« Connais-toi toi-même » veut dire : « Cherche ce que tu
éveilles de beau dans le monde, cherche ta beauté, ta voie
en beauté. » Cette connaissance de soi a la forme d’un soin
de soi-même, comme Socrate le répète à plusieurs reprises
au jeune athénien. Veiller sur soi, c’est entretenir ce que
l’on a éveillé au monde en existant, entretenir la résonance.
Nous ne savons penser et affronter les questions qu’à l’unis-
son de cette résonance. La philosophie reproduit, rejoue
sans cesse cet attachement au monde qui vient d’un petit
bruit premier. Elle est un désir de savoir ce que deviendra

103
cette petite rumeur au l de nos interrogations. Avec cette
petite rumeur se noue une intrigue : la nôtre. Penser, c’est
être attentif au dénouement de cette intrigue.
L’aide que la philosophie peut apporter est de l’ordre du
coup de pouce. Elle n’est donc pas envahissante. Elle n’est
pas un formatage de la pensée. Son intervention dans nos
vies est douce, à peine perceptible. C’est une chiquenaude
qui donne à nos facultés un regain d’énergie. Un peu d’huile
dans les rouages, un peu d’oxygène pour penser. Elle est
l’antidote de toutes les possessions intellectuelles. On peut
être possédé par des idées, par des machines à penser qui
nous tiennent à leur merci. Mais on n’est pas libéré parce
qu’on se dote de nouvelles machines à penser pour vain-
cre des anciennes. La solution est d’alléger la réexion, de
l’aider à faire place nette, à trouver du champ, de l’espace
vide. La résonance, c’est l’espace libre. La philosophie est
l’invitation à penser par soi-même, c’est-à-dire à occuper
cet espace. Permanente incitation qui donne et redonne
conance. On ne reprend pas conance avec de nou velles
armes, mais en découvrant la possibilité de penser sans
armes. Penser sans armes, rééchir sans son armure, c’est
la philosophie.
La philosophie est une joie de penser. Ce n’est pas la joie
de penser en tant que telle, c’est une certaine joie. Nous
l’éprouvons tout à coup, sans que nous nous y attendions,
au détour de nos pensées. C’est une trouvaille. Elle est ana-
logue à la joie du mineur qui découvre un diamant dans
la mine abandonnée par l’entreprise diamantaire, ou à la
joie de découvrir un lieu nouveau dans une ville que l’on

104
connaît par cœur. Elle s’accompagne d’une impression de
croissance intérieure, du sentiment d’une nouvelle donne.
Ne la confondons pas avec la crise mystique, la soudaine
révélation religieuse, ou le coup de foudre amoureux. La
joie philosophique ne bouleverse pas une vie. Elle n’atteint
jamais le stade de l’émotion. Si elle bouleversait, elle per-
drait sa vertu d’effervescence discrète. Elle ne serait plus
désir.
Le secret de la philosophie, c’est qu’elle est au fond un
savoir joyeux. Je dis « au fond », car cela ne transparaît
nullement chez la plupart des penseurs, sauf chez les épi-
curiens, qui font de leur pensée l’expression d’un plaisir
de vivre, sauf aussi chez Nietzsche qui fait de sa philoso-
phie un « gai savoir ». L’ivresse et la joie socratiques sont
devenues souterraines chez la plupart des penseurs. Ils ne
voudraient tenir que des propos dégrisés, mais ils glissent
sur cette ivresse, ils s’y ressourcent. Cela signie qu’ils ne
savent parler que de l’ivresse d’exister et ne savent taire
qu’elle. Chacun est au bord de son problème intime, qui est
un problème obscène. Car ce qui les inspire n’est que leur
existence, le fait purement contingent et banal d’exister.
C’est lui qui vibre dans toutes leurs constructions intellec-
tuelles. Ils ne peuvent progresser dans leur réexion, sortir
de leurs perplexités, qu’en faisant vibrer une perplexité
fondamentale, qui est d’exister. Si l’on arrivait à faire la
généalogie de la prestigieuse philosophie de Platon, on
serait étonné de constater qu’à la base il n’y a rien d’autre
que ce plébéien Socrate et son joyeux savoir sans préten-
tion. De même, si l’on pouvait faire la généalogie de chaque
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%