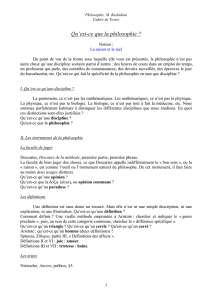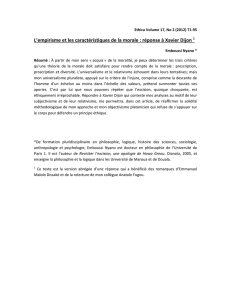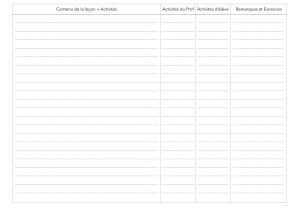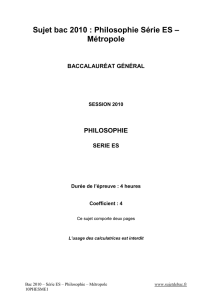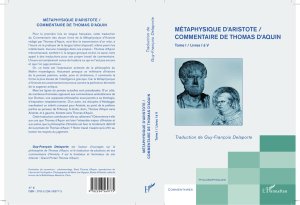Organisation d`ensemble de la philosophie - III

Organisation d’ensemble
de la philosophie
- III -

ORGANISATION D’ENSEMBLE DE LA PHILOSOPHIE
© Grand Portail Thomas d’Aquin www.thomas-d-aquin.com
2
AVERTISSEMENT
Cet essai s’appuie sur quelques extraits
fondamentaux des œuvres philosophiques de
Thomas d’Aquin. Il ne s’agit toutefois ni de traduction,
bien que souvent la lettre soit très proche du texte
latin, ni encore moins d’une composition personnelle.
Nous considérons ce travail comme une sorte de
"rewriting" et de mise en ordre des passages en
question, afin de présenter au plus près de la pensée
de l’auteur, l’organisation générale de la philosophie,
ainsi que ses différents sujets et modes de procédés.
Il s’agit d’un genre peu fréquent et un peu hybride, et
nous laissons le lecteur libre de son appréciation.
Nous avons retenu les textes suivants :
- Commentaire du De l’Interprétation, Livre 1, leçon 1
- Commentaire des Seconds Analytiques, Livre I,
leçon 1 ; Livre II, leçon 20
- Commentaire des Physiques, Livre I, leçon 1 ; Livre
II, leçon 3
- Commentaire du Du Ciel, Livre I, leçon 1
- Commentaire du De la Génération, Livre I, leçon 1
- Commentaire du Des Météorologiques, Livre I,
leçon 1
- Commentaire du De l’Âme, Livre I, leçon 1 et 2
- Commentaire du Du Sens, Livre I, leçon 1
- Commentaire de l’Ethique à nicomaque, Livre I,
leçon 1 à 3
- Commentaire des Politiques, Livre I, leçon 1 et 2
- Commentaire des Métaphysiques, Livre I, leçon 1 à 3
- Commentaire du Livre des Causes, Livre I, leçon 1
- Commentaire du De la Trinité, (Livre III), leçon 5 et 6

ORGANISATION D’ENSEMBLE DE LA PHILOSOPHIE
© Grand Portail Thomas d’Aquin www.thomas-d-aquin.com
3
4°) – La science rationnelle
– Analogie du terme "rationnel"
Un mode de procéder intellectuel est dit rationnel en trois sens différents.
1. Du côté des principes, lorsque pour prouver quelque chose, on se sert de
concepts logiques, comme le genre, l’espèce, l’opposé, etc. On appelle ainsi
rationnel, le mode employé par une science qui utilise des propositions relevant de
la logique, mais que cette dernière manipule pour son enseignement magistral.
Cette façon de faire ne peut toutefois véritablement convenir aux sciences
particulières dans le domaine du faillible, qui doivent procéder de principes
propres ; mais elle est parfaitement adaptée à la métaphysique et à la logique,
parce que ces deux sciences sont communes et ont en quelque sorte le même sujet.
2. Du côté du terme final. L’objectif ultime où doit conduire la recherche
rationnelle est l’intelligence des principes qui permettent de porter un jugement.
Et lorsque se produit une telle conclusion, on ne parle plus de méthodologie, ni de
preuve naturelle, mais bien de démonstration. Quelquefois cependant, l’inquisition
de la raison ne conduit pas au terme, mais s’arrête en chemin où demeure une
alternative. C’est le cas lorsqu’on utilise des arguments probables, propres à
forger une opinion ou une conviction, mais non pas une science. Le mode
rationnel se distingue alors du démonstratif. On peut donc procéder
rationnellement en toute science, lorsqu’on prépare, grâce à des probabilités, la
voie aux conclusions nécessaires. C'est là un autre aspect de la logique au service
des sciences démonstratives, non plus comme doctrine mais comme instrument.
3. Du côté de la faculté. Lorsque le processus scientifique suit le mode naturel de
connaissance de l’âme rationnelle. Celle-ci, en effet, abstrait, à partir de la
sensibilité des choses qui est plus accessible à notre connaissance, la
compréhension de l’intelligibilité du réel, plus conforme à la nature des choses.
Elle conduit ainsi des démonstrations fondées sur un signe ou un effet. Ce
processus est également dénommé rationnel parce qu’il passe d’une chose à une
autre, de l’effet à la cause, concrétisés par deux objets numériquement distincts, et
non pas d’une essence à sa propriété, où l’intelligence demeure au sein d’une
unique réalité physique.
– Division de la logique
En première approche comprenons que la logique est dite science rationnelle.
Sa considération porte donc sur ce qui touche aux trois opérations de la raison.
L'intelligence des concepts simples, qui concerne la première est traitée par Aristote
dans son livre des Catégories. L'énonciation affirmative ou négative, qui regarde la
seconde, est étudiée dans le traité De l’Interprétation. Ce qui a trait à la troisième
enfin, est vu dans Les Premiers Analytiques et les livres suivants, où sont abordés le

ORGANISATION D’ENSEMBLE DE LA PHILOSOPHIE
© Grand Portail Thomas d’Aquin www.thomas-d-aquin.com
4
syllogisme en lui-même, ses différentes espèces, et les diverses formes
d'argumentation grâce auxquelles la raison avance pas à pas. Conséquence de ce triple
ordre évoqué, le traité des Catégories est ordonné à celui de l'Interprétation, lui-
même ordonné aux Premiers Analytiques et aux suivants.
Développons de façon plus précise, à partir de ce principe qu’il faut conformer
la division de la logique à la diversité des actes rationnels, au nombre de trois, dont
deux l'identifient à l'intelligence. Le premier offre la compréhension des concepts
indivisibles grâce auxquels elle saisit l'être des choses. A cette opération de la raison,
Aristote destine la théorie de son livre sur les Catégories. La seconde opération de
l'intelligence compose et divise les concepts pour y trouver le vrai et le faux, et
Aristote nous livre dans son traité De l’Interprétation l’apport théorique nécessaire.
Le troisième acte regarde ce qui est propre à la raison : passer d'un point à un autre,
afin de découvrir ce que l'on ignore en s'appuyant sur ce que l'on sait déjà, à l'aide des
autres livres de la logique.
Notons tout de même que les actes de la raison sont assimilables jusqu'à un
certain point à des actes naturels. L’art imite la nature dans une large mesure, et nous
trouvons trois types d'actes naturels. Certains sont de toute nécessité et la nature n'y
peut faire défaut. D'autres sont très fréquents, quoiqu'ils puissent parfois être
détournés ; de sorte que de tels actes offrent nécessairement deux possibilités : un cas
général comme la génération d'un animal normal à partir d'une semence par exemple,
et un cas où la nature ne parvient pas à sa perfection en engendrant un monstre à partir
de cette même semence, à cause de la dégradation d'un gène.
Or on retrouve cette triplicité dans les actes de la raison. Un des processus
rationnels conduit à la nécessité et ne peut tromper sur la vérité ; il mène la raison à la
certitude scientifique. Un autre donne une conclusion vraie en général, sans pourtant
avoir ce caractère de nécessité. Le troisième détourne la raison du vrai à cause d'une
erreur de principe repérable dans le raisonnement.
Le chapitre de la logique traitant du premier processus est dit «outil de
jugement», car le jugement a la sûreté de la science. Or un jugement ne peut être
certain qu'en résolvant un fait dans ses premiers principes, aussi nomme-t-on cette
partie de la logique : «analytique», c'est à dire résolutoire. La résolution dans un
jugement certain s'obtient par la seule forme du syllogisme, sujet des Premiers
Analytiques ou par la matière dont sont tirées des propositions nécessaires, et dont
traitent les Seconds Analytiques à propos de la démonstration.
Le second processus rationnel utilise cette partie de la logique dénommée
«outil de recherche», car l'investigation n'est pas toujours certaine, et ce que l'on
découvre a besoin d'un jugement lui conférant quelque sûreté. La régularité des
événements naturels est sujette à gradation : plus la force naturelle est puissante,
moins ses effets risquent d'être aberrants, et de même, un raisonnement discutable
approche plus ou moins de la certitude. A défaut de scientificité, ce processus donne
une idée ou une opinion, car devant une alternative, la probabilité des arguments de
base obtient l'assentiment de la raison pour l'une des deux éventualités, malgré une
hésitation pour l'autre. C'est ce dont traitent les Topiques ou Dialectique, car le
syllogisme dialectique abordé dans ces Topiques procède d'hypothèses probables.

ORGANISATION D’ENSEMBLE DE LA PHILOSOPHIE
© Grand Portail Thomas d’Aquin www.thomas-d-aquin.com
5
Mais il arrive parfois qu'on ne puisse même se faire une opinion. Tout au plus
avons-nous quelque sentiment, et bien que nous ne prenions pas vraiment parti, nous
inclinons vers une conclusion plutôt qu'une autre. Cet état d'esprit constitue l'objet de
la Rhétorique.
D'autres fois enfin, nous préférons telle partie d'un débat contradictoire pour la
présentation qui nous en est faite, de la même façon que nous savourons un met pour
l'art avec lequel il est dressé. Tel est l'objet de la Poétique, car la tâche du poète est de
faire aimer la vertu en l'ornant comme elle le mérite. Ces démarches intellectuelles
relèvent toutes de la science rationnelle, car le propre de la raison est de faire avancer
la connaissance. Le troisième processus fait l'objet d'un chapitre logique intitulé
Sophistique et dont traite Aristote dans son livre sur les arguments fallacieux.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%