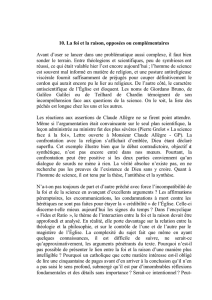TABLE DES MATIÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI . . . . . . . . .

TABLE DES MATIÈRES
ABRÉVIATIONS .......................... XXI
INTRODUCTION .......................... 1
À la recherche de la vérité ..................... 1
Personne et altérité ......................... 2
I. Biographie d’Edith Stein (1891-1942) ............ 6
1. «Une petite fille très douée»: de la naissance à l’obtention
du doctorat (1891-1916) .................. 6
A. L’enfance d’Edith Stein (1891-1906) ......... 6
B. La période de l’adolescence (1906-1911) ....... 8
C. Étudiante à l’université de Breslau (1911-1913) ... 9
D. Premiers pas à Göttingen (avril – début août 1913).. 11
E. Deuxième semestre à Göttingen (octobre 1913-1914) 14
F. De la déclaration de guerre au titre de docteur
(fin juillet 1914 – 3 août 1916) ............ 16
2. Une conversion spirituelle et intellectuelle (1916-1933) . 19
A. Assistante de Husserl à Fribourg (1916-1918) .... 19
B. Breslau, le temps de la maturation et de la conversion
(1918-1922) ...................... 22
C. Enseignante à Spire (1923-1931) ........... 26
D. Une conférencière renommée (1926-1932) ...... 29
E. Maître de conférence à Münster (1932-1933) ..... 31
3. Au Carmel (1933-1942) .................. 34
A. Au Carmel de Cologne (1933-1938).......... 34
B. Au Carmel d’Echt (1939-1942) ............ 37
C. Mourir pour son peuple ................ 37
II. État de la question ....................... 39
1. Dans le monde francophone ................ 40
2. Dans le monde germanophone ............... 43
3. Dans le monde anglophone ................ 47
4. Une notion clé: l’altérité .................. 50
III. Plan et méthode ........................ 51
1. Plan ............................. 51
2. Méthode .......................... 52
3. Remarque sur les abréviations ............... 54
0326-07_BETL212_VdDriessche_vw 23-04-2008 10:32 Pagina VII

VIII TABLE DES MATIÈRES
PREMIERE PARTIE
PRÉSENTATION DES ŒUVRES PRINCIPALES
CHAPITRE I: LA PÉRIODE PHÉNOMÉNOLOGIQUE ........... 59
I. Le problème de l’Empathie (1916) .............. 59
1. L’essence des actes d’empathie (chapitre 2)........ 60
A. Spécificité des actes d’empathie ............ 60
B. Discussion avec d’autres descriptions de l’empathie . 61
a. Description de l’empathie selon Lipps ....... 62
b. Saisie de la conscience étrangère selon Scheler .. 63
2. La constitution de l’individu psychophysique (chapitre 3) 65
A. La constitution de l’individu psychophysique ..... 65
a. Moi pur, flux de conscience et âme ........ 65
b. Moi et corps vivant ................. 66
B. La constitution de l’individu étranger ......... 68
a. Sensations, orientation spatiale et empathie .... 69
b. Correction et erreur dans les actes d’empathie ... 70
C. Importance de l’empathie pour l’individu propre ... 71
3.
L’empathie comme compréhension des personnes spirituelles
(chapitre 4) ......................... 72
A. La constitution de la personne dans les vécus affectifs 73
B. La donation de la personne étrangère ......... 75
a. Personne et individu psychophysique ....... 76
b. Modalité et limite de l’empathie .......... 76
C. Signification de l’empathie pour la constitution de
la personne propre ................... 77
4. Personne et intersubjectivité ................ 78
II. Contributions à la fondation philosophique de la psychologie
et des sciences de l’esprit ................... 78
1. Causalité psychique (1918) ................ 79
A. La causalité psychique ................. 79
B. Vie spirituelle et motivation .............. 80
C. L’enchevêtrement de la causalité et de la motivation . 83
D. Un concours de forces diverses ............ 84
2. Individu et Communauté (1919) .............. 85
A. Le flux d’expérience de la communauté........ 86
a. Vécu propre et vécu communautaire ........ 86
b. Les actes constitutifs des vécus communs ..... 86
B. Structure ontique de la communauté.......... 88
a.
Force vitale et constitution d’un sujet supra-individuel
88
0326-07_BETL212_VdDriessche_vw 23-04-2008 10:32 Pagina VIII

TABLE DES MATIÈRES IX
b.
Autres facteurs constitutifs de la personnalité collective
90
c. Rapport entre l’individu et la communauté .... 91
3. Psyché et esprit....................... 94
III. De l’État (1921) ........................ 95
1. La structure ontique de l’État ............... 95
A. La communauté étatique ................ 96
B. L’État et le droit .................... 98
C. L’État concret dans sa dépendance d’autres facteurs
que la structure étatique ................ 101
2. L’État du point de vue des valeurs ............ 103
A.
L’importance de l’État pour les individus qui en relèvent
103
B. L’État et la justice ................... 104
C. L’importance de l’État pour la communauté ..... 104
D. L’État et les valeurs morales.............. 105
E. L’État en tant que porteur des événements historiques 107
F. L’État et la religion .................. 108
3. État et culture........................ 109
IV. Einführung in die Philosophie (1921)............. 109
1. Le problème de la philosophie de la nature ........ 112
A. Perception et constitution de l’objet .......... 112
B. La théorie de la connaissance ............. 113
a. Idéalisme et réalisme ................ 114
b. Connaissance et vérité ............... 114
c. Les frontières de la connaissance.......... 115
2. Le problème de la subjectivité ............... 116
A. La corporéité (Leiblichkeit) .............. 117
B. La structure de l’âme (Psyché)............. 118
a. L’âme (Psyché) comme réalité, ses états et ses parti-
cularités ....................... 118
b. Le caractère ..................... 119
c. Types de caractères et particularité individuelle .. 120
d. L’âme et ses profondeurs .............. 121
3. Deux ontologies ...................... 122
CHAPITRE II: LA PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE............. 123
I. La phénoménologie de Husserl et la philosophie de saint
Thomas d’Aquin (1929) .................... 124
1. La philosophie comme science rigoureuse ........ 124
2. Raison naturelle et raison surnaturelle; croire et savoir.. 124
3. Philosophie critique et philosophie dogmatique ...... 126
0326-07_BETL212_VdDriessche_vw 23-04-2008 10:32 Pagina IX

XTABLE DES MATIÈRES
4. Philosophie théocentrique et philosophie égocentrique .. 127
5. Ontologie et métaphysique................. 128
6. La question de l’intuition ................. 128
A. Similitudes ....................... 129
B. Divergences ...................... 130
7. L’indigence de la raison .................. 131
II. La structure ontique de la personne ............. 132
1. Du royaume de la nature au royaume de la grâce ..... 132
2. La grâce ......................... 136
3. Les médiations ....................... 137
4. La foi ............................ 137
5. Un nouveau déploiement.................. 140
III. Der Aufbau der menschlichen Person ............ 141
1. Anthropologie et éducation ................ 141
A. Au fondement de l’éducation… l’idée de l’homme .. 142
a. Conceptions actuelles de l’homme ......... 142
b. La figure humaine de la métaphysique chrétienne . 143
B. L’anthropologie comme fondement de la pédagogie . 145
a. Différentes anthropologies et leur signification péda-
gogique ....................... 145
b. Choix de la méthode ................ 146
c. Première analyse préparatoire de l’homme..... 147
2. Le spécifiquement humain en l’homme .......... 148
A. Intellectualité et liberté................. 148
B. Ich et Selbst ...................... 149
C. Saisie du corps à travers l’âme ............ 150
D. Das Sollen (le devoir) ................. 151
3. L’âme comme forme et esprit ............... 151
A. L’âme humaine et la forme substantielle de l’homme 152
B. Das Wesen des Geistes................. 152
C. Particularité de l’âme en tant qu’être spirituel..... 153
4. L’être social de la personne ................ 155
A. Notions sociologiques fondamentales ......... 156
B. Analyse du peuple et de l’origine ethnique ...... 157
5. De l’examen philosophique à l’examen théologique ... 159
6. Dieu, fondement de la personne et de la communauté .. 161
IV. Was ist das Mensch? ..................... 161
1. La nature de l’homme ................... 162
2. Création du premier homme et état originel........ 163
A. L’être surnaturel du premier homme ......... 164
B. Foi et vision béatifique................. 165
0326-07_BETL212_VdDriessche_vw 23-04-2008 10:32 Pagina X

TABLE DES MATIÈRES XI
3. La nature déchue ...................... 167
4. L’homme-Dieu (Der Gottmensch) ............. 168
5. La Rédemption et l’état de racheté ............ 170
A. La justification du pécheur............... 170
B. Les sacrements ..................... 171
C. Les effets de la grâce.................. 171
6. Un projet peu original ................... 173
V. L’être fini et l’Être éternel (1935) .............. 173
1. La question de l’être .................... 174
A. Puissance et acte .................... 174
B. La question de l’être au cours des temps ....... 174
C. Sens et possibilité d’une philosophie chrétienne ... 175
a. Nature de la philosophie .............. 176
b. État de la philosophie ................ 178
c. Théologie, vie mystique et vie de foi........ 179
D. Une définition éclairante de la philosophie chrétienne 180
2. Acte et puissance en tant que modes d’être ........ 180
A. L’être fini........................ 181
a. Temporalité ..................... 181
b. Le Moi pur ..................... 182
B. Vers l’être éternel ................... 184
C. Une voie d’accès à l’existence de Dieu ........ 185
3. Être essentiel et être éternel ................ 185
A. L’être essentiel ..................... 186
a. Essence (e¤dov) et être essentiel .......... 186
b. Être essentiel, acte et puissance .......... 187
c. Les universaux ................... 188
B. Être essentiel et être éternel .............. 189
C. Remarques ....................... 192
4. Essence – essentia, oûsía – Substance. Forme et matière. 192
A. Essai d’éclaircissement de la notion d’oûsía ..... 193
B. Matière et forme .................... 196
a. Forme et matière .................. 196
(a) Forme et matière d’après Aristote (Premier essai) 197
(b) Ambivalence du concept aristotélicien de matière 198
b. De la forme à l’essence divine ........... 201
(a) Forme pure et essence divine.......... 204
(b) Les êtres vivants ................ 206
C. Conclusion des recherches sur la forme, la matière et
l’oûsía ......................... 207
a. Forme et matières du vivant ............ 207
0326-07_BETL212_VdDriessche_vw 23-04-2008 10:32 Pagina XI
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%