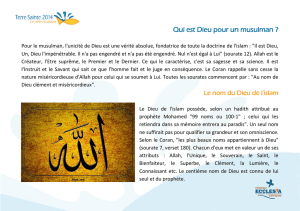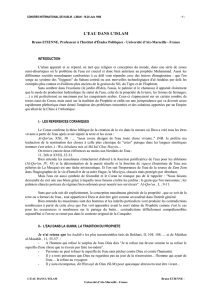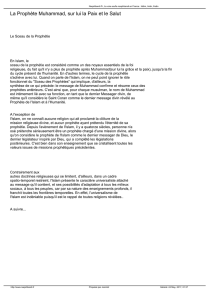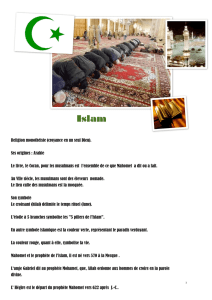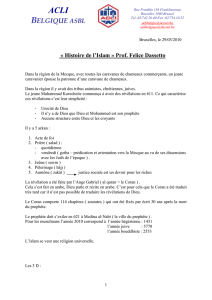Le Prophète de l`islam serait

Revue des sciences religieuses
87/2 | 2013
Christianisme et islam
Le Prophète de l’islam serait-il irreprésentable ?
François Bœspflug
Édition électronique
URL : http://rsr.revues.org/1185
DOI : 10.4000/rsr.1185
ISSN : 2259-0285
Éditeur
Faculté de théologie catholique de
Strasbourg
Édition imprimée
Date de publication : 1 avril 2013
Pagination : 139-159
ISSN : 0035-2217
Référence électronique
François Bœspflug, « Le Prophète de l’islam serait-il irreprésentable ? », Revue des sciences religieuses
[En ligne], 87/2 | 2013, mis en ligne le 01 avril 2015, consulté le 01 octobre 2016. URL : http://
rsr.revues.org/1185 ; DOI : 10.4000/rsr.1185
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
© RSR

LE PROPHÈTE DE L’ISLAM
SERAIT-IL IRREPRÉSENTABLE ?
Six ans après l’affaire des caricatures de Muhammad1, l’ampleur
de la désinformation du public est à son comble en ce qui concerne la
figuration du Prophète de l’islam et sa supposée interdiction en raison
de sa supposée dimension blasphématoire. Il est grand temps de
mener la lutte, sur ce point précis, contre une mémoire tronquée de
l’islam, autrement que par la publication d’une BD, fût-elle ou se
voulût-elle «très sérieuse», adossée à une documentation solide et à
de «longues recherches» dans la sîra, la chronique de la vie du
Prophète2. On se demande ce qu’attendent les croyants musulmans,
et/ou les islamologues de toute bure, pour publier un livre de réfé-
rence à ce sujet. Tout se passe comme si ce sujet était tabou. Comment
l’expliquer, sinon par la peur et l’inculture? La paresse s’en mêle-t-
elle? Il est vrai que la question n’est pas des plus simples, et tout
indique qu’elle est même des plus complexes, ceci expliquant sans
doute cela. Quoi qu’il en soit, on tolérera, «faute de mieux», qu’un
non spécialiste s’en mêle.
On se contente de faire ici une esquisse de l’édifice historique et
iconographique solidement construit qu’une telle question attend et
mérite. Il paraît en tout cas impossible de l’aborder sans remonter
jusqu’à l’interdiction des images cultuelles dans le Décalogue juif,
dont l’islam a hérité, et dont il aura cru devoir tirer certaines consé-
quences, variables selon les temps, les lieux, les genres d’art et les
Revue des sciences religieuses 87 n° 2 (2013), p. 139-159.
1. Fr. BŒSPFLUG, Caricaturer Dieu ? Pouvoirs et dangers de l’image, Paris,
Bayard, 2006; Id., «Caricaturer Dieu? Se moquer du Prophète ? Liberté d’expression
et respect du sacré», Bulletin du Centre Protestant d’Études [Genève], 60/1-2, mars
2008, p.25-47; «Laughing at God. The Pictorial History of Boundaries Not to be
Crossed», dans H.GEYBELS, W.VAN HERCK (éd.), Humour and Religion. Challenges
and Ambiguities, Londres/New York, 2011, p.204-217; D.AVON (éd.), La Caricature
au risque des autorités politiques et religieuses, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2010.
MEP_RSR 2013,2_Intérieur 18/03/13 14:35 Page139

destinataires, en ce qui concerne non seulement la représentation
d’Allah, mais encore celle du Prophète et des prophètes en général.
I. LA PLACE DU DÉCALOGUE DANS LE CORAN ET LES HADITHS
1. Dans le Coran
Le rapport est étroit, à certains égards (pour le contenu, sinon pour
la forme littéraire) entre la Bible et le Coran. Ce dernier est truffé de
réminiscences et d’allusions bibliques, augmentées, entre autres, de
versets des apocryphes et de textes talmudiques. Parmi les vingt-cinq
personnages cités ayant rang de prophète, vingt et un sont d’origine
biblique, dont Adam, Abraham et Moïse, celui qui est le plus souvent
cité (81 fois), jusqu’à Marie3et Jésus. L’étude historico-critique du
Coran, de sa «réception» par le Prophète et de la vie de ce dernier,
n’en est encore qu’à ses débuts4. L’islamologie des savants occiden-
taux non musulmans y aura grandement contribué. Mais les islamo-
logues prennent désormais le relais– témoin le récent Dictionnaire du
Coran5.
2. CHARB-ZINEB, La Vie de Mahomet, Ier Partie : «Les débuts d’un prophète »,
hors-série de la revue Charlie-Hebdo, janvier 2013 (Charb est le nom du dessinateur,
et Zineb, «sociologue des religions », signe l’Avant-propos). Cette BD est présentée
par Charb dans Charlie-Hebdo n°1072, du 2janvier 2013, p.9, où l’on trouve égale-
ment une interview, par Charb, d’Abdennour Bidar. Nous sommes d’autant moins
suspect de mépriser le 9eart que nous avons salué avec éloge la publication du gros
«beau-livre » qui lui est consacré aux Éditions Citadelle & Mazenod sous le titre
L’art de la Bande dessinée (Le Figaro et vous, lundi 29octobre 2012, p.38, interview
par Olivier Delcroix). Mais enfin le débat public, qui n’a rien à perdre à l’existence
de cette BD relevant d’un acte de subversion «athée, laïque, universaliste et antira-
ciste», a aussi besoin d’autre chose… dans le prolongement de A.S.MELIKIAN-CHIR-
VANI, «L’islam, le verbe et l’image », dans Fr. BŒSPFLUG, N.LOSSKY (éd.), NicéeII,
787-1987. Douze siècles d’images religieuses, Paris, 1987, p.89-117, et en dernière
date de O. HAZAN, J.-J. LAVOIE (dir.), Le Prophète Muhammad. Entre le mot et
l’image, Montréal [Québec], 2011. Je n’ai pas accédé à P.SOUCEK, «The Life of the
Prophet : Illustrated Versions», dans P.SOUCEK (éd.), Content and Context of Visual
Arts in the Islamic World, The Pennsylvania State University Press, 1988, p.193-217,
ni à Chr. GRUBER, «Between Logos (Kalima) and Light (Nur) : Representations of the
Prophet Muhammad in Islamic Painting», Muqarnas, 26, 2009.
3. Un mémoire de master a été soutenu à Strasbourg sous ma direction, celui
d’Ameer Jajé, o.p., sur «Marie dans le Coran ».
4. Tilman NAGEL, Muhammad. Zwanzig Kapitel über den Propheten der
Muslime, Oldenburg, 2010; tr. fr. par Jean-Marc Tétaz, Mahomet. Histoire d’un
Arabe, invention d’un Prophète, Genève, 2012.
5. Mohammad Ali AMIR-MOEZZI (dir.), Dictionnaire du Coran, Paris, Robert
Laffont, «Bouquins», 2007; Michel CUYPERS, La composition du Coran. Nazm al-
Qur‘an, Paris, Gabalda, «Rhétorique sémitique», 2012.
FRANÇOIS BOESPFLUG140
MEP_RSR 2013,2_Intérieur 18/03/13 14:35 Page140

Sur les 6236 versets coraniques, 214 contiennent des lois reli-
gieuses. Comme elles ne pouvaient pas à elles seules constituer une
législation ordonnancée, il a fallu procéder à la codification des prin-
cipes juridiques de l’islam, en fixant des règles d’interprétation, en
élevant le Hadith («récit», «tradition» : recueil des actes et paroles
du Prophète) au rang de seconde source de la Loi religieuse et en
introduisant, en plus du Coran et du Hadith, deux sources complé-
mentaires, l’avis unanime des savants (ijmâ) et le raisonnement par
analogie (qiyâs)6.
Il n’y a pas trace du deuxième commandement du Décalogue
(«Tu ne te feras pas d’image…» : Ex 20,4 et Dt 5,6) parmi les lois
religieuses coraniques (pas plus, d’ailleurs, qu’il n’en est explicite-
ment question dans les évangiles)7. À la différence de la Bible, le
Coran ne porte pas d’interdiction explicite des images de Dieu8– un
indice indirect de ce silence est l’absence d’article «image» dans le
récent Dictionnaire du Coran : il y a en revanche un article «Idoles,
idolâtrie», ce qui n’autorise pas à mettre les deux notions sur le même
plan. Le Livre est muet à ce sujet, et les spécialistes de l’islam se plai-
sent à souligner que si «le Coran ne contient aucun passage qui
prohibe expressément les images», à telle enseigne que l’on pourrait
parler avec pertinence d’aniconisme à son propos9, « l’islam n’en est
pas moins fondamentalement hostile aux images10 ». Et par « image »,
lorsqu’on en parle en rapport avec l’islam, il faut entendre spécifique-
ment «celles représentant des êtres vivants ayant un souffle vital
(rûh), donc les êtres humains et les animaux, les végétaux et les objets
inanimés ne rentrant généralement pas dans cette catégorie11 », ce qui
met à l’abri les arbres et les fleurs, d’une part, et les édifices d’autre
6. M.REEBER, L’Islam, « Les Essentiels Milan», Paris, 2005, p.16 (très claire
double page sur l’élaboration du droit islamique, p.16-17).
7. C’est redit avec toute la clarté souhaitable par S.BASALAMAH, «Le paradoxe
de la représentation du prophète Muhammad entre éducation spirituelle et mono-
théisme radical», dans O.HAZAN, J.-J.LAVOIE, p.19-42 (23).
8. R. PARET, « Textbelege zum islamischen Bildverbot », dans Das Werk des
Künstlers, Mélanges Hubert Schrade, Stuttgart, 1960, p. 36-48 ; «Das islamische
Bildverbot und die Schia», dans E. GRÄF (éd.), Festschrift Werne Caskel zum
70. Geburtstag, Leyde, 1968, p. 224-232; « Die Entstehungszeit des islamischen
Bildverbots», Kunst des Orients, 2, 1977, p. 155-181; «Bildverbot, III. Islam»,
Lexikon des Mittelalters, 1981, t.II, col.152. Je n’ai pas pu consulter Mazhar Sevket
IPSIROGLU, Das Bild im Islam : ein Verbot [?] und seine Folgen, Munich, 1971.
9. P.LORY, «L’aniconisme en Islam», Le discours psychanalytique – Revue de
l’Association Freudienne, n°2 (octobre 1989), «aniconisme », dans J.et D.SOURDEL,
Dictionnaire historique de l’Islam, Paris, PUF, 1996.
10. P.HEINE, «Images», Dictionnaire de l’Islam, Turnhout, 1995.
11. S.NAEF, Y a-t-il une « question de l’image» en islam ?, Genève, 2003, p.13.
141LE PROPHÈTE DE L’ISLAM SERAIT-IL IRREPRÉSENTABLE ?
MEP_RSR 2013,2_Intérieur 18/03/13 14:35 Page141

part, dont on comprend par conséquent qu’ils apparaissent souvent
comme motifs décoratifs dans les architectures musulmanes. L’histo-
rien des idées anthropologiques et théologiques, comme celui des
images, sont évidemment frustrés en raison du caractère abrupt de
cette distinction et de l’absence de toute documentation la concernant
comme de tout débat théologique tendant à la légitimer ou à l’in-
firmer : on est ici, typiquement, devant une affirmation qui, pour un
occidental non islamologue, paraît située dans la zone mitoyenne
entre tradition orale (respectable) et rumeur (discutable voire à
déconstruire, du point de vue de l’historien). Mais il s’avère que ce
qui «fait» l’orthodoxie sunnite est précisément le consensus de la
communauté (ijmâ) : c’est lui qui ratifie l’interprétation du Coran et
instaure le hadith comme source de droit et de foi. Or ce consensus
n’est pas prononcé par les savants uniquement, il émane de façon
informelle et progressive de toute la communauté. La «rumeur» est
donc un élément actif de l’élaboration de nouveaux consensus, parfois
sur des points de foi importants12.
Des renvois au Décalogue parfois développés se trouvent dans
plusieurs sourates (ainsi dans la sourate al-A‘râf, 7, 143-151), mais
sans aucune mention explicite du deuxième commandement sous
l’une ou l’autre de ses versions, ce qui pourrait s’expliquer par l’ab-
sence probable de toute traduction de la Bible en arabe avant le VIIIe
siècle13. « Les quelques réminiscences bibliques qui se trouvent dans
le Coran et les textes fondateurs de l’islam peuvent avoir leur source
dans les paraphrases en langue vulgaire qui accompagnaient la lecture
du texte sacré dans les synagogues et les églises14.»
La lettre du Coran ne condamne explicitement que les idoles
préislamiques15 et bien sûr, par avance, toute autre forme d’idolâtrie16.
12. Je dois d’avoir pris conscience de cette problématique à mon collègue et ami
Pierre Lory, que je remercie pour sa relecture. J’en profite pour remercier aussi de leur
attention Mgr Pierre Boz, Ralph Stehly, Évelyne Martini et Françoise Bayle.
13. «Versions anciennes de la Bible : versions arabes», dans Dictionnaire ency-
clopédique de la Bible, Turnhout, 1987; voir D. GIMARET, Dieu à l’image de
l’homme. Les anthropomorphismes de la sunna et leur interprétation par les théolo-
giens, Paris, Les Éditions du Cerf, 1997 p. 126 : il parle d’une ignorance pure et
simple du texte écrit de la Bible et d’une connaissance plutôt floue de données
bibliques circulant par oral.
14. Chr. ROBIN, «Les religions de l’Arabie avant l’islam », Le Monde de la Bible,
n°129 (« L’Orient, de Jésus à Mahomet»), sept.-oct.2000, p.29-33 (33).
15. CorV, 92 : «Pierres dressées (Ansâb) et flèches divinatoires sont une souil-
lure et une œuvre de Satan, évitez-les» ;VI, 74 : il est question des idoles dont s’est
détourné Abraham en révolte contre son père qui continue de les adorer (et qui en
fabrique : Terah).
FRANÇOIS BOESPFLUG142
MEP_RSR 2013,2_Intérieur 18/03/13 14:35 Page142
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%