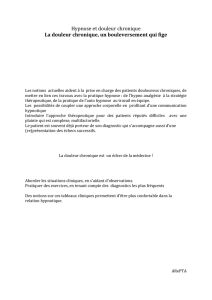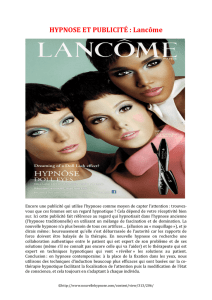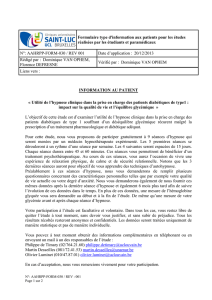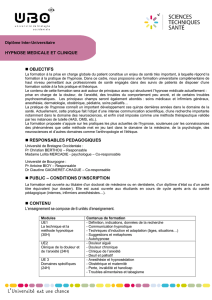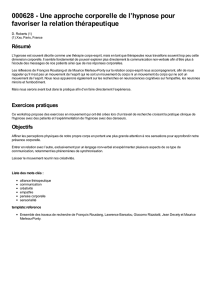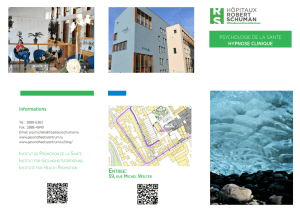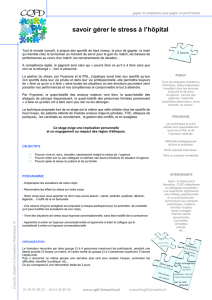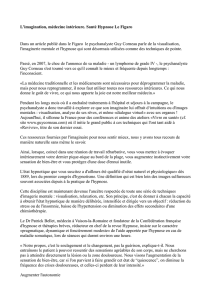Préparation par hypnose en vue d`une intervention lourde et/ou

1
PREPARATION PARHYPNOSE EN VUE D’UNE INTERVENTION
LOURDE ET/OU INVALIDANT
Samia TESTA
CentreRené Gauducheau, Bd Jacques Monod, 44805 Saint-Herblain cédex
L’hypnose estune méthode de soins vieille comme le monde, répanduedans toutes les cul-
tures etsousdes formes différentes. Actuellement,l’hypnose estsource de recherches cli-
niques, scientifiques etexpérimentales. Elle estpratiquée par différentscorps médicaux
(anesthésistes, pneumologues, gastro-entérologues, obstétriciens, pédiatres, psychiatres) etparamé-
dicaux ainsi quepar des dentistes etdes kinésithérapeutes (1,2). En cancérologie, sa pratiquefait
l’objetde multiples applications, notammenten soins palliatifs etchimiothérapie (3). Son domaine
d’application s’élargitde jourenjour:douleurs, pathologies pulmonaires, cardiovasculaires et
digestives, troubles psychiatriques, dépression, conduites de dépendance (3).
UN PEU D’HISTOIRE
L’hypnose estdécriteen1829comme traitementadjuvantàlachirurgie. Jules Cloquetpratiqueà
cettedateune intervention chirurgicale “sousanesthésie magnétique”. Il réalise une ablation de
tumeurcancéreuse dusein avec “des ganglions engorgés”. La patiente, “magnétisée” une heure
avantl’opération, seraitrestée 48 heures dans un“étatde somnambulisme”. C’estle premier cas
documentéetrapportéàl’académie de médecine de l’époque(4). En 1843,James Braid, médecin
chirurgien, utilise le premier le terme d’hypnose etdonne sa définition. L’anesthésie magnétique
continueàsedévelopper jusqu‘aumilieuduXIX siècle oùsontapparusles premiers anesthésiques
etanalgésiques chimiques. Il faudra attendre l’année 1955 pourqueles anesthésistes s’intéressent
de plusprès àl’hypnose etàses applications.
Les situations principales dans lesquelles l’anesthésisteutilise l’hypnose sont:
-L’hypnose comme aide àlasédation souscontrôle anesthésiqueouhypnosédation, techniqueprô-
née par Madame le ProfesseurFaymonville.
-Lapréparation à une chirurgie suivie d’une anesthésie générale.
LA PREPARATION PARHYPNOSE
La préparation par hypnose en vued’une intervention chirurgicale datede1959. L’étathypnotique
estinduitpar les chirurgiens avantl’opération àl’aide de suggestions, lues ouenregistrées surcas-
settes (5,6,7,8,9). Les protocoles de ces études restentdifférentsetnon randomisés. Les études ran-
domisées apparaissentàpartir de 1980,mais les résultatsdemeurentvariables dufaitdes difficultés
méthodologiques. Les études les plusrécentes etparticulièrementintéressantes pourles anesthé-
sistes montrentune amélioration significativedeladouleur, de l’anxiétéetdes nausées vomisse-
mentsenpost-opératoire avec l’utilisation de l’hypnose. En 1996, Lambertmontre une diminution
de la douleuretuntemps de réveil pluscourtchezdes enfantsayantbénéficié de l’hypnose etde
l’imagerie guidée par rapportaugroupe contrôle, sans différence surles scores d’anxiété(10).
Calipel etcoll. en 2005, comparentla diminution de l’anxiétépré-opératoire pourles enfantsayant

eude l’hypnose oudumidazolam en pré-opératoire. Dans le groupe hypnose, il yaune anxiétéplus
faible etune diminution des troubles ducomportementauréveil (11).
L’HYPNOSE EN CANCEROLOGIE ET SES APPLICATIONS
Douleur :
De l’électrophysiologie àlatomographie par émissions de positrons àl’imagerie par résonnance
magnétique, on approche vers une participationactivedecertaines zones ducerveau.Les derniers
articles dontceluidel’équipedeMme le ProfesseurFaymonville insistentsurlacapacitéducortex
cingulaire antérieuretducortexpréfrontal àmodulerles afférencessensorielles etnociceptives (12).
Dans son ouvrage, Joseph Barber souligne qu’une interventionhypnotiqueestefficace si elle
débute, dans la mesure dupossible, avantle traitementducancer(12). L’hypnose ades applications
dans la douleuraigue. Elle se révèle aussi très efficace dans la douleurchronique, si le patientuti-
lise cettepratiquepar unentrainementàl’auto-hypnose associé àdes suggestions post-hypnotiques.
Nausées-VomissemeNts :
La meilleure prévention des vomissementsanticipés estl’absence de vomissementsaprès la chimio-
thérapie. L’hypnose diminueraitl’utilisation d’antiémétiques etdiminueraitles nausées anticipa-
toires. L’hypnose pourraitfaire disparaître les nausées etvomissementsanticipatoires, malgré une
sensibilisation lors de chimiothérapies antérieures (14). L’hypnose aaussi son rôle pouraider à
mieux gérer le stress induitpar la maladie cancéreuse etses thérapeutiques.
raDiothérapie :
En 2005, une étude prospectiverandomisée estréalisée afin de déterminer le rôle de l’hypnose sur
la réduction de l’anxiétéetl’amélioration de la qualitédevie des patientsayantde la radiothérapie.
Les patientsontune amélioration de leurbien-être psychiqueglobal, mais sans quel’on sache si
cetteamélioration estaccentuée par une attention meilleure portée sureux (15). D’autres études ont
évaluél’impactde l’hypnose surl’anxiété, la fatigueetl’inconfortcutané lors des séances de radio-
thérapie (16,17).
soiNs palliatifs :
Depuis 1966, on constatel’émergence de l’utilisationdes médecines dites complémentaires pourles
patientsatteintsd’uncancer. En 2003,Marcusécritquel’hypnose améliore le bien-être physique,
psychologique, social etspirituel des patientsenfin de vie (18). Les patientsmalades recherchent
l’amélioration de certains symptômes (dyspnée, angoisse…) parfois résistantsaux médicaments
classiques entraînantaussi des intolérances et/oueffetsindésirables, etsontàlademande d’unretour
aubien-être psychologiqueetexistentiel.
La définition donnée par l’OMS pourles soins palliatifs rappelle bien qu’ils “cherchentàaméliorer
la qualitédevie des patientsetde leurfamille… prévention etsoulagementde la souffrance… ainsi
queletraitementde la douleuretdes autres problèmes physiques, psychologiques etspirituels qui
luisontliés”.
immuNocompéteNce :
L’hypnose auraitdes effetspositifs sur le système immunitaire durantles périodes de stress. Elle ne
pourraitpas agir surlaprévention ducancer chezles sujetssains ouayantdes facteurs de risques.
2

C’estseulementlorsqu’unindividusubitunstress etqueson système immunitaire estdysrégulé que
l’on peut attendre uneffetinverse par l’hypnose (19). En 1981, l’apprentissage de la relaxation et
d’imagerie mentale chezdes patientes amontré une augmentation de la survie par rapportàlasur-
vie habituellementretrouvée (patientes volontaires) (20). En 1989, les mêmes résultatssontobser-
vés chezungroupe de patientes suivipouruncancer dusein métastatique(21). Pources 2études,
les paramètres biologiques n’ontpas étéétudiés. Un plusgrand nombre de lymphocytes cyto-
toxiques Tseraitcorrélé à une durée de survie supérieure chezles femmes quiontuncancerdusein
métastatique. Depuis quelques années, on saitqu’il yaune régulation dusystème immunitaire par
le système neuroendocrinien. Les réponsesimmunespourraientêtre diminuées par de nombreux
stress ayantunimpactpsychologiquenégatif. Le stress psychologiquechezles patientes atteintes
d’uncancer(inclut la dépression) peut conduire à une augmentationdelaprogression tumorale et
une diminution de la fonctionimmune àlafois chezl’animal etl’homme(22). Al’inverse, l’absence
de stress chezles patientes quiontuncancer mais quinesontpas déprimées etayantunbon envi-
ronnementsocial etunbon supportémotionnel estcorrélée avec une augmentation de l’activitédes
cellules NK etune moins grande invasion tumorale de ganglions lymphatiques. Des études récentes
montrentquel’hypnose tend àaméliorer le bien-être mental etle nombre de cellules immunitaires.
Les bénéfices seraientplusimportantsnotammentquand son utilisation estprolongée par des
séances d’auto-hypnose (23,24).
PROPOSITION D’UNE SEANCE D’HYPNOSE AVANT UNE CHIRURGIE LOURDE
ET/OU INVALIDANTE EN CANCEROLOGIE
En 2007, l’hypnose aétéintroduiteauCentre anticancéreux René GauducheauàNantes. La pre-
mière utilisation estl’hypnosédation aubloc opératoire. Les chirurgies concernées sontessentielle-
mentl’exérèse de tumeurs dusein avec ousans prélèvementde ganglions sentinelles, la pose de sites
implantables, l’ablation de nodules cutanés métastatiques. La mise en place de cettetechniques’est
faitefacilement,avec une bonne acceptation dupersonnel médical (anesthésistes etchirurgiens) et
paramédical. Devantl’enthousiasme de l’équipe mais aussi des patientsetla constatation d’effets
bénéfiques des opérés en post-opératoire, l’idée estvenuedeproposer aux patients, ne pouvantpas
bénéficier d’intervention soushypnose, une séance d’hypnose avantl’intervention afin de peut-être
obtenir les mêmes effets en post-opératoire. La proposition de ce nouveautype de prise en charge a
étéaccueillie très favorablementpar l’équipe chirurgicale etpar l’ensemble dupersonnel, soucieux
d’une approche globale etde l’amélioration de la qualitédulien avec les patients. Ontétéégalement
perçusl’importance etl’intérêtd’unlangage utilisantdes termes positifs etencourageantsdans le
but essentiel de mobiliser les ressources personnelles, de mieux gérer l’anxiétéetla douleuret
d’améliorer le ressenticorporel etle bien-être global.
La chirurgie estsouventle premier acted’unpatientatteintd’uncancer etconstitueparfois, comme
la chirurgie dusein, le traitementcuratif. La prise en charge de ces patientsestdonc unmomentpri-
mordial dans la prise de conscience de la maladie etpeut conditionner toutelapériode quisuitpen-
dantvoire après la maladie. Les études récentes etconnues pourune prise en charge par hypnose en
préopératoire concernentle cancer dusein. En 2006, l’équipe américaine de Lang trouveunbéné-
fice surl’anxiétéetla douleurchezles femmes quisubissentune macrobiopsie dans le groupe hyp-
nose (comparée augroupe attention empathiquestructurée etrelaxation) (23). En 2007,
Montgomerypropose une brèveinterventionhypnotiquede15minutes avantune biopsieouune
tumorectomieetconstateune moindre consommationdes produitsanesthésiques per-opératoire
3

mais égalementunrétablissementpost-opératoire sans effetsecondaire (24). En 2008, la même
équipe recherche l’efficacitédel’hypnose avantune biopsie d’exérèse dusein etconstateune moin-
dre anxiété, une meilleure humeuretunmeilleurdegré de relaxation (25).
Ainsi, la proposition d’une séance d’hypnose avantune intervention chirurgicale estnovatrice
(26,27).
aquels patieNts ?
Les séances d’hypnose sontproposées aux patientsopérés de chirurgies lourdes et/ouinvalidantes
présentantdes signes d’anxiétéimportants. La sélection aétéinfluencée par la disponibilitéde
l’hypnothérapeute.
quaND ?
La séance d’hypnose estproposée plusieurs jours oula veille de l’intervention, selon le choixetle
lieud’habitation dupatient.
commeNt ?
La séance estfixée en dehors de la consultation d’anesthésie etincluse dans unentretien, dontla
durée esten moyenne de 45 minutes etquisedivise en 3parties.
La première partie permetla connaissance dufuturopéré avec diverses questions parmi lesquelles :
*Avez-vousunmauvais souvenir d’une intervention ouhospitalisation quelconque?(repérage de
peurs antérieures cumulatives)
*Combien d’anesthésies etd’interventions en rapportavec le cancer (le «ras le bol »desubir des
anesthésie générales oud’avoir une autre opération pourcancer,récidiveouautre type de cancer)
avez-voussubi ?
*Connaissez-vousl’hypnose ?Etavez-vousdéjà utilisé des méthodes de relaxation ?
*Evaluation de l’anxiétélejour de la visitesurune échelle de 0à10où0estl’absence d’anxiété
et10l’anxiétémaximale (réponses spontanées etnon ciblées)
-Surquels critères se base cetteanxiété?
-Quel estle chiffre d’anxiétésouhaitée en attendantl’intervention ?
-Qu’amèneraitla différence d’anxiétéaprès la séance etpourles jours quisuivent?
*Evaluation de la douleurlejourdelavisitesurune échelle de 0à10où0estl’absence de dou-
leuret10la douleurmaximale
-Description de cettedouleur
-Quelles valeurs souhaitez-vousd’ici l’intervention?
*Evaluation de la situation personnelle familiale (conjoint,enfants, entourage familial etamical),
situation professionnelle (travail, arrêtde travail avec prise en charge adéquateoupas, retraité) et
situation sociale
*Evaluation des orientations sensorielles, des momentsousouvenirs agréables etdes goutscréatifs
La deuxième partie comprend la séance d’hypnose.
La troisième partie estconsacrée aux questions posées par le patientetàquelques conseils donnés
en attendantl’intervention, les jours oules semaines suivantes.
Tousles patientsontreçuunquestionnaire après leurintervention auquel ils ontacceptéderépondre.
Ce questionnaire estrempli par le patientseuletrécupéré en général avantsa sortie d’hospitalisation.
4

résultats
Centpatientsontétéinclusentre octobre 2007etjuin 2009(98 femmes et2hommes) dontles opé-
rations consistenten des mastectomies avec ousans reconstruction etdes laparotomies (chimiothé-
rapie hyperthermiqueintra péritonéale per-opératoire, duodénopancréatectomie). Anoter une majo-
ritédefemmes en raison dutype d’orientation chirurgicale aucentre.
Le recrutementdes patientsestfaitpar l’intermédiaire de l’infirmière d’annonce (50%), l’anesthé-
siste(35%) oule chirurgien (15%). Ces pourcentages onttendance àsemodifier aufil des mois avec
unrecrutementpassantpar l’ensemble des collègues anesthésistes etune demande croissantedes
chirurgiens.
La moitié des patientsontétévuslaveille de leuropération, l’autre moitié plusieurs jours avant.
a) première partie
45% des patientsgardentdes mauvais souvenirs d’une intervention ouhospitalisation antérieure,
dont35% de nausées et/ouvomissementset15% de douleurs post-opératoires.
100%des patientssontanxieux etparlentmême spontanémentd’angoisse pré-opératoire. Ce senti-
mentestperçudepuis l’annonce ducancer oud’une réintervention. 80%des patientscraignentpour
leuravenir.40%ontpeurdel’actechirurgical (personnes opérées de mastectomie, quiutilisentd’ail-
leurs les termes de mutilation oud’amputation). 30%des patientsontunmauvais sommeil voire
souffrentd’insomnie depuis l’annonce de l’intervention. 25% des opérés ontpeur de l’anesthésie
générale etduréveil.
En ce quiconcerne l’évaluation de l’anxiétéaumomentde la consultation etcelle souhaitée en atten-
dantl’intervention :60%des patientsontune anxiétéentre 7et10.Onconstatequeles patients
(85%) souhaitentetse contententd’espérer réduire leuranxiétédemoitié environ. Ils restentassez
lucides surlatechniqueetla réalitédelasituation.
Pourladouleur, la majoritédes patients(70%) ne présententpas de douleurpré-opératoire.
Lorsqu’elle existe, elle résulteleplussouventd’une biopsie ouintervention à visée diagnostique
récente.
b) deuxième partie
La séance d’hypnose aune durée moyenne de 20 minutes. Elle estorientée vers un“lieude sécurité”.
c) troisième partie
Le questionnaire (19 questions) estrempli par le patientseul, certaines questions sontàchoixmultiples.
95% des patientsneconnaissaientpas l’hypnose, mais plusdelamoitié d’entres eux pratiquentou
ontutilisé d’autres méthodes dontla sophrologie oula relaxation soitrapportavec la maladie, soit
en général plusieurs années auparavant(lors de grossesses notamment).
Alaquestion àchoixmultiples :quelles ontétéles motivations duchoixde l’hypnose, 100%ont
réponduespérer diminuer leuranxiété, 30% la curiosité, 30% la confiance envers l’anesthésisteet
le chirurgien, 25% l’expérience de la sophrologie et10%une participation activeàleurmaladie.
Alaquestion posée surlevécupendantla séance :65% des patientsontvécuunmomentagréable
etconfortable, 1patientsur2aressentiune indifférence àl’environnementetdes engourdissements,
40%ontperçuunchangementde son image corporelle (intéressantdans le cas des mastectomies et
reconstructions mammaires), 35% ontperdula notion dutemps.
Pendantla séance d’hypnose, 100%des patientsontvécuunmomentpleinement(50%) oumodé-
rément(50%) agréable.
5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%