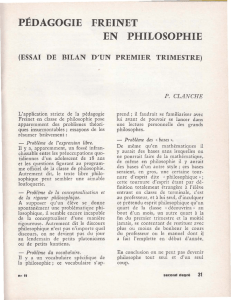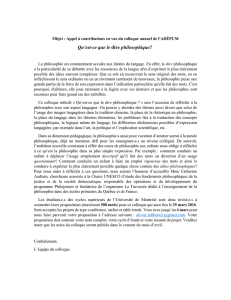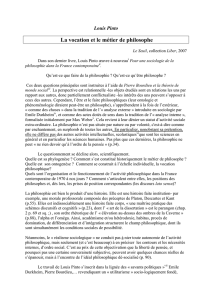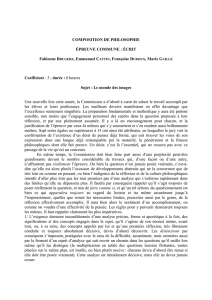Quel rôle peut jouer une approche philosophique dans

!
"!
#$%&'()*%+,%-.%&/)%'0!1!,(!23(!.(!)4.(!*(+!/--)5,6(+!-6%.5+5-6%23(+!*/&+!*(+!%&'()/,'%5&+!
(&')(!*%+,%-.%&(+!-(3'!(&!)070.()8!
9%())(!#%7('!
!
:5&+%*0)5&+!')5%+!(;(<-.(+!*$%&'()*%+,%-.%&/)%'0"!1!!!
"=!.(+!+,%(&,(+!,5>&%'%7(+?!23$(..(+!+5%(&'!)(-)0+(&'/'%5&&/.%+'(+!53!,5&&(;%5&&%+'(+!@!!
A=! .(! -/++/>(! (&! 0,5&5<%(! *(! ./! '605)%(! *(! .$023%.%B)(! >0&0)/.! C*0DE! (..(F<G<(! 3&!
(;(<-.(!*$%&'()*%+,%-.%&/)%'0=!E!./!<%,)50,5&5<%(!('!*(!.E!E!./!&(3)5F0,5&5<%(!@!
H=!#(!*07(.5--(<(&'!*(+!+%<3./'%5&+!(&!IJI8!!
K&!5B+()7(!*/&+!,(+!')5%+!*5</%&(+!23$5&'!(3!.%(3!*(!&5<B)(3+(+!%&'()7(&'%5&+!*(!'L-(!
-6%.5+5-6%23(+! M! -/)! *(+! -6%.5+5-6(+! 53! -/)! *$/3')(+! '605)%,%(&+! <5&')/&'! *(+!
-)05,,3-/'%5&+! *(! +'L.(! -6%.5+5-6%23(?! E! +/75%)! /7/&,()! *(+! '6N+(+! ,5&,(-'3(..(+?!
*%+,3'()!*(!./!-()'%&(&,(!*(!,5&,(-'+!('!,)%'%23()!.(3)!3+/>(?!-53)!*(+!23(+'%5&+!23%!&(!
-(37(&'! -/+! G')(! *0,%*0(+! &%! +(3.(<(&'! -/)! 3&(! *0<5&+')/'%5&! O5)<(..(?! &%! -/)! 3&(!
(;-0)%<(&'/'%5&8!!
!I!.!Esquisse!de!l’analyse!des!trois!exemples!CE!*07(.5--()!-53)!3&!-/-%()!O%&/.=!
"=! #(+! +,%(&,(+! ,5>&%'%7(+! 5&'! *0</))0! >)P,(! E! 3&! *53B.(! *0B.5,/>(?! -()<%+! -/)! .(+!!
'(,6&5.5>%(+! %&O5)</'%23(+! *$3&(! -/)'! ('! ./! ,)%'%23(! *3! B(6/7%5)%+<(! *$/3')(! -/)'8! #(+!
-6%.5+5-6(+!5&'!-)5-5+0!3&!,/*)(!,5&,(-'3(.!D3+'%O%/&'!./!)(&,5&')(!*(+!*(3;!,53)/&'+8!
C'605)%(! ,5<-3'/'%5&&/.%+'(! *(! .$(+-)%'! ('! '605)%(! *(! ./! <3.'%)0/.%+/B%.%'0! ('! *(! ./!
+3)7(&/&,(! *3! <(&'/.! +3)! .(! -6L+%23(=8! Q&+3%'(?! ,()'/%&+! *$(&')(! (3;! 5&'! ,)%'%230! ,(!
,5>&%'%7%+<(!*%'!R!6%>6!,63),6!S!(&!.%/%+5&!/7(,!3&!/3')(!*0B.5,/>(?!,(.3%!23%!/!-()<%+!.(!
)(*0</))/>(!*(+!)(,6(),6(+!+3)!.(+!)0+(/3;!*%'+!E!.$0-523(!*(!R!&(3)5&(+!O5)<(.+!S!!('!
23%! /! *5&&0! .(! ,5&&(;%5&&%+<(8! #E!/3++%! %.+! 5&'! -)5-5+0! 3&! ,/*)(! ,5&,(-'3(.! 23/.%O%0!
*$/&'%F)(-)0+(&'/'%5&&/.%+'(! C23%! /! *5&&0! .%(3! *(-3%+! /3;! '605)%(+! *(! .$(<B5*%(<(&'=8!!
T&! -(3! (&! /))%N)(! *(! ,(''(! +,N&(?! *$/3')(+! -6%.5+5-6(+! 5&'! %&*%230! E! ,6/23(! O5%+! .(+!
.%<%'(+! *(+! -5'(&'%/.%'0+! *(+! *%+-5+%'%O+! O5)<(.+?! ('! +3)'53'!,(..(+! *(+! -)0'(&'%5&+!
/OO%,60(+! -/)! .(+! /3'(3)+! *(+! ,/*)(+! ,5&,(-'3(.+! C.(! <5*3./)%+<(! *(! U5*5)?! ('! +5&!
*0+%&'0)G'! -53)! .(+! &(3)5+,%(&,(+?! -/)! (;(<-.(?! 53! (&,5)(! .(+! *%OO%,3.'0+! *(+! +L+'N<(+!
,5&&(;%5&&%+'(+! E! )(&*)(! ,5<-'(! *(! ./! )07()+%B%.%'0! (&')(! ./! ,5<-5+%'%5&! *$0.0<(&'+!
+%>&%O%/&'+!('!.(3)!*0,5<-5+%'%5&?!23%!-()<('!*$/3')(+!)(,5<-5+%'%5&+8!!
A=! :$(+'! -/)! 3&! ')/&+O()'! *(+! </'60</'%23(+! C+L+'N<(! *$023/'%5&+! *%OO0)(&'%(..(+=! E!
.$0,5&5<%(!23(!./!'605)%(!0,5&5<%23(!/!-3!+$0'/B.%)!E!3&!&%7(/3!O5)<(.!/3!"VN<(?!*5&,!
-/)!3&(!%&'()*%+,%-.%&/)%'0!23$5&!-537/%'!-(&+()!(;(<-./%)(8!953)'/&'!3&!+(&+?!,(!+3,,N+!
<(&/%'!*/&+!3&(!%<-/++(?!-3%+23$/3!AWN<(?!.(!<G<(!X(B)(3!23%!/!*$/B5)*!*0<5&')0!/7(,!
Y))5Z! (&! "V[\! .$(;%+'(&,(! *(! ,('! 023%.%B)(?! ('! ./! -5++%B%.%'0! *(! .(! O5)<3.()! */&+! .(+!
'()<(+! ! *(! ./! '605)%(! *(+! D(3;?! /! (&+3%'(! *0<5&')0! /7(,! I,/)O!!7%&>'! /&+! /-)N+! C"V]\=!
.$%<-5++%B%.%'0! *$/++3)()! 23$3&(!-)5,0*3)(! *(! 'P'5&&(<(&'! -()<(''(! *(! ')537()! ,('!
023%.%B)(! 23/&*! 5&! +(! +%'3(! 65)+! 023%.%B)(8! #(+! *%+-5+%'%O+! /3')(+! 23(! .(! 'P'5&&(<(&'!
-)5-5+0+! -53)! -/..%()! ,(! *0O/3'! &(! <N&(&'! -/+! E! 3&! 023%.%B)(! 3&%23(?! 53! (;%>(&'! *(+!
6L-5'6N+(+!O5)<(..(+!-(3!-./3+%B.(+8!!
Q&!,(! 23%! ,5&,()&(! .$023%.%B)(! >0&0)/.?!./! ,)%'%23(! /! 0'0! %&'()&(?! +/&+! .%(&! /7(,! *(+!
*%+,3++%5&+! -6%.5+5-6%23(+8! ! ^/%+! (..(! ./%++(! </%&'(&/&'! 537()'(! *$/3')(+! -%+'(+! 23%!
*5&&(&'! .%(3! E! *(+! *07(.5--(<(&'+! -6%.5+5-6%23(+! M! ('! E! *(+! ,)%'%23(+! *3! -/)/*%><(!
0,5&5<%23(! *5<%&/&'! C,O8! _%)</&=8! 9/)! /%..(3)+!(..(! (+'! *(7(&3(! (;'()&(! ('!
-/)'%(..(<(&'! -6%.5+5-6%23(! 23/&*! 5&! /! (;-.5%'0! .(+! (;-0)%(&,(+! (&! -+L,65.5>%(! *(!
.$0,5.(!*(!_/6&(</&!('!`7()+aL!!-53)!,)%'%23()!.(+!/;%5<(+!*(!./!'605)%(!*(!./!*0,%+%5&!('!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 (tirés de mon expérience personnelle)

!
A!
-)5-5+()! *(+! 7()+%5&+! -.3+! )%,6(+! ,5&,(-'3(..(<(&'! C)(>)('?! /&'%,%-/'%5&+?! 7/)%/'%5&+!
*(+!-)0O0)(&,(+!/3!,53)+!*3! '(<-+=8!T&! /3')(!*07(.5--(<(&'! 7()+!.$(;'0)%(3)!/!*5&&0!
.%(3?! */&+! .(! -)5.5&>(<(&'! *(! ,(''(! -)(<%N)(! ,)%'%23(?! E! ./! &(3)5F0,5&5<%(?! 23%! /! *(+!
-)0'(&'%5&+!*(!)0/.%+<(?!('!23%!/!*(+!)(./%+!-6%.5+5-6%23(+!C&(3)5F-6%.5+5-6%(=!</%+!23%!
*5&&(!(..(!/3++%!.%(3!E!*(+!,)%'%23(+!0-%+'0<5.5>%23(+?!7(&/&'!'/&'!*(+!-6%.5+5-6(+!23(!
*(+!&(3)5+,%(&,(+8!!
H=!#(+! +%<3./'%5&+! 5&'! *$/B5)*! 0'0!3'%.%+0(+! (&! -6L+%23(! C'605)%23(! 53!/--.%230(?! !-/)!
(;(<-.(! E! ./! ,%),3./'%5&=! -53)! *5&&()! *(+! %*0(+! -.3+! ,./%)(+! *(! ,(! 23(! *5&&/%'!
.$075.3'%5&!*(!+L+'N<(+!*5&'!.(+!023/'%5&+!&(!-()<(''(&'!-/+!*(+!+5.3'%5&+!/&/.L'%23(+8!
Q..(+! +5&'! *(7(&3(+! 3&! 53'%.! ,53)/&'! *3! -6L+%,%(&! ,5<<(! *3! ,5+<5.5>3(! 53! *3!
<0'05)5.5>3(8!^/%+!,(!&$(+'!-/+!,6(b!(3;!23$5&!)(&,5&')(!*(+!-)5,./</'%5&+!*(!&537(..(!
N)(! ,5&,(-'3(..(?! </%+! -.3'4'! */&+! *(+! *5</%&(+! 5c! .(+! +%<3./'%5&+! +5&'! <5%&+!
%&+'/..0(+?! ,5<<(! ./! B%5.5>%(! C(;(<-.(!1! .(! '53'! /3'5</'(+! ,(..3./%)(+! *(! d5.O)/<=8! K&!
)(')537(! /.5)+! ./! <G<(! *3/.%'0! (&')(! ,(+! -)5,./</'%5&+! ('! *(+!,)%'%23(+!
0-%+'0<5.5>%23(+!23%!7%+(&'!,(+!-)0'(&'%5&+!C-/)!(;(<-.(!./!-)0'(&'%5&!*3!J3</&!e)/%&!
9)5D(,'!(3)5-0(&!*(!+$(&!'(&%)!E!./!.%''0)/'3)(!(;%+'/&'(!+3)!.(+!,5&&(;%5&+!&(3)5&/.(+!('!
*(! )/%+5&&()! -/)! +%<3./'%5&+! +/&+! O/%)(! *$(;-.5)/'%5&+! +3--.0<(&'/%)(+=?! 53! 23%!
*0&5&,(&'!.(+!.%<%'(+!*(!.$3+/>(!*(!'(.!<5*(!*(!+%<3./'%5&!*/&+!'(.!53!'(.!*5</%&(8!!
#/!&537(/3'0?! ,$(+'! 23(! .(+!+%<3./'%5&+!*/&+! 3&! *5</%&(! '53'! /3++%! ,5<-.(;(?! (&! IJI?!
5&'! *5&&0! .%(3! E! *(+! %&'()/,'%5&+! /7(,! *(+! *%+,%-.%&(+! ! 23%! /7/%(&'! -(3! )(,53)+! E! ./!
O5)</.%+/'%5&! ('! 23%! 5&'! (&! )(7/&,6(! 3&! B/>/>(! %&'()-)0'/'%O! ,5&,(-'3(.! ')N+! )%,6(! ('!
*%7()+%O%08!:(./!)(D/%..%'!+3)!./!)%,6(++(!*(+!*%+,3++%5&+!0-%+'0<5.5>%23(+8!f.!+$/>%'!<5%&+!!
/.5)+! *(! ./! ,)%'%23(! *(! -)0'(&'%5&+! /&&5&,0(+?! 23%! +()/%'! /%+0(?! 23(! *(! .$/&/.L+(! *(+!
*%OO%,3.'0+!*(!<%+(!/3!-5%&'!*(!,5&,(-'+!,5<<3&+?!*/&+!.(+!%&'()/,'%5&+!(OO(,'%7(+!(&')(!
*%+,%-.%&(+?! E! -)5-5+! *$5BD('+! ,5&,)('+?! 53! *(+! ,/-/,%'0+! *(+! O5)</.%+<(+! E! )(&*)(!
,5<-'(!*(+!+3B'%.%'0+!*(+!*%OO0)(&,(+!*$%&'()-)0'/'%5&8!!!
!
II!Le!travail!philosophique!et!l’interdisciplinarité!
I3)! ,(+! ')5%+! (;(<-.(+?! 5&! &5'()/! 23(! .$/,'%7%'0! -6%.5+5-6%23(! C*(+! -6%.5+5-6(+!
-)5O(++%5&&(.+!</%+!/3++%! *(+!+,%(&'%O%23(+! *3!*5</%&(=! &(!+$(+'! -/+!B5)&0(! +5%'!E! *(+!
+-0,3./'%5&+! >0&0)/.(+?! +5%'! E! *(+! 0'3*(+! 0-%+'0<5.5>%23(+! )0/.%+0(+?! ,5<<(! .(!
)(,5<</&*/%'! .$0,5.(! O)/&g/%+(! *$0-%+'0<5.5>%(! *3! *()&%()! +%N,.(?! /3! '()<(! *$3&(!
6%+'5%)(! D3>0(! 3&(! O5%+! .(+! )0+3.'/'+! +,%(&'%O%23(+! +'/B%.%+0+! C*5&,! 3&! +%N,.(! /-)N+=8!
#$/,'%7%'0! -6%.5+5-6%23(! /! */7/&'/>(! ,5&+%+'0! E! O/%)(! ')/7/%..()! *(+! ,6/<-+! *(!
,5&')57()+(+?!+5%'!-/)!3&(!,)%'%23(!*(+!O5&*(<(&'+!('!*(+!B3'+!O%&/3;!*(+!-)5>)/<<(+?!
+5%'!-/)!3&!')/7/%.!*$0,./%),%++(<(&'!*(+!</.(&'(&*3+!+3)!.(+!,5&,(-'+!/&&5&,0+!,5<<(!
)0>3./'(3)+!('!*(+!*%OO0)(&,(+!/7(,!.(3)!3+/>(!(OO(,'%O8!X/&+!./!<(+3)(!5c!.(+!*(3;!B%/%+!
*(! +-0,3./'%5&! >0&0)/.(! 53! *(! )('/)*! 6%+'5)%23(! -(37(&'! G')(! ,5&+%*0)0+! ,5<<(! *(+!
*0O/3'+! *(! ./! -)5O(++%5&! -6%.5+5-6%23(?! 5&! -(3'! *5&,! -(&+()! 23(! .(+! ,6/<-+!
%&'()*%+,%-.%&/%)(+! +5&'! *(+! '())/%&+! O/75)/B.(+! E! *(+! /,'%7%'0+! -6%.5+5-6%23(+! -.3+!
7%7/&'(+8!!
Y!'53'!.(!<5%&+?!%.!+$/>%'!*$3&!)(<N*(!E!./! '(&*/&,(!*(!./!-6%.5+5-6%(!-)5O(++%5&&(..(!E!
+$%+5.()! *3! )(+'(! *(+! *%+,%-.%&(+?! +5%'! (&! ,53-/&'! .(+! -5&'+! /7(,! .(+! +,%(&,(+?! +5%'! (&!
3'%.%+/&'!./!,53-3)(!'(<-5)(..(!23%!+0-/)(!.(+!+,%(&,(+!*3!-/++0!*(+!+,%(&,(+!*3!-)0+(&'8!
:(''(!'(&*/&,(!&(!)0+3.'/%'!*$/%..(3)+!-/+!*$3&(!75.5&'0!/3'5&5<(!*(+!-6%.5+5-6(+8!Q..(!
0'/%'!*$/%..(3)+!./!,5&')(-/)'%(!*(!./!-)5-(&+%5&!*(+!*%+,%-.%&(+!E!+(!*0O%&%)!/3!,53)+!*(+!
+%N,.(+! (&! +$/3'5&5<%+/&'! *(! ./! -6%.5+5-6%(8! #$%&'()*%+,%-.%&/)%'0! O/%'! )(7%7)(! *(! ./!
-6%.5+5-6%(!M!-/+!O5),0<(&'!/,/*0<%23(F!*/&+!.(+!%&'()+'%,(+!*(+!*%+,%-.%&(+8!!

!
H!
#$(&7()+!*(!./!<0*/%..(!(+'!23$%.!(+'!*%OO%,%.(!*(!)(>)53-()!'53'!,(!')/7/%.!-6%.5+5-6%23(!
(&! .3%! *5&&/&'! 3&(! 7%')%&(! 23%! .3%! +5%'! -)5-)(8! I/! 7/.%*%'0! -(3'! G')(! /++(b! 0-60<N)(?!
-3%+23(! +5&! ,5&'(&3! (+'! *0-(&*/&'! *(! ,5&')57()+(+! 23%! '%(&&(&'! E! ,(! 23(! .(+! +/75%)+!
%&'()*%+,%-.%&/%)(+!&$5&'!-/+!(&,5)(!')5370!E!,(!+'/*(!3&!+'/'3'!+'/B%.%+08!#(+!'()<(+!*(!
,(+!,5&')57()+(+!')/&+%'5%)(+!5&'!*5&,!75,/'%5&!E!*(7(&%)!5B+5.N'(+8!#(!)0+3.'/'!(+'!23$%.!
(+'! *%OO%,%.(! *(! ,3<3.()! .(+! ,5&,.3+%5&+! *(! ,(+! ,5&')57()+(+8! K&! /! B%(&! 3&(! *L&/<%23(!
-6%.5+5-6%23(!E!.$h37)(?!3&(!7%(!-6%.5+5-6%23(!/3!+(%&!*(+!+,%(&,(+?!</%+!-/+!*$h37)(+!
-6%.5+5-6%23(+!23%!5)%(&'(&'!'53'(!3&(!-0)%5*(!53!23%!./!+L&'60'%+(&'8!!
!
i3$(+'!,(! 23(! ,(+! ,5&+'/'+!+3)! .(+! O5&,'%5&+!*(+!*%+,3++%5&+! -6%.5+5-6%23(+?! 5B+()70(+!
*/&+!,(+!')5%+!(;(<-.(+?!-(37(&'!&53+!/--)(&*)(!+3)!.$%&'()*%+,%-.%&/)%'0!(..(F<G<(!j!!
Q+'!,(!23(!,(./!753*)/%'!*%)(!23(!.$%&'()*%+,%-.%&/)%'0!(+'!3&!-60&5<N&(!')/&+%'5%)(?!23%!
,5<-5)'(!3&(!-6/+(!*(!,)%'%23(!*(+!-)5>)/<<(+!*(!)(,6(),6(!-)0,0*(&'+!('!*$/&&5&,(+!
*(!-)5>)/<<(+!&57/'(3)+?!(&!)(,537)(<(&'!-/)'%(.!/7(,!3&(!-6/+(!*(!*%+,3++%5&+!*(+!
+-0,%O%,/'%5&+! .%0(! E! ./! <%+(! (&! h37)(! (OO(,'%7(! *(+! -)5D('+! *(! )(,6(),6(?! -6/+(+!
/3;23(..(+!+3,,N*(! +5%'! .$(;'(&+%5&! *(! ./! *%+,%-.%&(! *$5)%>%&(?! +5%'! ./! ,5&+'%'3'%5&! *$3&(!
&537(..(! *%+,%-.%&(!j! #$/,'%7%'0! -6%.5+5-6%23(! +()/%'! /.5)+! .%0(! E! ,(''(! -0)%5*(! *(!
')/&+%'%5&?! ('! +$0'(%&*)/%'! 23/&*! 5&! )(7%(&'! /3;! ,65+(+! +3--5+0(+! +0)%(3+(+! -/),(! 23(!
+'/B%.%+0(+8!!
T&! (;/<(&! -.3+! /''(&'%O! E! .$6%+'5%)(! *(+! +,%(&,(+! M! 23$5&! -53))/! O/%)(!*/&+! &5+! ')5%+!
(;(<-.(+F!<5&')(!23$(&!O/%'?!.(+! *%+,3++%5&+!+(!-53)+3%7(&'! '53D53)+?!<G<(! +%!(..(+! &(!
+5&'!-.3+!E!.$/7/&'F+,N&(?!('!23$(..(+!-)0+(&'(&'!'53D53)+!,(!*53B.(!7%+/>(?!*(!75.5&'0!*(!
)(&537(..(<(&'! ('! *(! -)5D(,'%5&+! /<B%'%(3+(+! */&+! .$/7(&%)?! ,5<<(! *(! <%+(! /3! -5%&'!
-.3+! -/'%(&'(! *(+! %&'()-)0'/'%5&+! *(+! <0'65*(+! ('! (;-0)%(&,(+8! 9/)! /%..(3)+?! 23/&*! .(+!
*%+,%-.%&(+! +(! +'/B%.%+(&'?! 5&! 5B+()7(! /3++%! 3&! ')5%+%N<(! /+-(,'?! ,(.3%! *3! ')/7/%.! *(!
,5&+')3,'%5&!*(!)(-)0+(&'/'%5&+!23%!*5&&(&'!*(+!7()+%5&+!*(!.$0'/'!*(+!+,%(&,(+!(&!*(+!
'()<(+! 23%! -3%++(&'! -/).()! E! ,6/23(! ,%'5L(&! *$3&! &%7(/3! /7/&,0! *$0*3,/'%5&?! ('! 23%!
*5&&(&'! .%(3! E! %&'()-)0'/'%5&+! -6%.5+5-6%23(+8! ^/%+! .(! O5%+5&&(<(&'! *(+! ')/7/3;! *(!
)(,6(),6(! O/%'! 23(! ,(+! )(-)0+(&'/'%5&+! +5&'! '53D53)+! (&! )('/)*! *$3&(! 075.3'%5&! -/)!
)/--5)'! /3;! /7/&,0(+! +,%(&'%O%23(+8! :(-(&*/&'?! 5&! &5'(! /3++%! 23(! ,(+! /7/&,0(+! +(!
,6(),6(&'!*(+!)/,%&(+!('!*(+!/&,G')(+!*/&+!*(+!'(&'/'%7(+!-/++0(+?!23%!/7/%(&'!-)5-5+0!
*(+! -()+-(,'%7(+! ,5&,(-'3(..(<(&'! &57/')%,(+?! </%+! +/&+! *%+-5+()! *(! '53+! .(+! 53'%.+!
O5)<(.+!&0,(++/%)(+!-53)!.(+!*07(.5--()!C,O8!.(+!)/--5)'+!(&')(!95%&,/)0!('!./!'605)%(!*3!
,6/5+=8! f.! +$/>%'! .E! /3++%! *$%&'()-)0'/'%5&+! 0-%+'0<5.5>%23(+! ('! -6%.5+5-6%23(+?! 23%!
-)(&&(&'!3&!&537(.!(++5)8!!
#(+! /,'%7%'0+! +,%(&'%O%23(+! (OO(,'%7(+! +(! )07N.(&'! *5&,! (&')('(&%)! E! '53'(! -0)%5*(! ,(+!
(&')(./,(<(&'+! *$%&'()-)0'/'%5&+! -)5>)/<</'%23(+?! *(! <%+(+! E! .$0-)(37(! *(+! ,5&,(-'+!
('! *(! )(O5)<3./'%5&+! -.3+! %&'3%'%7(+! *(+! -)5B.0</'%23(+! +,%(&'%O%23(+?! 23%! O5)<(&'! .(!
'%++3!,5&D5&,'%O!*(+!+,%(&,(+?!'%++3!*$/,'%7%'0+!23$5&!-(3'!*%)(!-6%.5+5-6%23(+?!('!23%!+5&'!
'53'!E!./!O5%+!%&')/F!('!%&'()F*%+,%-.%&/%)(+8!:(+!(&')(./,(<(&'+!&53+!)/--(..(&'!23(!+/&+!
,(! '%++3! %&'()F-)0'/'%O?! ./! )(,6(),6(! +,%(&'%O%23(! -()*)/%'! 3&(! <5'%7/'%5&! (++(&'%(..(8!
#$%&'()F*%+,%-.%&/)%'0?! (&'(&*3(! ,5<<(! O.3;! %&'()+'%,%(.! %&'()-)0'/'%O! C%&'()+'%,%(.! -/)!
)/--5)'! /3;! O5)</.%+<(+! ('! *%+-5+%'%O+! (;-0)%<(&'/3;=! (+'! *5&,! &5&! +(3.(<(&'!
,5&+'%'3'%7(! *(! ./! ,)0/'%5&! *(! &537(..(+! *%+,%-.%&(+?! </%+! (..(! (+'! ,5&+'%'3'%7(! *(! ./!
*L&/<%23(!*(!)(,6(),6(!*(+!*%+,%-.%&(+8!!
!
#/! &5'%5&! *k3&! '%++3! *$/,'%7%'0+! -6%.5+5-6%23(+! %&'()&(+! /3;! +,%(&,(+! -()<('! *(!
)(&537(.()!3&!7%+%5&!)(g3(!*(!.$075.3'%5&!*3!)4.(!*(!./!-6%.5+5-6%(8!I(.5&!,(''(!7%+%5&?!5&!
/! ,5&g3! ./! -6%.5+5-6%(! *$/B5)*! ,5<<(! ./! <N)(! *(! '53'(+! .(+! +,%(&,(+?! -3%+! ,5<<(! ./!

!
\!
-)(<%N)(!*(+!+,%(&,(+?!-3%+!,5<<(!3&(!)0O.(;%5&!>0&0)/.(!(&!.%(&!/7(,!.(+!+,%(&,(+!</%+!
<0'/F+,%(&'%O%23(?! -3%+! ,5<<(! 3&! ,5<<(&'/%)(! *(+! )(./'%5&+! (&')(! +,%(&,(+! ('!
63</&%'0+!C(&!%&'0>)/&'!./!-5.%'%23(=?!-3%+!,5<<(!3&!,5<<(&'/%)(!*(!+/!-)5-)(!6%+'5%)(!
('!*(!.$6%+'5%)(!*(+!+,%(&,(+8!:(''(!-)5>)(++%7(!*0>)/*/'%5&!/../%'!*(!-/%)!/7(,!.$%*0(!23(!
./! +,%(&,(! -)5>)(++/%'! -/)! *%7%+%5&+! +3,,(++%7(+! *5&&/&'! .%(3! E! *(+! +-0,%/.%+/'%5&+!
*%+,%-.%&/%)(+8! K&! +$/-()g5%'! /3D53)*$63%! 23(! .$/,'%7%'0! -6%.5+5-6%23(! (+'! %&+'%..0(! */&+!
'53+! .(+! )(,5%&+! *(! ./! )(,6(),6(! +,%(&'%O%23(?! ('! 23$(..(! (+'! %&*%++5,%/B.(! *(!
.$%&'()*%+,%-.%&/)%'0!(&!,(!+(&+!O5)'?!(;'()&(!</%+!/3++%!%&'()&(!/3;!*%+,%-.%&(+?!,(..(!23%!
/&%<(! ,(''(! )(,6(),6(8! I/! -)%+(! (&! ,5<-'(! /<N&(! *5&,! E! *5&&()! 3&! +(&+! 3&! -(3!
*%OO0)(&'!E!./!&5'%5&!*$%&'()*%+,%-.%&/)%'08!!
Q+'F%.!/.5)+!(&,5)(!+536/%'/B.(?!(&!+3--5+/&'!23(!,(''(!,5&*%'%5&!%&'()F*%+,%-.%&/%)(!*(!./!
-6%.5+5-6%(! *(7%(&&(! +/! -)%&,%-/.(! ,5&*%'%5&?! *(! -5375%)! )(-0)()! 3&(! R!+/7(3)!S!
-)5-)(<(&'!-6%.5+5-6%23(!*(!,(+!/,'%7%'0+!*(!*%+,3++%5&!*$%&'()-)0'/'%5&+?!('!+%!53%?!-/)!
23(.+! ')/%'+! +(! +%>&/.(F'F(..(j! #(! -)(<%()! *(! ,(+! ')/%'+! (+'! 23(! -53)! '53'(! 23(+'%5&!
*$%&'()-)0'/'%5&!,5&'(<-5)/%&(?!5&!-(3'!(&!-6%.5+5-6%(!)(')537()!*/&+!.$6%+'5%)(!-/++0(!
*(! ./! -6%.5+5-6%(! *$/3')(+! 23(+'%5&+! -5+0(+! 23%! -)0+(&'(&'! /7(,! ./! -)(<%N)(! *(+!
+%<%./)%'0+! %<-5)'/&'(+8! Y! ,(+! 23(+'%5&+?! -.3+%(3)+! '(&'/'%7(+! *(! )0-5&+(! /7/%(&'! /3++%!
0'0! *5&&0(+! */&+! .(! -/++0?! </%+! /3,3&(! *$(&')(! (..(+! &(! +$0'/%'! )070.0(! '5'/.(<(&'!
+/'%+O/%+/&'(8!Q&!)(7/&,6(?!.(!')/7/%.!-6%.5+5-6%23(!*(!,)%'%23(!*(!,(+!)0-5&+(+!/!<5&')0!
23(.+!0'/%(&'!.(3)+!*0O/3'+?!('!(&!235%!(..(+!-)0+(&'/%(&'!*(+!%<-/++(+!-53)!./!)0O.(;%5&8!
f.!(+'!*5&,!-5++%B.(!*$3'%.%+()!,(+!+%<%./)%'0+!-53)!/.()'()!,(3;!23%!+()/%(&'!'(&'0+!-/)!*(+!
)0-5&+(+!+%<%./%)(+!+3)!.(+!*%OO%,3.'0+!23%!.(+!/''(&*(&'8!#/!-6%.5+5-6%(!&(!&53+!/--)(&*!
23(!-(3! *(!,65+(+! -5+%'%7(<(&'?! </%+!(..(! -(3'! &53+!(&! /--)(&*)(!3&! ,()'/%&! &5<B)(!
&0>/'%7(<(&'8!!
:(-(&*/&'?! ,(+! /.()'(+! )(-5+(&'! +3)! *(+! +%<%./)%'0+! (&')(! .(+! 23(+'%5&+! -)0+(&'(+! ('!
-/++0(+?!('!&5&!+3)!*(+!%*(&'%'0+8!T&!3+/>(!/B3+%O!*(!,(+!+%<%./)%'0+!-53))/%'!/<(&()!E!
-)0'(&*)(!*%+23/.%O%()!*(+!-%+'(+!*(!)(,6(),6(!*(!</&%N)(!/B3+%7(8!#(!)(<N*(!(+'!/.5)+!
*(!&53+!)(&*)(!-.3+!+(&+%B.(!/3;!*%OO0)(&,(+!/3!+(%&!*(!,(+!+%<%./)%'0+?!,(!23%!/<N&(!E!
/&/.L+()! -.3+! O%&(<(&'! (&! 235%! %.! L! /! (3! *0-./,(<(&'! ,5&,(-'3(.! (&')(! .(+! *%OO0)(&'(+!
O5)<3./'%5&+!+3,,(++%7(+!*(!23(+'%5&+!/--/)(<<(&'!+%<%./%)(+8!l(-0)()!.(+!+%<%./)%'0+!
/7(,!.(+! %<-/++(+! -/++0(+!('! /&/.L+()! .(+! *%OO0)(&,(+!,5&,(-'3(..(+! /7(,! *(+! 23(+'%5&+!
+%<%./%)(+?! ,(! +5&'! .E! .(+! *(3;! ')/%'+! 23%! -(37(&'! +%>&/.()! 3&(! /,'%7%'0! -)5-)(<(&'!
-6%.5+5-6%23(! M! ('! ,(! +5&'! *(3;! ,5&*%'%5&+! 23(! .(+! /&&5&,(+! *(! -)5>)/<<(+! *(!
)(,6(),6(! /<B%'%(3;! ('! +3--5+0+! /--5)'()! *(+! )(&537(..(<(&'+! &(! )(<-.%++(&'! 23(!
)/)(<(&'8!!
!
III!Un!exemple!d’étude!interdisciplinaire!d’un!déplacement!conceptuel!
Y!'%')(!*$(;(<-.(!*(!,(!')/7/%.!*(!)/--(.!*(+!%<-/++(+!('!*(!*0'(,'%5&!*(+!*0-./,(<(&'+!
,5&,(-'3(.+?!5&!-(3'!0'3*%()!.$3+/>(!*(!./!&5'%5&!*(!,5&,(-'!*/&+!.(+!*%/>)/<<(+!T^#?!
('!.(+!-)5B.N<(+!-6%.5+5-6%23(+!/++5,%0+!E!,(''(!&5'%5&8!!
T&! ,/*)(! )(,'/&>3./%)(! */&+! 3&! *%/>)/<<(! T^#! )(-)0+(&'(! 3&(! ,./++(?! /++5,%0(! E! 3&!
,5&,(-'8! I%! 5&! B/+(! .$5&'5.5>%(! *3! *5</%&(! +3)! .(+! 0.0<(&'+! *3! *%/>)/<<(! T^#?! 5&!
*(7)/! *5&,! ,5<-'()! .(+! ,5&,(-'+! */&+! &5')(! 5&'5.5>%(8! f.! +(<B.(! 23(! ,$(+'! .E! +3%7)(! ./!
75%(!-)5-5+0(!-/)!U)(>(!1! %.!753./%'!*$3&(!-/)'!*%OO0)(&,%()!.(!,5&,(-'!Ce(>)%OO=!*3!+(&+!
CI%&&=!-3%+23(!-53)!.3%!3&!,5&,(-'!(+'!&5&!-/+!.(!+(&+?!</%+!./!*0&5'/'%5&!Ce(*(3'3&>=!
*$3&! '()<(! ,5&,(-'3(.! C-/)! (;(<-.(! 3&! '()<(! ,5<<(! R!-./&N'(!S?! !53! R!)53>(!S=8!
:(-(&*/&'?!%.!+(!)(O3+(!E!)0*3%)(!.(!,5&,(-'!/3;!(&'%'0+!'5<B/&'!+53+!.(!,5&,(-'?!*5&,!E!
+5&! (;'(&+%5&?! -/),(! 23$%.! -(&+(! 23(! .(! ,5&,(-'! *5%'! G')(! *5&&0! /7/&'! +5&! (;'(&+%5&8!
^/%+! -/)! /%..(3)+?! ,5<<(! %.! )(.%(! .(! ,5&,(-'?! ,5<<(! R!%&+/'3)0!S! C&(! *5&&/&'! -/+! E! .3%!

!
[!
+(3.!3&(!7/.(3)!*(!70)%'0=?!('!./!&5'%5&!*(!O5&,'%5&?!%.!+536/%'(!,(-(&*/&'!.(!)/''/,6()!E!
3&(!7()+%5&!(;'(&+%5&&(..(?!23%!-53)!./!O5&,'%5&!(+'!,(..(!*(!+5&!-/),53)+!*(!7/.(3)+!C./!
.%+'(!*(!+(+!%&-3'+!('!53'-3'+!('!.(3)+!,5))(+-5&*/&,(+=8!K)?!,5<<(!5&!+/%'?!-()<('')(!E!
'53'!,5&,(-'! *(! *0O%&%)! 3&(! ,./++(! C3&(! (;'(&+%5&! +0.(,'%5&&0(! -/)! 3&(! -)5-)%0'0=! 7/!
,5&*3%)(!/3!-/)/*5;(!*(!l3++(..?!,(.3%!*(!./!,./++(!*(+!,./++(+!23%!&$/--/)'%(&&(&'!-/+!E!
(..(+F<G<(+8!:(!-/)/*5;(!'%(&'!E!,(!23$5&!3'%.%+(!3&(!&5'%5&!C,(..(!*$/--/)'(&/&,(=!23%!
-()<('!*(!'53'!)/B/'')(!+3)!.(+!(&'%'0+!0.0<(&'+!*/&+!3&!3+/>(!23%!%<-.%23(!*$G')(!')N+!
.%B0)/.! +3)! .(+! *%+'%&,'%5&+! /*<%++%B.(+! -53)! *0O%&%)! .(+! )4.(+! 23(! -(37(&'! D53()! ,(+!
)/++(<B.(<(&'+! *$0.0<(&'+8! #(! -)5D('! *$3&(! .5>%23(! *(+! ,5&,(-'+?! (&7%+/>0! -/)! mn*(.!
'53'!/3!.5&>!*(!+/!7%(?!*(7%(&'!*5&,!-0)%..(3;?!-3%+23(!./!&5'%5&!*(!,5&,(-'!(;%>(!,(''(!
.%B0)/.%'0?!23%!7/!D3+23$E!/*<('')(!23(!1!R!&(!-/+!G')(!3&!,5&,(-'!S!-3%++(!G')(!'(&3!-53)!
3&! ,5&,(-'! F-53)'/&'! ,(./! )(7%(&'! E! *%)(! 23(! 23(.23(! ,65+(! 23%! &$(+'! -/+! 3&! ,5&,(-'!
60)%'(!*(!./!-)5-)%0'0!*$G')(!3&!,5&,(-'!o!!
#(! ./<B/F,/.,3.! *(! :63),6! /! -53)+3%7%! ./! -%+'(! *(+! O5&,'%5&+?! /7(,! +/! &5'%5&!
*k/B+')/,'%5&?!23%!-()<('!*$(;-)%<()!*/&+!3&!./&>/>(!O5)<(.!./!&5'%5&!1!R!./!O5&,'%5&!23%!
-53)!'(..(+!+-0,%O%,/'%5&+!*(!./!7/)%/B.(!*5&&(!.%(3!E!'(..(+!7/.(3)+!S8!:(!./&>/>(!(+'!,(&+0!
*0'()<%&()!./!-)5,0*3)(!23%!,5&*3%'!*$3&(!7/)%/B.(!E!+/!7/.(3)?!</%+!,5<<(!5&!-(3'!L!
O5)<3.()!*(+! O5&,'%5&+!23%! +$/--.%23(&'! E!(..(+F<G<(+?! ,(''(!-)5,0*3)(! -(3'! &(!-/+! +(!
'()<%&()?! 5)! 3&! -/)/*5;(! ,5))(+-5&*! E! 3&(! -)5,0*3)(! 23%! &(! +(! '()<%&(! -/+8! K&!
)(')537(!*5&,!.(+!(OO('+!-/)/*5;/3;!*$3&(!.5>%23(!*(+!,5&,(-'+8!:(-(&*/&'?!,5<<(!.(+!
%&O5)</'%,%(&+!-(37(&'!+(!*5&&()!*(+!<5L(&+!*(!)(-0)()!*(!'(..(+!B53,.(+?!.(3)!/+-(,'!
-/)/*5;/.!(+'!)0*3%'!E!3&(!%<-/++(!*3!,/.,3.?!23$5&!-(3'!07%'()?!*$3&(!</&%N)(!23(.23(!
-(3! /*! 65,?! -/)! *(+! ,5*/>(+! *%OO0)(&'+8! Q'! +%! .$5&! 7(3'! 07%'()! 23(! *(+! ,5&,(-'+! *(!
,5&,(-'+!&(!+5%(&'!-/+!*%+'%&>30+!*(+!,5&,(-'+?!5&!-(3'!3'%.%+()!3&!./<B*/!,/.,3.!'L-08!!
X3!,53-?!.(!*)/<(!-6%.5+5-6%23(!*3!-/)/*5;(!0'/&'!+3--5+0!,5&'(&3?!5&!-(3'!-)0'(&*)(!
)0%&')5*3%)(! .(+! ,5&,(-'+! */&+! .$5&'5.5>%(?! ('! .(+! O/%)(! O%>3)()! */&+! .(+! )(,'/&>.(+! *(+!
*%/>)/<<(+! T^#8! ^/%+! -53)! .$5&'5.5>%(! -6%.5+5-6%23(?! .(! -)5B.N<(! )(+'(! (&'%()!1!
,5<<(&'! B%(&! O5&*()! .(+! *%+'%&,'%5&+! (&')(! 'L-(+! +/&+! )0%&')5*3%)(! .(+! -)5B.N<(+! *(+!
,5&,(-'+!j! #(+! -6%.5+5-6(+! 5&'! )0,(<<(&'! -)0O0)0!(&! /--(.()! E! ./! *%OO0)(&,(! (&')(!
.$5&'5.5>%(!23%!')/%'(!*(+!(&'%'0+!C(&!+(!,(&')/&'!+3)!.(+!(&'%'0+!(;%+'/&'(+=!('!./!.5>%23(!
23%!O5)<3.(!.(+!,5<B%&/%+5&+!*(!.(3)+!)(-)0+(&'/'%5&+8!!:$(+'! .(! ,53)/&'! *%'! *(+! R!')3'6F
</a()+!S?!5c!.$5&!+53'%(&'!23(!,(!23%!O/%'!./!70)%'0!*$3&(!-)5-5+%'%5&?!,(!+5&'!+%<-.(<(&'!
.(+!(&'%'0+!23$(..(+!,5<-5+(&'8!K)!,(+!(&'%'0+!+5&'?!-53)!-)(&*)(!3&(!5&'5.5>%(!,./++%23(?!
*(+! +3B+')/'+! 53! +3B+'/&,(+! ('! *(+! -)5-)%0'0+! 53! 23/.%'0+?! </%+! ,(! &(! +5&'! -/+! *(+!
,5&,(-'+8!9/)!(;(<-.(?!*/&+!.(! ,53)/&'!*%'!R!')5-%+'(!S?!23%!&$/*<('!23(! *(+!-)5-)%0'0+!
-/)'%,3.%N)(+! )(.%0(+! -/)! 3&(! )(./'%5&! *(! ,5<-)0+(&,(?! ('! 07(&'3(..(<(&'! +%<%./%)(+!
(&')(! (..(+?! !.(+! -)5-)%0'0+! +5&'! (&! O/%'! ,5&+%*0)0(+! ,5<<(! R!+/'3)0(+!S! F! ,(! +5&'! *(+!
-)5-)%0'0+! ,5&,)N'(+! -/)'%,3.%N)(+F! ('! &5&! -/+! ,5<<(! R!%&+/'3)0(+!S?! E! ,5<-.0'()! -/)!
3&(!(&'%'0!-/)'%,3.%N)(?!,(!23%!(+'!.(!,/+!*(+!,5&,(-'+8!!
#(! -)5B.N<(! 23(! ,(''(! +5.3'%5&! +53.N7(?! ,$(+'! 23$5&! &(! +/%'! -/+! ,5<<(&'! *(+! (&'%'0+!
-(37(&'!E!(..(+!+(3.(+!%&*3%)(!3&(!70)%'0!C)0+3.'/'!*$3&(!07/.3/'%5&=?!23%!0'/%'!D3+23$/.5)+!
.%0(! E! ./! ,5<-5+%'%5&! ,5))(,'(! C53! -/+?! -53)! ./! O/3++('0=!(&')(! +3B+')/'! ('! -)5-)%0'0?!
*3/.%'0! *(! &5'%5&+! 23%! )(&75L/%'! E! ./! *%OO0)(&,(! (&')(! )0O0)(&'! -/)'%,3.%()! ('! ,5&,(-'8!
i3$%.!L!/%'!*(!./!&(%>(!('!23$%.!L!/%'!,(!B./&,!-/)'%,3.%()!&(!+3OO%'!-/+!E!O5&*()!./!70)%'0!*(!
R!,(''(!&(%>(!(+'!*(!,(''(!,53.(3)!B./&,6(!S!F!%.!O/3'!(&,5)(!)(.%()!.(+!*(3;!('!07/.3()!,(''(!
.%/%+5&8!
K)! ,(.3%! 23%! O/%'! *(+! *%/>)/<<(+! T^#! +3--5+(! *5&&0(+! ,(''(! -5++%B%.%'0! *(! .%/%+5&! ('!
,(''(!-5++%B%.%'0!*(!70)%'0?!+%&5&!%.!&$/3)/%'!-/+!%&')5*3%'!'(.!)(,'/&>.(!*/&+!+5&!+,60</8!
K&! -(3'! *$/%..(3)+! )(')537()! */&+! ,(+! *%/>)/<<(+! .(+! &5'%5&+! *(! .$5&'5.5>%(!
 6
6
 7
7
1
/
7
100%