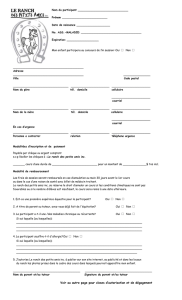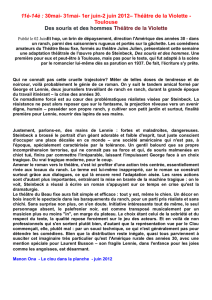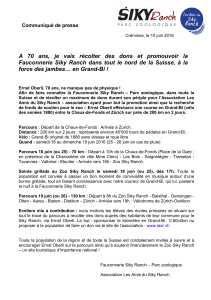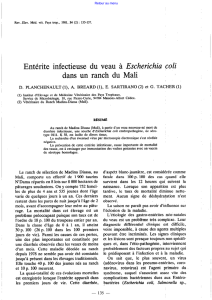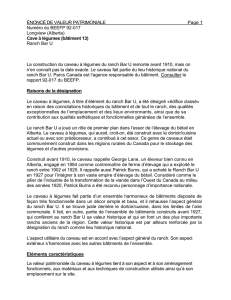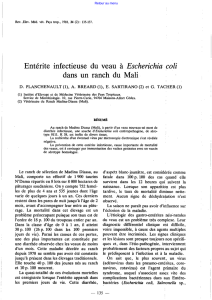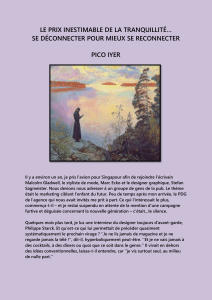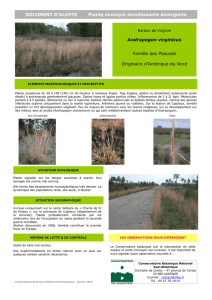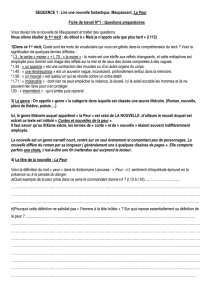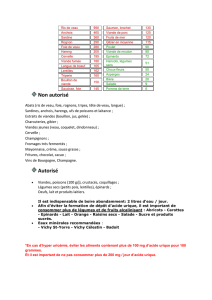impact feu.indd - Les Presses agronomiques de Gembloux

Introduction
L’impact du feu sur la végétation et son usage par les
populations apparaissent dès les premiers documents
relatifs à l’étude de la végétation savanicole de l’Afrique
(White, 1965 ; Komarek, 1965 ; Monnier, 1968, 1981 ;
Malaisse, 1973 ; Schnell, 1971 et 1976 ; Bruzon, 1990). Au
Ranch de gibier de Nazinga (RGN), les études récentes
sur les feux sont relativement abondantes. L’essentiel
des études a toutefois porté sur la strate herbacée et les
relations faune/pâturage (Decker, 1984 ; Jachmann, 1987 ;
Nana, 1988 ; Frame, 1990 ; Yaméogo, 1999). En fonction de
leur période de réalisation, on distingue : les feux précoces
(novembre-début de saison sèche), les feux intermédiaires
(janvier-février, en milieu de saison sèche), les feux tardifs
(avril-mai en fin de saison sèche) et les feux de contre-
saison (juin-juillet en pleine saison des pluies). Le feu est
un élément constant à Nazinga. Tantôt spontané, tantôt
contrôlé, il est considéré comme un facteur essentiel dans
la gestion des écosystèmes du RGN. La maîtrise du feu
à Nazinga est fondamentale pour la compréhension des
relations entre les animaux et leurs habitats, l’évolution de
la disponibilité alimentaire ainsi que le suivi de la distribution
de la faune et le contrôle du braconnage.
Sur la strate herbacée, notre objectif est d’évaluer l’effet
du feu sur l’évolution phénologique et son impact sur la
production maximale de phytomasse sur les différentes
espèces étudiées. Sur les plantes ligneuses, l’objectif
poursuivi est d’évaluer la repousse ligneuse et l’évolution
des phénophases selon les types de feu appliqués sur un
certain nombre d’espèces.
V L’impact des feux sur les strates
herbacée et ligneuse
Ouédraogo M., Delvingt W.

292 Nazinga
Matériel et méthodes
La strate herbacée
Le site d’implantation
Cette expérience a été réalisée en station. Dans la
classification des paysages du RGN, le site est situé sur
une formation de savane arborée à Terminalia avicennioides
et Crossopteryx febrifuga. La strate herbacée est dominée
par Andropogon ascinodis et Hyparrhenia involucrata. La
topographie environnante est quasi plane, avec une pente
de 0 à 1 %. Une fosse pédologique de 0,85 m de largeur,
1,5 m de longueur et 0,45 m de profondeur a été ouverte.
À cette profondeur, nous avons rencontré la carapace
ferrugineuse.
Matériel végétal utilisé et dispositif expérimental
Treize espèces herbacées vivaces (Tableau 43) spontanées
récoltées à Nazinga ont été multipliées en station à
partir d’éclats de souches constitués de 3 à 5 talles.
L’expérimentation comprend 13 objets en 9 répétitions
aléatoires chacun, soit en tout 117 micro-parcelles de 1,5
x 1,5 m. Les plants ont été maintenus à l’abri de la dent
des animaux grâce à une clôture placée à une distance de
5 m de la superficie plantée. La strate ligneuse n’a pas été
éliminée. Une vue des traitements effectués est présentée
à la figure 36. Le choix des espèces a été fait sur base de
leur abondance dans les pâturages du RGN et de l’intensité
de leur consommation observée sur le terrain.
Observation du développement des graminées
cespiteuses
Le développement des graminées cespiteuses a été décrit
par plusieurs auteurs (Hall et al., 1978, Fournier, 1983a ;
César, 1991 ; César 1992 ; Buldgen, 1997 ; Buldgen et
al., 1997). Dans le déclenchement de l’initiation florale, la
photo-période est le facteur le plus important (Buldgen,
1998). En se ramifiant abondamment au niveau du sol, la
graminée vivace en l’absence de feu ou de coupe sévère,
édifie une touffe (Figure 36). Au fil des années, le diamètre
augmente, et comme la partie centrale non régénérée
tend à disparaître, la touffe se fragmente en groupes
d’axes. Cette séquence de développement désigne sans
équivoque la talle comme module de croissance clonale
et comme unité morphologique de base. Nos mesures en
ce qui concerne la croissance et le développement des
touffes ont donc été effectuées sur les talles et les feuilles
naissantes.
Repiquage des plants en station
Les essais de repiquage ont débuté en juin 2000. Les
espèces ont été identifiées et récoltées à l’intérieur du
RGN et les souches ont été prélevées et transportées sur
la parcelle. Elles ont été divisées en blocs de talles (3 à 5),
sectionnées à 10 cm au dessus des racines pour réduire
la transpiration avant d’être mis en terre. Les écartements
adoptés entre plants étaient de 50 cm x 30 cm. Sur chaque
placeau, 12 pieds ont été plantés. Chaque espèce est en
conséquence représentée par 9 x 12, soit 108 pieds. En
première année (juin 2000), la reprise après repiquage a
été difficile. Malgré l’apport supplémentaire d’eau puisée
dans le barrage à partir d’une charrette, les plantes sont
mortes ou n’ont pas poussé. Les nouveaux repiquages
ont réussi à partir du 15 juillet 2000. Les anciens pieds
n’ont pas été systématiquement arrachés parce que leur
état de départ ne laissait aucun espoir de survie. Pour
éviter un effet « stress » lié au repiquage nous n’avons
pas effectué de mesures en 2000 correspondant à l’année
1. Les analyses et les prélèvements ont été effectués à
partir d’octobre 2001.
Les feux
Les brûlis précoces (mi-novembre) et de contre-saison
(mi-juillet) ont été effectués au niveau des placeaux et
l’opération a été surveillée par au moins 3 personnes
pour éviter la propagation éventuelle du feu sur les autres
placeaux. Pour obtenir un nombre de pieds suffisants
par espèce, 2 ou 3 placeaux ont parfois été brûlés. La
répartition des placeaux par traitement est présentée au
tableau 44.
Les mesures effectuées
La phénologie
Cinq stades de développement ont été distingués au
moment de la récolte des fourrages : stade végétatif,
montaison, épiaison, floraison – fructification et maturation.
Au niveau de la floraison, 3 stades ont été distingués :
• 1 = début de la phase (au moins 1 talle amorce la
floraison) ;
• 2 = pleine phase (au moins 50 % des talles sont
concernées) ;
• 3 = plus de 90 % des talles sont concernées.
La phytomasse
Sur les placeaux brûlés et non brûlés selon la période,
la végétation a été coupée en octobre, en fin de saison
des pluies. Sur chaque pied, les talles ont d’abord été
Tableau 43. Liste des espèces herbacées vivaces soumises au
feu.
Andropogon gayanus* Hyparrhenia rufa
Andropogon tectorum Hyparrhenia subplumosa
Andropogon africanus Hyparrhenia smithiana
Beckeropsis uniseta Schizachyrium sanguineum
Hyparrhenia glabriuscula Schizachyrium platyphyllum
Andropogon schirensis Monocymbium ceresiiforme
Andropogon ascinodis
* Andropogon gayanus possède deux écotypes : un à large feuille
notée gayanus 1 et un écotype à feuilles minces notée gayanus 2 dans
la suite de l’exposé.

293L’impact des feux sur les strates herbacée et ligneuse
Figure 37. A – Fragmentation d’une touffe en groupes d’axes au cours du temps. B – Éclats de souche fraîchement transplantés.
C – Stades de développement d’une touffe plantée : d. stade végétatif ; e. stade montaison ; f. épiaison-maturation ;
g. repousses après coupe précoce (septembre) ; h. repousse de saison sèche et chaude.
A
B
C
d e f g h
Tableau 44. Nombre de placeaux et de pieds (entre parenthèses) par traitement.
Espèce Comparaison feu précoce/ Comparaison feu précoce /
parcelles témoins non brûlées feu de contre-saison
Feu précoce Témoins Feu précoce Feu de
non brûlés contre-saison
Andropogon africanus 1(13) 2(23) 2(15) 2(13)
Andropogon ascinodis 1(12) 3(23) 2(17) 1(12)
Andropogon gayanus 1 2(14) 1(10) 2(14) 2(13)
Andropogon gayanus 2 2(17) 2(14) 1(12) 2(14)
Andropogon tectorum 2(15) 2(15) 2(16) 1(10)
Hyparrhenia glabriuscula 2(13) 2(16) 2(22) 1(11)
Hyparrhenia rufa 2(14) 2(15) 3(21) 1(12)
Hyparrhenia smithiana 3(22) 2(22) 2(22) 1(10)
Loudetia simplex 3(16) 2(10) 2(19) 1(9)
Monocymbium ceresiiforme 1(13) 3(18) 2(21) 1(11)
Beckeropsis uniseta 1(12) 2(15) - -
Schizachyrium platyphyllum 1(11) 2(13) - -
Total 21(172) 25(194) 20(179) 13(115)

294 Nazinga
dénombrées par souche et chaque touffe a été coupée
à 10 cm environ au-dessus du sol. La phytomasse est
mesurée par souche à l’aide d’un peson à ressort d’une
portée de 2 kg et d’une précision de 10 g. La matière
sèche a été évaluée au moyen d’un four à micro-ondes.
Pour ce faire, un échantillon de 10 g de matière verte est
prélevé au hasard par espèce étudiée et séché en de
3 à 4 min de chauffage jusqu’à l’obtention d’un poids
constant de la matière sèche.
La strate ligneuse
Dispositif et espèces étudiées
Les mesures ont été effectuées sur Terminalia
avicennioides, Vitellaria paradoxa, Isoberlinia doka,
Pteleopsis suberosa, Crossopteryx febrifuga et
Combretum glutinosum. Ces espèces ont été identifiées
en raison de leur abondance dans les formations
végétales du RGN et de leur réaction différente au feu,
sur base de nos propres observations sur le terrain.
Pour chaque espèce, deux parcelles d’1 ha, chacune
protégée de pare-feu de 5 m de largeur, sont délimitées.
La première est brûlée par un feu précoce, la seconde
n’est pas brûlée. Sur les individus étudiés choisis au
hasard dans les parcelles étudiées, la circonférence du
tronc a été mesurée en cm à 1 m du sol à l’aide d’un
ruban métrique. Cette hauteur (1m) permettait à la fois de
mesurer les circonférences des troncs des arbres et les
arbustes composant notre échantillon sans difficulté. La
hauteur en dm des individus a été mesurée à l’aide d’une
planche longue de 3 m graduée en dm et le recouvrement
à partir de la mesure du diamètre moyen du houppier à
l’aide d’un ruban métrique au sol. Ces trois paramètres
ont permis d’appréhender la structure des populations
étudiées. L’expérimentation s’est déroulée en 2001.
Les mesures effectuées
En vue de comparer la population brûlée et non brûlée,
la biomasse des nouvelles repousses et le stade
phénologique ont été mesurés sur chaque individu
dans les deux traitements. Pour les besoins de l’analyse
statistique, une valeur chiffrée a été attribuée à chaque
phénophase (Tableau 45).
Tableau 45. Stades phénologiques et valeurs chiffrées
correspondantes.
Stades phénologiques Valeurs chiffrées
Présence de feuilles 1
Absence de feuilles 2
Jeunes repousses 3
Floraison / fructification 4
Maturation 5
La biomasse a été mesurée par coupe intégrale de toutes
les repousses en feuilles du pied après le passage du feu.
La phytomasse a été pesée sur place à l’aide d’un peson
à ressort d’une portée de 2 kg avec une précision de
10 g. Seules les espèces suivantes ont été considérées,
les autres étant soit de taille trop importante, soit d’une
manipulation difficile (cas de Crossopteryx febrifuga)
en ce qui concerne la récolte des feuilles : Terminalia
avicennioides, Pteleopsis suberosa, Combretum
glutinosum. Les coordonnées géographiques de tous
les individus ont été notées à l’aide d’un GPS (Global
Position System), ce qui permet d’identifier chaque pied
étudié et de noter avec certitude son comportement ou
sa destruction éventuelle par les éléphants. Cinquante
individus, dont 25 en parcelles brûlées et 25 en parcelles
non brûlées, ont été pris en compte. Les individus cassés
ou déracinés par les éléphants sont remplacés par
d’autres individus du site dans la mesure du possible.
Dans le cas contraire, on se contente des individus
restants. Le nombre d’individus étudiés sera précisé à
chaque fois que nous aborderons l’étude d’une espèce
donnée. Les mesures ont été effectuées 60 jours après le
passage du feu.
Résultats
Impact du feu sur les plantes herbacées
vivaces
Sol du site et aptitude des espèces au repiquage
Le sol du site expérimental est caractérisé par 2 horizons.
L’horizon A (0-16 cm) est brun grisâtre à l’état sec, avec une
texture de limon sableux. L’horizon B (16-45 cm) est brun
clair à l’état sec et présente une texture d’argile sableuse.
De nombreux pores fins et très fins observés sur le profil
montrent une activité biologique très développée. Selon
la Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols
(CPCS, 1967), il s’agit d’un sol ferrugineux tropical lessivé
et induré, moyennement profond (FLIMP).
Sur base du nombre de pieds vivants qui ont poussé après
le repiquage, le tableau 46 présente l’aptitude des espèces
étudiées dans les conditions de l’expérimentation.
Le genre Andropogon paraît plus apte à la transplantation
par rapport au genre Hyparrhenia, tandis que le genre
Schizachyrium s’est montré plus sensible à la reprise.
Comparaison des parcelles ayant subi un feu
précoce par rapport aux parcelles non brûlées
Une analyse de la variance à deux critères de classification
a été réalisée sur base des données en prenant comme
critères : le feu, l’espèce et l’interaction « feu * espèce ». Les
résultats de l’analyse sont présentés dans le tableau 47.
Des 4 variables étudiées, on constate qu’entre parcelles
brûlées et non brûlées, il existe une différence hautement
significative au niveau de la phytomasse par pied. Aucune
différence significative n’est observée sur les trois autres
paramètres. L’interaction des deux critères (feu et

295L’impact des feux sur les strates herbacée et ligneuse
espèce) montre également des différences hautement
significatives, à l’exception de la phytomasse par talle.
Les moyennes enregistrées pour les paramètres étudiés
en parcelles brûlées et non brûlées sont présentées au
tableau 48.
Entre parcelle brûlée (feu précoce) et parcelle non brûlée,
aucune différence significative (P > 0,05) n’a été enregistrée
sur la majorité des paramètres étudiés. Seule la phytomasse
moyenne par pied montre une différence significative (P <
0,001) avec une phytomasse maximale plus importante sur
parcelle non brûlée que sur parcelle brûlée.
Étant donné la forte variabilité observée entre espèces,
nous avons analysé le comportement de chacune des
espèces prise individuellement sur placeau brûlé et
non brûlé. Deux espèces (Andropogon shirensis et
Andropogon africanus) ont été éliminées pour insuffisance
de nombre de pieds tandis que les deux écotypes
d’Andropogon gayanus ont été pris en compte. Le tableau
49 présente les résultats de l’analyse statistique sur les
paramètres étudiés. En ce qui concerne la réaction des
espèces au feu, trois catégories d’espèces peuvent être
distinguées :
• les espèces indifférentes. Sur l’ensemble des
4 paramètres étudiés, aucune différence significative
n’a été observée. Ce sont : Andropogon africanus,
Andropogon gayanus, Beckeropsis uniseta, Hyparrhenia
rufa et Schizachyrium platyphyllum ;
• les espèces peu sensibles. Les différences significatives
ont été observées sur un à deux paramètres. Il s’agit
d’Hyparrhenia glabriuscula, Loudetia simplex et
Monocymbium ceresiiforme ;
• les espèces dont des différences significatives ont été
observées sur tous les paramètres étudiés. Andropogon
ascinodis est la seule espèce dans ce cas.
Tableau 46. Aptitude des espèces à la transplantation (n = 108 pieds plantés par espèce).
Taux de reprise Mauvaise Moyenne Bonne Très bonne
20 – 40 % 41- 60 % 61 - 80 % 81 - 90 %
Andropogon gayanus ++++
Andropogon tectorum ++++
Andropogon africanus ++++
Beckeropsis uniseta ++++
Hyparrhenia glabriuscula +++
Andropogon schirensis +++
Andropogon ascinodis +++
Hyparrhenia rufa ++
Hyparrhenia subplumosa ++
Hyparrhenia smithiana ++
Schizachyrium sanguineum +
Schizachyrium platyphyllum +
Monocymbium ceresiiforme +
Tableau 47. Résultats de l’analyse de la variance sur le nombre de talles par pied, la phytomasse par pied et par talle
et le pourcentage des talles en floraison en considérant les critères « feu, espèce » et leur interaction (feu * espèce) de
peuplements soumis au feu précoce et non brûlé.
Variable Feu Espèce Feu * espèce
Nombre de talles moyen/pied P > 0,05 P < 0,001 P < 0,001
Phytomasse moyenne/pied (gMS) P < 0,001 P < 0,001 P < 0,01
Phytomasse moyenne/talle (gMS) P > 0,05 P < 0,001 P > 0,05
Moyenne des talles en floraison (%)/pied P > 0,05 P < 0,001 P < 0,001
Tableau 48. Nombre de talles par pied, phytomasse par pied et par talle et proportion des talles en floraison sur des espèces
brûlées (172 pieds) et non brûlées (194 pieds) en octobre 2001 (15 mois après le repiquage).
Nombre moyen Phytomasse Phytomasse Moyenne des talles
de talles/pied moyenne/ moyenne/ en floraison
pied (gMS) talle (gMS) (%)/pied
P > 0,05 P < 0,001 P > 0,05 P > 0,05
Feu précoce 28 ± 25 187,8 ± 152,0 9,6 ± 9,3 75,1 ± 24,0
Absence de feu 31 ± 26 238,6 ± 220,3 9,2 ± 8,5 78,6 ± 17,0
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%