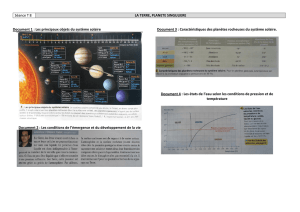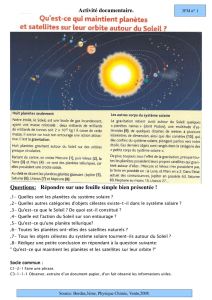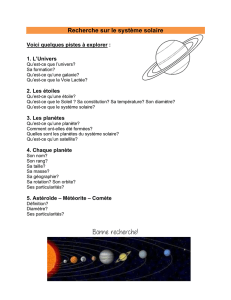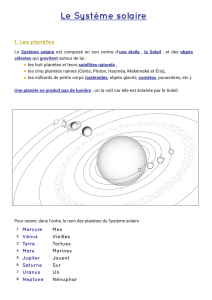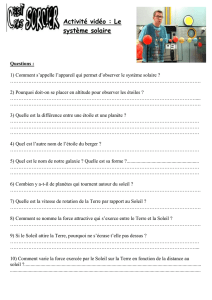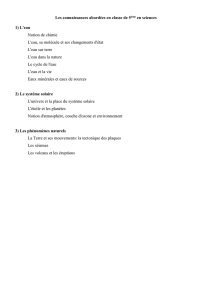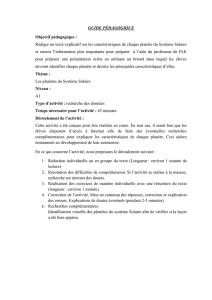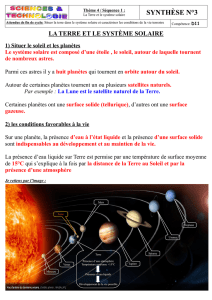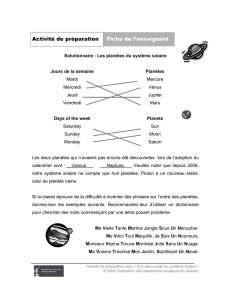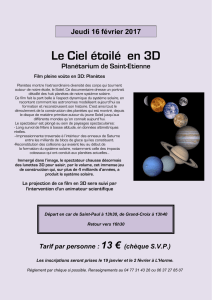1 Correction de l`épreuve de Dossier de Géologie La Terre, un objet

!
1!
Correction de l’épreuve de Dossier de Géologie
La Terre, un objet du système solaire (Seconde)
J.-L. Schneider
Introduction :
Le sujet s’inscrit dans le programme de géologie de la classe de Seconde (nouveau
programme). Les élèves ont découvert préalablement (4ème) que la Terre présente une dynamique
particulière (tectonique des plaques) et que la vie s’y est développée.
On cherche à travers les documents de ce dossier à montrer les particularités de la planète
Terre parmi les objets du système solaire. Le système solaire correspond à un ensemble d’objets
qui gravitent en orbite autour d’une étoile centrale, le Soleil. Ces objets correspondent à des
planètes (telluriques et géantes) pouvant être associes à une quantité variable de satellites, des planètes
naines (zone la plus externe du système ; objets de sphéricité imparfaite et à l’orbite particulière ;
objets de Kuiper), des astéroïdes (corps rocheux non sphériques et de petite taille gravitant entre les
orbites de Mars et de Jupiter) et des comètes (corps glacés originaires du nuage d’Oort et à la
trajectoire très elliptique).
Parmi les objets du système solaire, la Terre est une planète particulière à plusieurs titres. Sa
lithosphère est divisée en plaques mobiles, des océans occupent une grande partie de sa surface,
l’eau y est présente sous ses trois états (glace, eau liquide, vapeur), son atmosphère est
relativement dense bien que peu épaisse, la vie s’y développe dans tous les environnements.
Présentation et exploitation possible des éléments du dossier :
Document 1 : Les principales caractéristiques des gros objets du système solaire
Ce tableau résume les principales caractéristiques des planètes du système solaire, mais
présente également des données concernant un astéroïde (Cérès ; actuellement considéré comme
une planète naine du fait de sa grande taille par rapport à la taille moyenne réduite des astéroïdes)
et de deux planètes naines (Pluton et Éris). On donne des grandeurs physiques : taille, diamètre,
masse volumique, distance au Soleil, albédo de surface et les caractéristiques principales de leurs
atmosphères respectives.
Il convient, dans un premier temps, de préciser rapidement par quelles techniques on a pu
obtenir ces valeurs (orbitographie, moment d’inertie, calcul astronomique – Lois de Kepler –,
données spectroscopiques, observations et mesures par des sondes spatiales en orbite autour des
planètes ou posées à leur surface).
Ce document ne peut pas être donné aux élèves dans sa forme actuelle. Il faut le
simplifier et modifier, dans certains cas, les unités de mesures pour les rendre plus accessibles.
Ce tableau, dans le cas des planètes, permet de distinguer deux grands ensembles : les
planètes telluriques (rocheuses, à atmosphère relativement réduite) qui sont présentes dans la zone
interne du système solaire et les planètes géantes de grande taille et riches en gaz (atmosphères
épaisses), situées dans le système solaire plus externe, au-delà de la ceinture d’astéroïdes. La
densité des planètes géantes conduit, en outre, à envisager la présence d’un noyau rocheux et
dense. Les planètes géantes possèdent également un grand nombre de satellites de natures variées
et à l’activité « géologique » contrastée (satellites de Jupiter : volcanisme sur Io impliquant des
magmas soufrés ; tectonique importante sur Ganymède, radeaux de glace sur Europe ; satellites
de Saturne : Titan qui possède une atmosphère opaque et des « rivières » de méthane en surface).
Les compositions des atmosphères sont très variables en termes de proportions, mais
montrent des analogies pour les autres planètes que la Terre. Il s’agit d’atmosphères primitives, de

!
2!
composition proche de celle de la nébuleuse solaire primordiale. Seule l’atmosphère terrestre
présente de grandes quantités de dioxygène et d’azote et une faible teneur en dioxyde de carbone.
L’atmosphère terrestre est une atmosphère secondaire (en raison de l’activité biologique
photosynthétique). Il s’agit là d’une particularité de la Terre.
Les températures de surface sont très variables, mais décroissantes vers l’extérieur du
système solaire, à l’exception de Vénus et de la Terre (température sur Vénus très élevée en
raison de la très forte pression partielle de dioxyde de carbone et de l’effet de serre induit couplé
à une relative proximité du Soleil ; température élevée sur Terre en raison de la présence de gaz à
effet de serre).
Une activité envisageable pour les élèves consiste à réaliser une courbe d’évolution de la
température de surface des planètes avec la distance au Soleil. Sur une telle courbe, on constate
que Vénus et la Terre présentent une position anormale avec des températures réelles de surface
plus élevée que le montrerait une courbe « lissée ». Cette observation simple permet à l’enseignant
d’introduire la notion d’effet de serre.
Document 2 : Diagramme de phase de l’eau
Le diagramme de phase de l’eau présente ici un aspect particulier par rapport au
« classique » diagramme qui ne concerne que des domaines de pression modérée. Ici, on tient
compte des très fortes pressions. Les caractéristiques de l’eau à très fortes pression sont connues
grâce à des données expérimentales obtenues à l’aide de presses à enclumes de diamant (rappeler
le principe : ustensile de petite taille que l’on peut placer sur la platine d’un microscope
pétrographique, forte pressions appliquées sur des échantillons de très petite taille, chauffage à
l’aide d’un rayon laser, présence d’un thermocouple qui permet la mesure très précise des
températures dans le dispositif).
Pour les domaines de très forte pression, on observe la présence de nombreux
polymorphes de la glace d’eau. L’eau liquide existe à fortes pressions et températures élevées. Le
point critique de l’eau correspond au début d’un domaine où les conditions thermodynamiques
sont très particulières et pour lesquelles l’eau correspond à un fluide intermédiaire entre l’état
liquide et l’état gazeux (= fluide supercritique ; ces conditions existent sur Terre au niveau des
systèmes hydrothermaux relativement profonds ; le fluide supercritique y est alors très agressif
vis-à-vis des roches).
Il est possible d’organiser une activité des élèves à partir de ce document en leur faisant
placer les conditions de surface (pression-température) des différentes planètes pour voir dans
quels états l’eau peut s’y trouver (s’il y a de l’eau !). Cet examen montre que seule la Terre possède
de l’eau sous ses trois états, une condition indispensable (surtout la présence d’eau liquide) à
l’émergence et au maintien de la vie. Il conviendrait, dans ce cas, de modifier les échelles en fonction
des conditions planétaires et de modifier l’unité de température (°K ! °C) pour une meilleure
appréhension des données par les élèves (cf. remarque à propos des modifications du Document
1). L’eau n’est potentiellement présente que sous forme de glace au niveau des planètes géantes et
de leurs satellites. Ces objets sont en effets situés au-delà de la limite des glaces du système solaire.

!
3!
Document 3 : Séquence de condensation à l’équilibre pour un système de composition
solaire
Ce document permet d’étudier les conditions possibles de formation des planètes lors de
la condensation de la nébuleuse solaire. Les données ont été obtenues expérimentalement en
faisant condenser des minéraux vaporisés dans des conditions de très faibles pressions. En effet, il faut
envisager des pressions très faibles au niveau de la nébuleuse solaire qui gravitait autour du Soleil
naissant dans les premiers temps du système solaire.
On constate que les silicates les plus réfractaires (oxydes, olivine, pyroxènes) condensent
aux températures les plus élevées. Les feldspaths condensent à des températures plus faibles.
Quoi qu’il en soit, les domaines de températures élevées qui devaient caractériser la partie la plus
interne de la nébuleuse solaire ont été favorables à la formation de minéraux silicatés. Cette
observation permet d’envisager l’origine des planètes telluriques proches du Soleil, riches en roches
et à atmosphère peu développée.
À l’inverse, les planètes géantes peuvent également renfermer des silicates (noyaux rocheux
internes), mais seront très riches en gaz. Jupiter et Saturne possèdent des satellites où de la glace
d’eau est présente, malgré une atmosphère plus ou moins dense. Il faut envisager que ces planètes
ne se situent plus dans leurs zones de formation. En effet, leurs orbites ont été modifiées depuis
du fait des interactions gravitationnelles qu’elles exercent les unes sur les autres.
Le diagramme ne permet pas d’expliquer l’origine des épaisses enveloppes gazeuses (plus
ou moins condensées) des planètes géantes. Les gaz légers, à l’origine des atmosphères primitives
des planètes, et provenant de la nébuleuse solaire ont été poussés par le vent solaire vers les
confins du système. Ce phénomène permet également d’expliquer une origine possible des
comètes au niveau du nuage d’Oort situé bien au-delà de la limite des glaces.
Document 4 : Lame mince de péridotite
La roche renferme des olivines (serpentinisées) et des pyroxènes. Comme la
reconnaissance des minéraux au microscope polarisant n’est pas au programme de la classe de
Seconde, il conviendrait que l’enseignant prépare une clé de détermination simplifiée. L’intérêt de
cet échantillon est de faire le lien avec le Document 3 (séquence de condensation de la nébuleuse
solaire). Les élèves savent, depuis la classe de 4ème que le manteau terrestre est constitué de
péridotites, et que le manteau est l’enveloppe la plus volumineuse de la planète Terre. Dès lors,
on peut, en corrélant les données de masses volumiques des différentes planètes telluriques,
envisager que les péridotites sont très vraisemblablement les roches les plus abondantes dans le
système solaire. D’ailleurs, les météorites rocheuses ont très majoritairement une composition
minéralogique analogue.
Conclusions :
L’ensemble des documents du dossier permet de dégager les grandes caractéristiques de la
planète Terre qui présente des similitudes (roches, taille, masse volumique…) avec l’ensemble des
planètes tellurique. En revanche, elle est très différente des planètes géantes (taille, masse
volumique, nombre de satellite). Cependant, la Terre montre d’autres particularités. Tout d’abord,
la composition de son atmosphère qui résulte de l’activité biologique, et ensuite par la présence,
en surface, de l’eau sous ses trois états, une condition nécessaire à la vie. En définitive, notre
planète est un objet particulier dans le système solaire.
1
/
3
100%