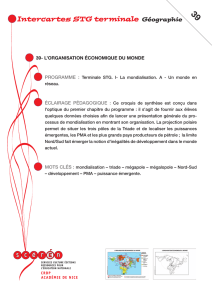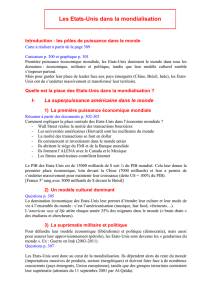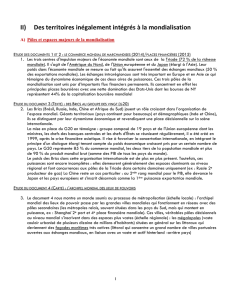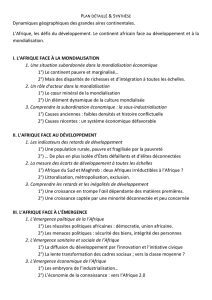F Document 8 page 37 : Quelles sont les principales

2ème partie : Les territoires dans la mondialisation - Pôles et espaces majeurs de la
mondialisation ; territoires et sociétés en marge de la mondialisation
Introduction
Étudier les territoires dans la mondialisation, c’est s’interroger sur leur recomposition résultant de leur inégale intégration aux
réseaux d’échanges. En effet, la mondialisation hiérarchise les lieux à toutes les échelles : elle promeut des « pôles et espaces
majeurs », notamment les villes mondiales, mais laisse aussi des « territoires et des sociétés en marge ». En mettant en relation
les lieux de production et de consommation dispersés sur tout le globe, elle multiplie les transports par mer ce qui renforce
l’importance géostratégique des espaces maritimes (maritimisation de l’économie, littoralisation des territoires).
Problématiques
Quelle typologie des territoires peut-on établir en fonction de leur inégale participation à la mondialisation ? Quelles sont les
caractéristiques des pôles et espaces majeurs de la mondialisation et des territoires restés en marge? Quelles sont les
conséquences socio-spatiales pour les territoires d’une intégration inégale dans la mondialisation ?
I. Mondialisation et recompositions territoriales
1. Une intégration croissante de l’espace mondial
Les réseaux de transport favorisent les connexions entre les différents centres de la mondialisation. Le commerce mondial
s’organise autour de grandes routes qui relient les façades maritimes asiatiques, européennes et américaines. Les aéroports
sont des plaques tournantes majeures pour les flux de marchandises et de passagers. Des points nodaux constituent des
carrefours mondiaux, des hubs.
Les réseaux des FTN contribuent à connecter les villes entre elles et renforcent leur interdépendance. Les villes mondiales
offrent un haut niveau de connectivité grâce à leurs infrastructures et leurs fonctions diversifiées.
Les interactions entre les pôles de la Triade demeurent les plus intenses, mais la connectivité des villes du Sud (Mumbaï)
progresse rapidement grâce leur essor économique.
2. Concurrence et complémentarité des territoires
Des espaces majeurs de la mondialisation ont émergé. Les quartiers d’affaires des grandes villes, les parcs technologiques où se
concentrent les entreprises les plus innovantes, les grandes façades maritimes sont, à des échelles différentes, les centres
d’impulsion de l’économie mondiale, agissant comme des interfaces cruciales et favorisant la littoralisation des activités.
La mondialisation accentue la concurrence entre les territoires. Les territoires urbains bénéficient des stratégies des entreprises
qui s’organisent à l’échelle planétaire. Les villes mondiales offrent des conditions favorables à l’accueil d’investissements
étrangers, d’autres, comme Dubaï, développent des zones franches.
Document 3 page 39 : Quels facteurs ont favorisé l’établissement de zones franches ? Quels sont les atouts de ces zones ?
Quel pays a le plus misé sur ces zones franches ?
La mondialisation créé aussi des complémentarités entre les territoires qui se jouent à l’échelle nationale (au Brésil, Sao Paulo
concentre les fonctions économiques alors que Rio de Janeiro est un pôle culturel) ou bien transnationale (région
transfrontalière comme SARLORLUX en Europe).
3. Une hiérarchisation des territoires
Les espaces majeurs de la mondialisation sont inégalement répartis sur la planète. Les grandes concentrations urbaines de la
Triade concentrent des fonctions stratégiques importantes (mégalopole japonaise, mégalopole européenne et Mégalopolis).
Elles contribuent à renforcer l’organisation centres/périphéries de l’espace mondial.
Les points d’appui de la mondialisation se concentrent dans les pôles de la Triade. C’est vers eux que convergent en masse les
flux de capitaux, d’informations et de marchandises ainsi que les flux migratoires.
Mais l’espace mondial est de plus en plus multipolaire du fait de l’émergence de nouveaux centres comme les BRICS. Leur
développement rapide et leur intégration accélérée au système mondial entraînent des recompositions dans la hiérarchie des
territoires de la mondialisation.
II. Pôles et espaces majeurs de la mondialisation
1. Les pôles de la Triade
L’Amérique du Nord, l’UE et l’Asie orientale sont les centres dominants de l’espace mondial. Ils produisent près de 60% de la
richesse mondiale, réalisent 90% des opérations financières et représentent 75% de l’investissement mondial en recherche-
développement.
Ces pôles sont à l’origine du processus historique de la mondialisation. Berceau du capitalisme marchand et des révolutions
industrielles, ils ont impulsé la révolution des technologies de l’information et de la communication.
La puissance de la Triade repose sur sa capacité à faire émerger des modèles diffusés mondialement, comme le capitalisme, la
démocratie ou les modes de vie.
2. Les BRICS : de nouvelles puissances
Document 8 page 37 : Quelles sont les principales caractéristiques des pays émergents ? Quels sont les facteurs de
l’émergence ? Quelles en sont les conséquences ?

Ces Etats jouent un rôle croissant dans l’organisation de l’espace mondial. Ces géants ne se distinguent plus seulement par leur
superficie et leur poids démographique mais aussi par leur dynamisme économique et leur rôle dans l’économie mondialisée en
prenant une part active à l’accélération des échanges.
Ils demeurent néanmoins des puissances incomplètes. S’ils font concurrence aux pays du Nord dans certains domaines, ils
restent généralement des puissances régionales. Cependant, la Chine s’est hissée au 2ème rang mondial pour le PIB en 2010 et au
1er rang pour les exportations.
Des périphéries intégrées contribuent aussi à recomposer la hiérarchie des l’espace mondial. Le Mexique, la Turquie ou
l’Indonésie ne sont plus confinés dans le rôle de fournisseurs de matières premières ou de main d’œuvre bon marché pour les
pays du Nord. Des groupes industriels mondiaux y ont émergé et des quartiers d’affaires se développent.
3. Les métropoles au cœur de la mondialisation
Document 3 page 35 : Quelle hiérarchie des villes établit cette carte ? Relevez trois exemples dans des aires distinctes pour
chaque catégorie. Comment fonctionne cet ensemble métropolitain ?
Documents 5 page 35 et 2 page 39 : Quels sont les fonctions et les atouts des villes globales ?
Documents 1, 2 et 4 pages 34/35 : Quels sont les facteurs de l’attractivité de New York et Londres ?
La mondialisation est un facteur de métropolisation des territoires. Les métropoles, qui fonctionnent en réseau tout en étant en
compétition les unes avec les autres, polarisent l’essentiel des flux. Elles concentrent les activités tertiaires et les pouvoirs de
décision. Les plus puissantes d’entre elles, les villes mondiales, exercent un rayonnement planétaire et dominent le monde en
termes de créations de richesse.
Ce réseau de métropoles aux commandes de la mondialisation forme l’archipel métropolitain mondial (AMM). Il est constitué
des vastes mégalopoles et de métropoles mondiales reliées entre elles par des interactions permanentes. Ces zones
entretiennent des liens privilégiés avec des métropoles de rang inférieur, comme les métropoles-relais du Sud.
III. Territoires et sociétés en marge de la mondialisation
1. Les contraintes de la distance et de l’enclavement
A l’heure de l’instantanéité, la mondialisation n’annule pas totalement les distances. Pour certains territoires, l’insularité
(Océanie), l’enclavement faute d’accès à la mer (Bolivie) ou d’infrastructures performantes (Yémen) demeurent une entrave à
leur intégration dans l’économie mondialisée.
La marginalisation doit être envisagée à différentes échelles. Les contrastes d’insertion dans la mondialisation se lisent aussi à
l’échelle d’une région, d’une ville ou d’un quartier, y compris dans les pays du Nord. Toutes les grandes métropoles sont
confrontées à des phénomènes de ségrégation socio-spatiale.
Cependant, la distance est de moins en moins une contrainte. En effet, les technologies de l’information et de la communication
permettent d’améliorer la connectivité de territoires isolés, mais l’accès à Internet dépend de leur niveau de développement.
Malgré la dématérialisation des flux, la maîtrise de la distance passe par l’aménagement des territoires : réseaux de fibres
optiques, câbles sous-marins, téléports…
2. Les PMA : exclus de la mondialisation ?
Carte 1 page 39 : Quelles zones ont une insertion faible dans la mondialisation ?
De nombreux pays du Sud sont exclus de la mondialisation. Leur agriculture reste vivrière et leur économie, peu diversifiée,
souffre de la concurrence des pays du Nord. Ainsi, le coton africain n’est pas compétitif face à celui des Etats-Unis, largement
subventionné. Pour les PMA, l’enjeu est avant tout la lutte contre la grande pauvreté. 1,2 milliard d’individus vivent sous le seuil
d’extrême pauvreté (1,25$/jour). Certains PMA sont dotés de richesses importantes (diamants en Sierra Leone, cuivre en
Zambie) mais leur exploitation par des firmes étrangères profite peu à la population locale.
Cette marginalisation favorise les activités illicites et l’émigration. Les cultures destinées au trafic de drogue (Andes, Afghanistan,
Birmanie) représentent un mode illicite d’insertion dans les réseaux de mondialisation. L’émigration apparaît aussi comme une
solution mais le Brain Drain prive les pays du Sud de leur élite. Ainsi, 67% de la main d’œuvre hautement qualifiée du Cap Vert
vit à l’étranger.
3. Les angles morts de la mondialisation
Document 10 page 37 : Quelle évolution de la césure Nord/Sud présente le texte ? Quel constat fait-il de la pauvreté dans le
monde et de la situation de marge ?
Pour des raisons idéologiques, certains Etats restent en marge de la mondialisation des économies, de la culture et de
l’information. Il s’agit le plus souvent de dictatures qui rejettent l’influence occidentale (Zimbabwe, Corée du Nord). Mais
l’attrait des technologies de l’information et de la communication et des modèles culturels mondialisés pousse leur population à
faire pression sur leurs gouvernants pour obtenir davantage d’ouverture (Cuba, Myanmar).
Les pays marqués par l’instabilité politique sont tenus à l’écart des flux mondialisés. Caractérisés comme pays à risques, ils ne
parviennent pas à attirer les investissements et sont évités par les touristes qui redoutent leur insécurité.
La corruption désorganise leur économie et décourage les investissements. Elle explique en partie la difficulté de ces Etats à
rembourser leur dette extérieure. Mais certains dirigeants tirent profit de la mondialisation à des fins personnelles en réclamant
des pots-de-vin aux entreprises contre l’obtention de marchés et en pratiquant l’évasion financière.
1
/
2
100%