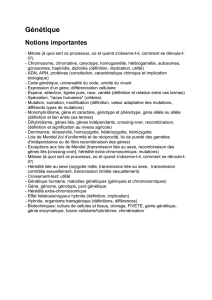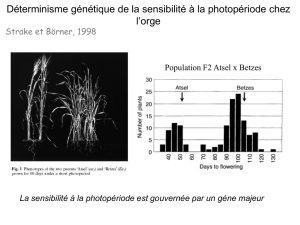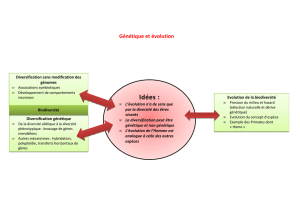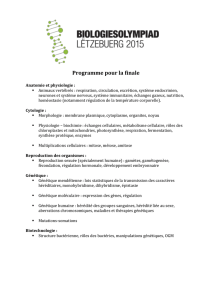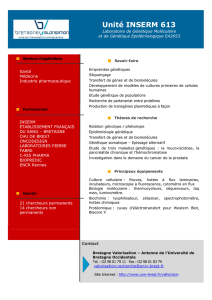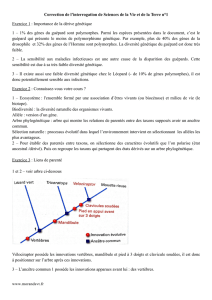Article Bulletin Shesvie

Bull. Hist. Épistém. Sci. Vie, 2008, 15, (1), 15 - 35
La génétique des comportements,
du génomique au post-génomique
Laurence Perbal
*
RESUME
.
Cet article propose une présentation des modèles épistémologiques qui
caractérisent la génétique moderne des comportements depuis 1960 jusqu’à nos jours. Après
un retour critique sur les circonstances historiques, idéologiques et techniques qui ont conduit
au développement de la génétique des comportements en tant que domaine de recherches à
part entière, nous nous intéressons aux premières approches moléculaires de l’hérédité des
comportements développées par Seymour Benzer. Elles sont spécifiques d’un modèle
épistémologique caractéristique des premiers pas de la biologie moléculaire. Des années 1980
aux années 2000, les séquençages des génomes et les études de liaisons entre gène et
comportement se multiplient. Cette période est appelée l’ère génomique. Cet état des lieux des
recherches en génétique des comportements nous mène à la conclusion que le modèle
épistémologique sous-jacent se modifie et s’accompagne d’un retour des concepts et des
approches systémiques du vivant. Depuis le début du nouveau millénaire, la génétique des
comportements évolue dans une nouvelle ère, appelée l’ère post-génomique.
MOTS
-
CLEFS
:
génotype ; phénotype ; eugénisme ; linéarité ; multifonctionnalité ; Benzer ;
Hamer
***
A
BSTRACT
.
This paper provides an overview of the epistemological models that
characterize the modern behavioral genetics since 1960 until today. After a study of the
historical, ideological and technical circumstances that led to the development of behavioral
genetics as an autonomous field of research, we explain the development of the first
molecular approaches of behaviors’ heredity by Seymour Benzer. They are typical of an
epistemological model representative of the first steps of molecular biology. From 1980 to
2000, the sequencings of genomes and linkage studies became more numerous. This period is
called the genomic era. This overview of researches in behavioral genetics leads us to the
conclusion that the underlying epistemological model is changing and is accompanied by a
return of systemic concepts and approaches of living beings. Since the beginning of the new
millennium, the behavioral genetics evolves into a new era, the postgenomic era.
K
EYWORDS
:
genotype; phenotype; eugenics; linearity; multifunctionality; Benzer; Hamer
***
I
NTRODUCTION
La génétique des comportements est un domaine de recherches qui a été guidé par deux
modèles épistémologiques principaux depuis 1960. Pour commencer, nous nous intéresserons
*
Perbal Laurence, aspirante F.N.R.S., philosophie des sciences. Université libre de Bruxelles, CP175/01, av. F.D. Roosevelt
50, 1050 Bruxelles, Belgique.

aux circonstances théoriques, idéologiques et techniques qui ont conduit au développement de
la génétique des comportements en tant que discipline spécifique et autonome. En effet, une
analyse complète de ces modèles ne peut faire l’économie d’un retour critique sur l’histoire de
ce domaine de recherches. Dans un deuxième temps, nous caractériserons le premier modèle
épistémologique qui la guide dans ses débuts et ce, grâce à l’analyse des travaux de Seymour
Benzer qui est l’un des premiers à avoir développé les approches moléculaires dans l’étude de
l’hérédité des comportements. Nous montrerons que ce premier modèle est caractéristique de
ce qui est appelé l’ère génomique de la biologie. Par la suite, nous analyserons les résultats
obtenus sur l’hérédité de l’homosexualité car ils nous semblent représentatifs de la plupart des
recherches qui ont été faites sur l’hérédité des traits complexes depuis les années 1980. Ces
résultats sont pour la plupart inconsistants et cette inconsistance a été interprétée par nombre
de chercheurs comme le fruit d’une faiblesse théorique inhérente aux modèles explicatifs
utilisés en génétique des comportements. Nous verrons que des chercheurs très importants
dans ce domaine, tels que Dean Hamer, Robert Plomin ou Pierre Roubertoux, soulignent la
nécessité de faire évoluer les approches théoriques et expérimentales. Sur base de leurs
propositions, nous pourrons caractériser le nouveau modèle épistémologique émergent. Ce
dernier rend lui-même même compte d’une évolution plus globale dans les approches du
vivant développées en biologie au sein d’une nouvelle ère qui a débuté en même temps que ce
nouveau millénaire et qui est appelée, l’ère post-génomique.

P
ERSPECTIVE HISTORIQUE
Eugénisme
Les premières approches dans l’étude des déterminants héréditaires des patterns
comportementaux sont à mettre à l’actif de Sir Francis Galton (1822-1911). Il est un homme
de sciences anglais, élevé dans une famille d’intellectuels fortunés dont un autre membre
marquera l’histoire de la biologie, son cousin, Charles Darwin (1809-1882). Ce dernier
publie, en 1859, The Origin of Species by Means of Natural Selection dont la théorie de
l’évolution au moyen de la sélection naturelle représente les racines théoriques de toute la
biologie. Francis Galton s’est attaché à identifier la part d’hérédité dans les caractéristiques
humaines car il est en effet persuadé que les facteurs héréditaires jouent un rôle non
négligeable dans la détermination des différences individuelles. Il a donc mis en place des
méthodologies de recherches qui sont toujours utilisées à l’heure actuelle, notamment l’étude
des familles et de leur arbre généalogique. Cette dernière est l’une des méthodologies
expérimentales principales de la génétique quantitative classique impliquant l’humain et
Francis Galton l’a utilisée pour étudier l’hérédité de « l’intelligence ». Les résultats obtenus,
suggérant fortement le caractère inné de l’intelligence, ont été décrits dans son ouvrage de
1869, Hereditary Genius, qui est considéré comme le premier essai d’une analyse quantitative
des capacités intellectuelles de l’humain.
La certitude qui anime Francis Galton au sujet de l’aspect biologiquement héréditaire de
nombreuses caractéristiques humaines, le conduit à développer le concept d’eugénique en
1883 (eugenics)
1
. Brièvement, l’eugénique peut être considéré comme le bras armé du
darwinisme social qui défend une approche finaliste du processus d’évolution en tant qu’il
contribue à l’amélioration de l’espèce humaine. Il s’agit de la science qui étudie et met en
œuvre les moyens d’améliorer l’espèce humaine en cherchant soit à favoriser l’apparition de
certains caractères (eugénique positive) soit à éliminer les maladies héréditaires (eugénique
négative). La science est ainsi mise au service de l’idéologie de perfectibilité de l’humain.
Francis Galton recommande l’application compensatoire d’une sélection artificielle pour
lutter contre la dégénérescence issue, selon lui, de l’affaiblissement du rôle de la sélection
naturelle en milieu civilisationnel. Il a été le fondateur et le premier président de l’Eugenics
Society au début du 20
ème
siècle. Par la suite, l’idéologie eugéniste prend une dimension plus
politique. La peur d’une dégénérescence liée à une volonté de perfectibilité de l’humain a
conduit de nombreux États à faire de la reproduction une politique d’État : les individus
considérés comme « supérieurs » sont encouragés à la reproduction tandis que ceux
considérés comme « inférieurs » en sont empêchés.
2
Ainsi, l’eugénisme est le cadre idéologique dans lequel baignent les premiers pas de la
génétique des comportements et les principales études sur le sujet sont publiées au début du
siècle dans des revues de psychologie, telle que le Journal Comparative Psychology ou le
Journal Heredity, ou dans des revues liées au mouvement eugéniste, tel que l’Annual
Eugenics. Il faut attendre 1970 et la formation de la Behavior Genetics Association située à
l’Institut de Génétique à Boulder au Colorado pour voir édité le premier journal véritablement
et strictement consacré à l’étude génétique des traits complexes, Behavior Genetics. La
1
Le terme eugenics peut se traduire par eugénisme ou eugénique. C’est Georges Vacher de Lapouge, admirateur français de
Galton, qui a introduit le terme eugénique en 1886 et celui d’eugénisme en 1888.En français, le premier désigne plutôt une
science et le second un projet sociopolitique. Par contre, la distinction entre eugénisme et eugénique n’existe pas en anglais.
Pour plus de détails voir Gayon Jean, Le mot « eugénisme » est-il encore d’actualité ? dans Gayon Jean et Jacobi Daniel
(eds.), L’Eternel Retour de l’Eugénisme, PUF, Paris, 2006, p.119-142.
2
Pour plus d’informations voir Kevles Daniel, In the Name of Eugenics : Genetics and the Uses of Human Heredity, Harvard
University Press, Cambridge, 1995.

formation de cette société marque les débuts de la génétique des comportements dans sa
dimension moderne et actuelle.
3
Elle est un peu l’aboutissement de plusieurs événements
majeurs qui en ont fait un domaine de recherches reconnu et certains d’entre eux mettent en
lumière l’étroitesse des liens existant entre la génétique des comportements et l’idéologie
eugéniste.
Premièrement, en 1960, John Fuller et Robert Thompson publient le premier ouvrage sur
ce sujet, Behavior Genetics
4
. Cette publication a une importance historique non négligeable
car elle a contribué à la diffusion des concepts et des méthodes qui caractérisent la génétique
des comportements en tant que discipline scientifique spécifique.
5
Ensuite, grâce aux sponsors
de l’American Eugenics Society, les Princeton workshop conférences, qui s’intéressent
notamment à la validité psychométrique des mesures de QI, ont été organisées tout au long
des années 1960. Lors de l’une de ces conférences, le généticien Theodosius Dobzhansky
suggère la formation d’une association de Génétique des comportements. Les quatre années
qui suivirent verront naître progressivement la Behavior Genetics Association et ce, grâce au
soutien financier d’un certain Frederick Osborn. Il s’agit d’un des leaders les plus importants
du mouvement eugéniste américain, président de l’American Eugenics Society après la guerre
de 1946 à 1952.
6
Les liens historiques et financiers qui associent la génétique des comportements au
mouvement eugéniste reposent sur une dépendance théorique importante. La pensée eugéniste
se nourrit d’un déterminisme génétique dans lequel les gènes sont supposés avoir un rôle
causal prépondérant dans le développement des phénotypes. Le rapport causal entre le
génotype et le phénotype est perçu comme linéaire. Dans ce cadre, une action sélective
(positive ou négative) ciblée sur certains traits phénotypiques engendre une modification
progressive des caractéristiques génotypiques de la population et par voie de conséquence,
une plus grande fréquence relative des phénotypes recherchés (intelligence, santé, beauté, …)
puisque les gènes sélectionnés sont censés en être la cause principale. Notons cependant que
la dépendance théorique est unidirectionnelle car si la possibilité théorique d’une sélection
amélioratrice dépend d’une certaine façon des résultats obtenus en génétique des
comportements, la réciproque n’est pas vraie.
Génétique formelle
Le postulat de linéarité relationnelle entre le génotype et le phénotype trouve son origine
dans les propositions théoriques de la génétique formelle du début du 20
ème
siècle car cette
dernière a mis en place une culture épistémologique
7
qui s’intéresse essentiellement à
l’hérédité différentielle.
8
En effet, Thomas Morgan (1866-1945)
explique dans son ouvrage
The Theory of the Gene, publié en 1926, qu’un gène peut avoir plusieurs formes, appelées
allèles : une forme « normale » (« sauvage ») et plusieurs formes mutées par exemple. L’un
des cas d’étude les plus célèbres dans les travaux de Thomas Morgan sur la drosophile, ou
mouche du vinaigre (Drosophila melanogatser), concerne l’œil qui peut être « blanc »,
« rouge » ou « éosine ». Il a pu mettre en évidence que les mutations liées à ces trois traits se
3
DeFries J.C. and Fulker D.W., 1986. Multivariate Behavioral Genetics and Development: An Overview, Behavior Genetics,
16, 1:1-10.
4
Fuller L. John and Thompson W. Robert, Behavior Genetics, John Wiley& Sons, New York, 1960.
5
Schaffner Kenneth, Behavioral and Psychiatric Genetics: Learning from History, Communication donnée dans le cadre du
Symposium: Interpreting Complexity, Standford University, 6 juin 2006.
http://cirge.stanford.edu/behavioral_genetics_2006/schaffner_all.html
6
Garland Allen E., 1997. The Social and Economic Origins of Genetic Determinism : A Case History of American Eugenics
Movement, 1900-1940 and its Lessons for Today, Genetica, 99: 77-88.
7
Fox Keller Evelyn, Expliquer la Vie : Modèles, Métaphores et Machines en Biologie du Développement, Gallimard, Paris,
2004.
8
Pichot André. Histoire de la Notion de Gène, Flammarion, Paris, 1999.

situent au même endroit sur le chromosome. Ainsi, le gène « couleur de l’œil » possède trois
allèles qui occupent le même locus. Il s’agit d’une approche fonctionnaliste et mutationniste
du gène puisqu’aucune hypothèse n’est faite sur la nature du gène, ni sur son mode de
fonctionnement. En attendant les réponses qu’apportera la biologie moléculaire au début du
20
ème
siècle, les travaux de Thomas Morgan doivent donc se contenter d’une approche
phénoménale des gènes, c’est-à-dire de l’étude fréquentielle des caractères mutés. La
démarche des généticiens en génétique formelle ne part donc pas de la cause supposée, le
génotype, pour aller vers l’effet supposé, le phénotype, mais elle fait le chemin inverse.
9
André Pichot explique que l’hérédité étudiée par Thomas Morgan est une hérédité
différentielle puisqu’il s’agit d’observer les caractères définis uniquement par leurs variations
possibles. Ce n’est pas l’hérédité du caractère « couleur de l’œil » qui est étudiée mais sa
modification par mutation.
Or l’hérédité de la mutation n’est pas forcément représentative de
l’hérédité du caractère susceptible de muter, laquelle implique en général un très grand
nombre de facteurs différents. Cette appréhension des gènes à partir d’un de leurs effets
cristallise l’attention sur cet effet et participe de l’appréhension linéaire du rapport entre le
phénotype et le génotype.
L’approche différentielle de l’hérédité marque encore aujourd’hui
les modèles explicatifs de la génétique moderne des comportements et ce, malgré le fait que la
biologie moléculaire explicite la nature ADN des gènes dès 1944,
10
remettant ainsi en
question la nécessité des approches fonctionnalistes et mutationnistes.
Selon nous, cette persistance des approches différentielles de l’hérédité est sans doute liée
à celle du fantasme de linéarité de la génétique. Ce fantasme accompagne les débuts de la
génétique formelle mais il s’est véritablement amplifié lors du développement fulgurant de la
biologie moléculaire qui est basé sur quelques découvertes importantes entre 1940 et 1965.
11
En effet, George Beadle et Edward Tatum montrent en 1940 la relation qui existe entre les
gènes et les protéines. En 1944, Oswald Avery découvre que les gènes sont constitués
d’ADN. Jim Watson et Francis Crick proposent en 1953, la structure en double hélice de la
molécule d’ADN et c’est vers 1960 que Jacques Monod et François Jacob fournissent un
modèle explicatif, le modèle de l’opéron, pour la régulation de l’expression des gènes via des
protéines régulatrices. L’univers conceptuel de la biologie moléculaire est peuplé
d’informations, de programmes, de codes et de signaux. Michel Morange la décrit comme une
nouvelle manière de percevoir le vivant en termes de réservoir et de transmetteur
d’informations.
12
Avec la découverte de la molécule d’ADN et du code génétique (presque) universel, les
biologistes ont réalisé que derrière la diversité extraordinaire du vivant se trouve une identité
moléculaire peut-être encore plus extraordinaire. Cette prise de conscience a véritablement
bouleversé les modes d’appréhension des organismes vivants car elle a notamment focalisé
l’attention des chercheurs sur l’invariant biologique fondamental,
13
l’ADN. De plus, grâce
aux nouvelles techniques expérimentales de la biologie moléculaire, l’identification des unités
d’hérédité censées perpétuer cette identité, c’est-à-dire les gènes, est désormais possible. De
même, l’apparition simultanée en 1961 du concept de programme génétique dans les articles
d’Ernst Mayr
14
, d’une part, et de Jacques Monod et François Jacob
15
, d’autre part, est un
événement important. L’hérédité est désormais perçue comme la transmission d’un
9
Ibid., p.140.
10
Avery, O.T., McLeod, C.M. et McCarthy M., 1944. Induction of transformation by a desoxyribonucleic acid fraction
isolated from Pneumococcus Type III, J. Exp. Med., 79:137-158.
11
Morange Michel, Histoire de la Biologie Moléculaire, La Découverte, Paris, 1994.
12
Ibid., p. 6.
13
Monod Jacques, Le Hasard et la Nécessité, Essai sur la Philosophie Naturelle de la Biologie Moderne, éditions du Seuil,
1970, p. 140.
14
Mayr Ernst, 1961. Cause and Effect in Biology, Science, 134, 3489: 1501-1506.
15
Jacob F. et Monod J., 1961. Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. J. Molec. Biol., 3: 318-356.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%