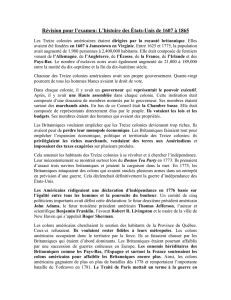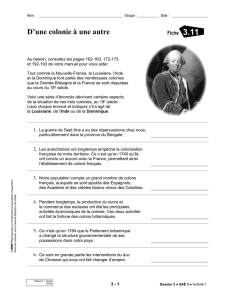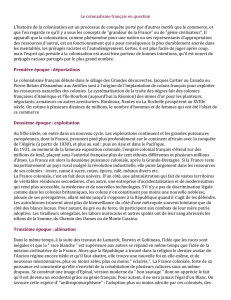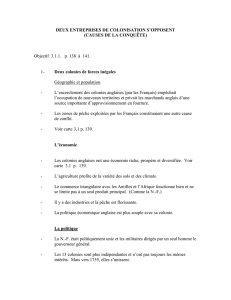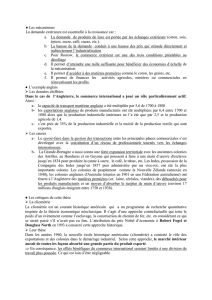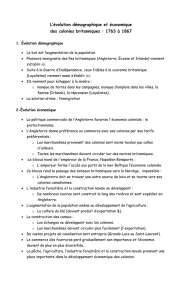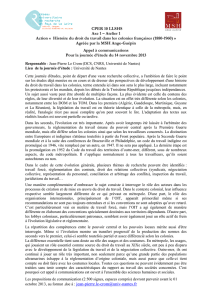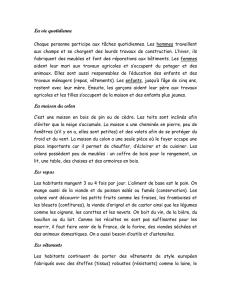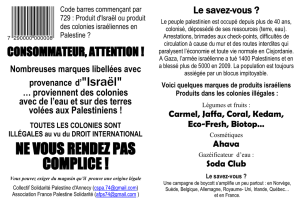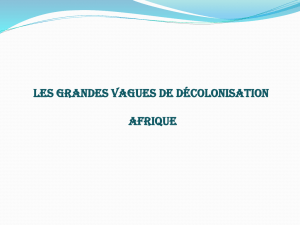Un double système politique



Table des matières
Avant-propos
Introduction Une nouvelle puissance est née (1776-1815)
La diversité coloniale
Une grande diversité géographique
La population
Une économie florissante
Un double système politique
Qu’est-ce qu’un Américain ?
Malentendus transatlantiques
Les colons et la guerre de Sept Ans
Vers la rupture
La solution de force
Le risque de l’indépendance
Hostilité et indifférence
La première organisation de l’indépendance
Une indépendance très fragile
Une véritable guerre qui s’internationalise
Le traité de Paris
Une révolution quand même
Les transformations sociales
Un nouveau régime économique
Une ébauche institutionnelle

La Constitution de 1787
La ratification, État par État
Le rodage de la jeune république
La mise en place des institutions
Les limites du consensus fédéraliste
La première alternance survient en 1801
Le poids des événements européens
Une guerre oubliée : 1812-1815
Les chemins de l’expansion
PREMIÈRE PARTIE
L’ACCESSION AU PREMIER RANG 1816-1920
Chapitre 1 Un équilibre de plus en plus précaire (1816-1860)
De la démocratie en Amérique
Vers l’hégémonie démocrate
Jackson ou le renouveau ?
Une politique brutale
Une démocratie à l’américaine
L’affirmation nationale
La religion nationale
Montrer sa force
La conquête de l’Ouest
Un développement contrasté
Un essor économique diversifié
L’écart grandissant entre deux sociétés
Urbanisation et immigration au Nord
Un système esclavagiste en pleine forme au Sud
Les chemins du divorce
Une implacable lutte idéologique

Le compromis impossible : 1820-1852
La faille, 1854-1859
L’élection de 1860 : le tournant
Chapitre 2 Une guerre civile (1861-1865)
Une guerre annoncée, mais mal préparée
Une guerre nécessaire ?
Quels buts et quels moyens pour la guerre ?
Du pouvoir et des hommes
Lincoln
Quatre ans de lutte
Les soldats et leurs chefs
L’illusion d’une guerre courte, 1861-1863
Vers la guerre totale, 1863-1865
Quelles leçons militaires ?
Un premier bilan de la guerre
L’émancipation des esclaves
Une victoire de la puissance économique
Une grande puissance ?
Chapitre 3 La Reconstruction (1865-1877)
La Reconstruction politique
Le legs de Lincoln
La mainmise des radicaux sur le pouvoir
La Reconstruction radicale
Dans le Sud : espoirs des Noirs, résistance des Blancs
Une région désorganisée
L’organisation de la résistance blanche
Une coalition fragile
Les Noirs au pouvoir ?
La fin de la Reconstruction
La violence grandissante
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%