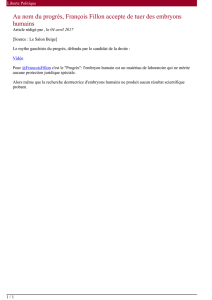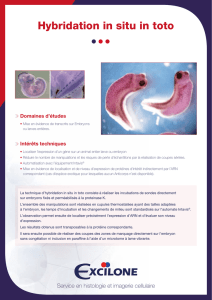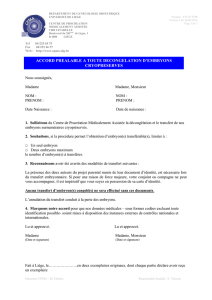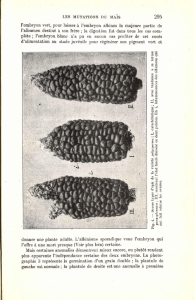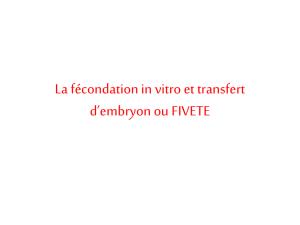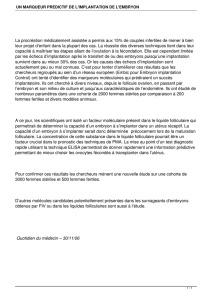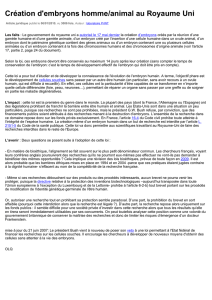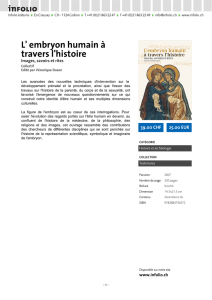L`embryon surnuméraire

L'embryon surnuméraire

Ethique médicale
Collection dirigée par Richard Moreau et Roger Teyssou
La collection
Les Acteurs de la Science,
prévue pour recevoir des
études sur l'épopée scientifique moderne, se dédouble pour accueillir
des ouvrages consacrés spécifiquement aux questions fondamentales
que la santé pose actuellement. Cette nouvelle série cherche à faire le
point objectivement et en dehors des modes sur des connaissances, des
hypothèses et des enjeux souvent essentiels pour la vie de l'homme.
Elle reprend certains titres publiés auparavant dans
Acteurs de la
science.
Déjà parus
Philippe RAUX-DOUMAX,
Hôpitaux, cliniques, quel futur ?,
2004.
Pierre SCHULLER,
La face cachée d'une vocation. Lettres à
un futur médecin.
Préface de Bernard Lebeau.
Elie BERNARD-WEIL,
Stratégies paradoxales et Sciences
humaines.
Philippe CASPAR (Sous la direction de),
Maladies
sexuellement transmissibles. Sexualité et institutions.
Maria KANGELARI,
Toxicomanie, sciences du langage, une
approche clinique.
Jean-Claude BOUAL et Philippe BRACHET (Sous la direction
de),
Service public et Principe de précaution.
Philippe BRACHET (Sous la direction de),
Santé et Principe de
précaution.
Denis
-
Clair LAMBERT,
La santé, clé du développement.
Europe de l'Est et Tiers-Mondes.

Emmanuelle DHONTE-ISNARD
L'embryon
surnuméraire
L'Harmattan
L'Harmattan Hongrie
L'Harmattan Italia
5-7, rue de l'École-
Hargita u. 3
Via Degli Artisti, 15
Polytechnique
1026 Budapest
10124 Torino
75005 Paris
HONGRIE
ITALIE
FRANCE

© L'Harmattan, 2004
ISBN : 2-7475-6423-1
EAN : 9782747564236

Sous le titre " L'embiyon
in vitro
et le droit. Approche
comparative ", l'ouvrage rédigé par Emmanuelle Dhonte-Isnard
est en fait la version épurée de sa thèse, si remarquable qu'elle
lui
a valu non
seulement là plus élevée
des mentions mais
aussi
l'habilitation à la maîtrise de conférence dès la première réunion
du Conseil national des universités.
La gageure était de taille : la recherche entreprise avait pour
ambition d'aider à l'élaboration de règles normatives, et se
situait d'emblée dans un domaine à la frontière de plusieurs
disciplines (Droit essentiellement, mais aussi Médecine,
Biologie, Philosophie). Elle portait sur l'embryon
in vitro,
l'embryon, ce " non-sujet de droit ", selon le doyen Carbonnier,
pour qui l'on n'aurait pas eu l'idée de traiter l'embryon en non
sujet de droit s'il n'avait d'abord été escompté comme
l'espérance d'un sujet ". Or aujourd'hui, depuis que la
conception peut être réalisée en laboratoire, l'embryon n'est pas
toujours cette personne potentielle, selon le Comité consultatif
national d'éthique, ce possible qui tend à l'existence, selon les
philosophes, cette personne future, cet enfant à naître qui est,
sous condition d'arriver à l'existence, tenu pour déjà né,
(pro
nato habetur)
selon les juristes.
En effet, la vocation de l'embryon
in vivo à
devenir sujet de droit
n'est empêchée que par une interruption de grossesse, volontaire
ou non ; pour l'embryon
in vitro,
il n'y a
pas forcément de projet
d'accession à la vie : tout dépendra de la volonté des hommes, de
ses parents et du législateur. C'est alors que va se poser, plus
difficile encore que celle de la nature ou du statut de l'embryon,
une nouvelle question, celle de son utilisation. Car la possibilité
d'obtenir des embryons in vitro
ouvre des perspectives sur le
diagnostic préimplantatoire, sur la thérapie génique (ou du
moins, pour l'instant, comme le dit avec réalisme Emmanuelle
Dhonte-Isnard, de l'élimination des défectueux), sur la recherche
7
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%