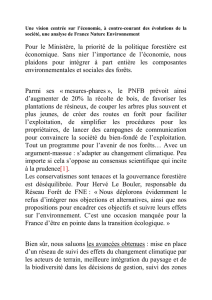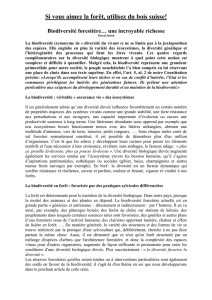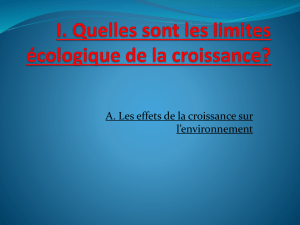relations entre biodiversité et exploitation forestière

159
Rev.For.Fr.L- 2-1998
RELATIONS ENTRE BIODIVERSITÉ
ET EXPLOITATION FORESTIÈRE :
BASES POUR UNE MÉTHODE D’ANALYSE
M.DECONCHAT -G.BALENT -S.VIÉBAN
FrançoiseLAUGA-REYREL
EXPLOITATION FORESTIÈRE ET ENVIRONNEMENT
La sylviculturedelamajoritédes forêts françaises consisteen une gestion àmoyen ou long terme,
de l’ordredeplusieurs décennies.L’exploitation des produits de cette sylvicultureconstitue une
phaseincontournable où l’action de l’homme sur laforêt est plus fortequ’àd’autres périodes.
Toutes les parcelles forestières gérées sont concernées par l’exploitation qui touche plusieurs
dizaines de milliers d’hectares par an. Ses caractéristiques (saison,intensité,matériel utilisé,etc.)
influencent fortement les capacités de laforêt àassurer les fonctions économiques,écologiques et
sociales quilui sont généralement assignées.Réciproquement,la sylvicultureet les conditions
technico-économiques déterminent en partie les modes d’exploitation possibles.
D’unpoint de vueéconomique,les caractéristiques de l’exploitation forestièreinfluent sur les
revenus qu’unpropriétairepeut tirer de saforêt.Mais cette récolteest aussi unacte sylvicole qui
modifie les possibilités de lagestion ultérieuredu boisement (Rotaru,1984).
D’unpoint de vueécologique,on assimile généralement l’exploitation à une perturbation naturelle
du système écologique, sans quele terme perturbation ait ici un sens négatif. C’est une modifica-
tion brutale et temporairedes conditions du milieu qui tend ensuiteà retrouver unnouvel état
d’équilibredynamique,plus ou moins proche de son état initial(Pickett,Kolasaet al.,1989).
Du point de vue social,pour le grand publicde plus en plus citadin et sensibiliséaux enjeux envi-
ronnementaux,l’exploitation forestièreapparaît souvent comme une atteintegrave, voireirréversible,
àcequ’il considèrecomme étant undes milieux les plus naturels.Les attentes environnementales
concernant laforêt secristallisent souvent sur cettephaseparticulièrement visible et intensedel’ac-
tion humaine sur laforêt.
La gestion àlong terme des forêts nécessitedoncde mieux cerner quels sont les effets des diffé-
rents types d’exploitations forestières.Denombreux travaux portent sur les aspects économiques,
en particulier ceux de l’AFOCEL-ARMEF (Cuchet,1995),ou sur les aspects liés àlaperception et

l’accueil du public(Moreau,1993;Brunson et Reiter,1996). Sicertains aspects écologiques sont
étudiés,comme les effets sur la régénération ou sur la structuredu sol (Moreau,1993),peu de
travaux portent directement et explicitement sur les effets de l’exploitation sur labiodiversité,prise
dans un sens plus large quela richesseenessences forestières ou lanaturedes espèces végétales
concurrentes.
Pourtant,labiodiversitéest au cœur de nombreuses et intenses discussions nationales et interna-
tionales (écocertification des forêts,conventions internationales sur laconservation de ladiversité
biologique,labellisation d’entreprise),qui vont sans doutefortement orienter lagestion forestière
(Larsen,1994 ; Bailly et Sturm,1995 ; Brédif,1995 ; Rosendal,1995).
Les entreprises forestières du groupe La Rochette,laSEBSO (1),laSOFOEST (2)et le Comptoir des
Bois(3), sont des acteurs importants de l’exploitation forestièreenFrance(4).Elles sont donc très
directement concernées par ces orientations environnementales et leurs influences sur leur activité
d’exploitation.
Sous lapression des exigences environnementales de la société, tant au niveau localqu’au niveau
international,les Forestières La Rochetteont pris consciencequ’il leur était nécessaired’élaborer
une politique visant àmieux prendreencomptel’environnement.Cettedémarche s’est traduitepar
l’élaboration en 1994 d’unPlanEnvironnement d’Entreprise(PEE)quidétermine les objectifs et les
moyens de ces progrès (Forestières La Rochette,1994).
La biodiversitéest bien évidemment inclusedans ceplan. Mais il a vitefallu se rendreàl’évidence
que,dans cedomaine,les connaissances manquaient.Unprojet de recherche visant àfournir des
résultats utilisables par les Forestières La Rochettepour améliorer leurs pratiques d’exploitation vis-
à-vis de labiodiversitéaétéélaboréencollaboration avecl’INRA.Ce travail fait l’objet d’une thèse,
débutée en août 1995,dont ladémarche générale est présentée ci-après,car elle nous semble sus-
ceptible d’intéresser d’autres acteurs de lafilièreforestièreet de susciter des discussions àpartir
des choix méthodologiques et des hypothèses de travail retenues.
EXPLOITATION FORESTIÈRE ET BIODIVERSITÉ :DÉMARCHE D’ÉTUDE
L’objectif du travail est de proposer des modifications des pratiquesd’exploitation forestièrede
l’entrepriseafin queleurs effets sur labiodiversitésoient conformes àdes objectifs environne-
mentaux.Notredémarche consistedans unpremier temps àdistinguer trois parties dans cet
énoncé:labiodiversité,les objectifs environnementaux et les pratiques d’exploitation (figure1,
p. 161).
Ces distinctions constituent unélément clef de ladémarche sur lequel il faut insister.Onconsidère
qu’il y a(1) des mécanismes écologiques (biodiversité) quipeuvent êtrecompris et modélisés avec
objectivité. Il y ad’autrepart (2)les “fonctions”attribuées àlaforêt associées àdes valeurs portées
par des groupes sociaux et déterminées àlafois par les connaissances scientifiques,mais aussipar
leurs représentations de lanature(Barthod,1996;Lélé et Norgaard,1996).Enfin,les pratiques(3)
permettent d’intervenir sur certains aspects du fonctionnement écologiquedu milieu pour atteindre
unobjectif donné. Une analyseparticulièredeces parties nous apparaît comme une condition du
succès de lapolitiqueenvironnementale de l’entrepriseou celle de tout autreorganisme.
M.DECONCHAT -G.BALENT -S.VIÉBAN -FrançoiseLAUGA-REYREL
160
(1) Sociétéd’Exploitation des Bois du Sud-Ouest approvisionnant l’usine de pâteàpapier PyrénéCell àSaint-Gaudens(Haute-
Garonne).
(2)Sociétéforestièredel’Est approvisionnant l’usine de pâteàpapier Cellurhône àTarascon (Bouches-du-Rhône).
(3)Approvisionne l’usine de carton La RochetteVénizel (Aisne).
(4) Les Forestières La Rochetteachètent 3millions de tonnes/an, soit 10%du bois commercialiséenFrance.

La biodiversité:modélisation écologiquedes effets de l’exploitation
•Zone d’étude
La zone d’étude est limitée aux coteaux du sud-ouest de Toulouse. Ils sont couverts d’une forêt très
morcelée,principalement paysanne ou étroitement imbriquée avecl’agriculture. La structuredomi-
nanteest le taillis-sous-futaie ; néanmoins,on y observe une très grande diversitéde structureet
de gestion. Les Chênes et le Châtaignier dominent,le Charme et le Hêtre sont aussiprésents ; il y
a souvent unmélange de plusieurs essences (Bois,1995 ; Guyon et al.,1996).
Le type d’exploitation principalest lacoupe de taillis-sous-futaie,avecmaintien d’arbres de futaie
en réserveou balivage de jeunes brins;lacoupe raseest aussipratiquée pour les boisements ayant
unfaible potentiel sylvicole. Lemilieu conditionne souvent le mode d’exploitation possible, selon la
naturedu boisement, sa valeur, son accessibilitéet l’avenir qu’on peut luienvisager.Ces exploita-
tions correspondent à une intervention brèveet intense sur le milieu; elles sont parfois la seule
action sylvicole notable.
Nous avons choisicette zone en raison des travaux scientifiques sur labiodiversité réalisés par l’INRA
(Balent et Courtiade,1992;Icaran,1995) et quifournissent une basedeconnaissanceessentielle
pour notre travail de recherche. Le
caractèremixtedecetteforêt,imbri-
quée avecdes territoires agricoles,
constitue une autre spécificitéàpren-
dreencomptedans les discussions
sur les critères environnementaux,
vis-à-vis de régions ou de pays plus
forestiers.Ces caractéristiques par-
ticulières,la zone biogéographique
etles méthodes d’analysedifféren-
cient ce travail d’autres études,appa-
remment similaires,quiportaient sur
des forêts souvent plus grandes et
ayant une vocation sylvicole plus
marquée,avecd’autres méthodes et
d’autres objectifs (Frochot,1975;
Ferry et Frochot,1990; Bersier et
Meyer,1994 ; Muller,1994). Enoutre,
il n’y apas d’enjeu environnemental
fort sur cette zone,comme c’est le
cas sur lachaîne pyrénéenne proche,
et quiaurait pu interférer de façon
Techniqueet forêt
161
Rev.For.Fr.L- 2-1998
OBJECTIFS
F
m3
POUR ATTEINDRE
DES OBJECTIFS
ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX
ON AGIT SUR
LES PROCESSUS
ÉCOLOGIQUES
PARLES PRATIQUES
SYLVICOLES ET D’EXPLOITATION
MARTELAGE
ABATTAGE
DÉBARDAGE
Figure1
POUR UNE ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DES EFFETS
DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE
SUR LA BIODIVERSITÉ,
nous proposons de distinguer
3 composantes:
les objectifs,
les processus écologiques
et les pratiques d’exploitation

conflictuelle avecnos recherches.Enfin,cette zone est unbassin d’approvisionnement important de
laSEBSO pour l’usine de pâteàpapier de Saint-Gaudens touteproche.
•Méthode
La biodiversitéd’un sitepeut s’évaluer au niveau génétiqued’une population,au niveau spécifique
d’une communautéou au niveau “écosystémique” d’unpaysage (appelé parfois écocomplexe). On
peut en considérer des aspects de composition (nombredes espèces par exemple),de structure
(stratification) ou de fonction (multiplicitédes voies métaboliques)(Franklin,1988).
Les effets de l’exploitation forestière sur labiodiversitédoivent êtreévalués dans le temps,en rela-
tion avecladynamiquede reconstitution du couvert forestier.Selon l’intensité,lafréquenceet l’am-
plitude de laperturbation causée par l’exploitation,le milieu perturbé va retrouver,après un temps
de résilience, unétat plus ou moins proche de son état initial(Balent,1994). Une coupe peut avoir
uneffet drastiquequelques années mais ne pas hypothéquer la reconstitution du milieu initialaprès
quelques décennies.
Comme il n’est pas possible de suivrel’évolution d’une coupe sur le temps nécessaireàla recons-
titution du couvert forestier (approche diachronique),nous avons utilisé une approche synchronique.
Elle consisteàcomparer entreelles des placettes dont l’âge,c’est-à-direle temps écoulé depuis la
dernièreexploitation,est suffisamment varié pour reconstituer une série chronologique.
•Échantillonnage
L’échantillon de baseest constituédeplacettes circulaires de 400 m2formant la série chronologique
de reconstitution du couvert après l’exploitation,dans des situations diverses.La placettecorres-
pond à une échelle d’étude assez fine quipermet une analysedes effets des principaux facteurs
associés au chantier d’exploitation. Cependant,d’autres analyses,quine sont pas présentées ici,
porteront sur une échelle plus large permettant d’évaluer les effets de lamosaïquedes coupes sur
labiodiversitéd’unbois dans son ensemble mais aussi sur une échelle plus fine pour voir en quoi
les techniques d’exploitation augmentent ladiversitéintra-placetteet quelles en sont les consé-
quences.
L’âge des placettes varie de 1an(des coupes de l’année) àplus de 50ans,c’est-à-diredes par-
celles qui seront exploitées dans les années à venir.Elles ont étéchoisies dans des grands massifs
forestiers et dans des petits bosquets typiques de la zone d’étude. Les placettes font partie de par-
celles dont la taille varie de moins d’unhectareàplusieurs dizaines d’hectares.Afin d’obtenir une
variabilitéplus grande des facteurs,nous n’avons pas sélectionné uniquement des coupes de la
SEBSO.
•Traitement des données
La modélisation seferapar lacomparaison des observations de biodiversitédes placettes,en rela-
tion avecles facteurs quipeuvent l’influencer.Ces facteurs sont liés àl’exploitation,mais aussiaux
caractéristiques de milieu de laplacetteou à son contexte. Des analyses multifactorielles,du type
AnalyseFactorielle des Correspondances avecVariables Instrumentales (AFCVI), seront utilisées à
cettefin (Prodon et Lebreton,1994).
•Indicateurs de biodiversité
L’utilisation de plusieurs groupes spécifiques pour évaluer labiodiversitéparaît utile pour prendre
en compte ses aspects structurels et fonctionnels (Huston,1994). Chaquegroupe réagit àdes fac-
teurs quilui sont propres,àdes échelles d’espaceet de temps particulières.Les groupes d’espèces
interagissent ensemble et établissent ladimension structurelle de labiodiversité; celaest parti-
M.DECONCHAT -G.BALENT -S.VIÉBAN -FrançoiseLAUGA-REYREL
162

culièrement vrai sil’on considèreles relations entreles arbres et les autres groupes d’espèces.En
choisissant des groupes participant àdes processus biologiques différents dans le fonctionnement
de l’écosystème,par exemple des producteurs autotrophes,des consommateurs et des décompo-
seurs,on peut avoir une approche de son état de fonctionnement.Nous avons choisi trois groupes
d’espèces qui sont utilisés conjointement sur les mêmes unités d’observation :la végétation,les col-
lemboles du sol et les oiseaux.La confrontation des résultats de chacundes groupes et leur
combinaison dans une analysefonctionnelle d’ensemble constituent des enjeux scientifiques impor-
tants dans ce travail. Onpeut faireles hypothèses suivantes quant àla sensibilitédechaquegroupe
vis-à-vis de facteurs liés au milieu,au contexteou àl’exploitation,au niveau d’une parcelle. Elles
peuvent servir de baseàdes discussions méthodologiques.
•La végétation
Àlabasedes chaînes trophiques,lanaturedela végétation influefortement sur le fonctionnement
de l’écosystème. Les arbres,en particulier, structurent le milieu en strates différant par l’abondance
de lalumière. L’exploitation vamodifier ladisponibilitéenlumièreet en eau mais aussiprovoquer
des perturbations localisées par les engins (ornièrehumide).
Onpeut fairel’hypothèse suivantequant àl’évolution de ladiversité végétale. L’augmentation forte
de lalumièreet de ladisponibilitéeneau,ainsiqueles perturbations localisées,conduisent à une
forteaugmentation de ladiversité végétale dans les années qui suivent lacoupe,par l’arrivée d’es-
pèces héliophiles ou opportunistes (Barkham,1992). Lefort développement des ronces finit par
appauvrir ladiversitébotanique. La fermeturedu milieu par lacanopée des arbres en croissance
élimine la ronceà son tour sans queladiversitén’augmente. Une hétérogénéitéhorizontale,des
arbres en réservepar exemple,apportelocalement une diversitéplus importante. Beaucoupplus
tard,lorsqueles événements ont provoqué une hétérogénéitédans lacanopée (trouée,différence
de hauteur,etc.),ladiversité végétale augmentedenouveau avecl’installation d’uncortège
d’espèces inféodées au milieu forestier et bien adaptées àla station (Gilliamet al.,1995).
•Les collemboles
Cegroupe de petits insectes est de plus en plus utilisécomme indicateur de l’activitébiologiquede
lalitièreet de l’humus (CanceladaFonseca, 1990;Setalaet al.,1995). La plupart des espèces sont
très sensibles àl’humiditédu sol.
Onpeut supposer qu’ils devraient par conséquent êtredéfavorisés justeaprès lacoupe. La recons-
titution de lacommunautédoit sefaire rapidement àpartir de noyaux de populations ayant pu
survivreaux modifications du milieu.
•Les oiseaux
L’évolution des communautés d’oiseaux nicheurs,principalement les passereaux,en relation avec
ladynamiqueforestièreadéjàétéabondamment étudiée (Frochot,1975; Ferry et Frochot,1990;
Muller,1994). Cependant,les forêts de la zone retenueprésentent d’autres spécificités (morcelle-
ment,hétérogénéité,etc.) quin’avaient pas étécomplètement prises en comptedans ces travaux.
Onpeut supposer quelacomposition de lacommunautédes oiseaux vadépendredela structure
de la végétation et de son évolution (cf. paragraphe concernant la végétation,ci-dessus)(Bersier
etMeyer,1994).
Les facteurs liés àlamorphologie spatiale du bois et de lacoupe (surface,forme,compacité,etc.)
doivent probablement influer.D’après les travaux antérieurs,lacommunautéavienne d’unbois
dépend de laprésenced’unmilieu intérieur quiapportedes espèces nouvelles par rapport aux
espèces communes des lisières (Icaran,1995). La position d’une coupe dans le bois, selon qu’elle
Techniqueet forêt
163
Rev.For.Fr.L- 2-1998
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%