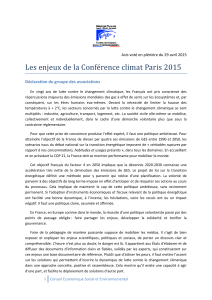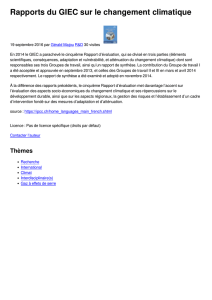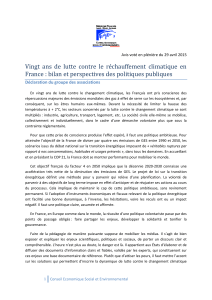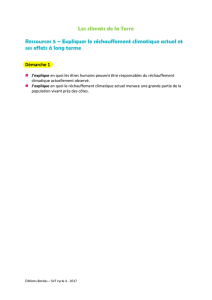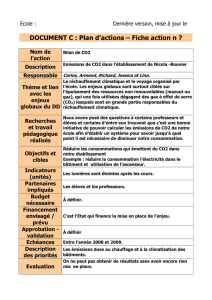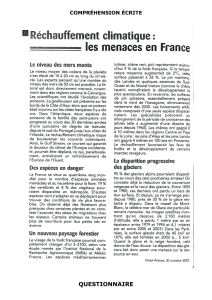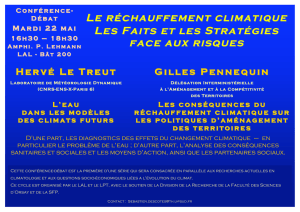Module 10- Questions environnementales mondiales : le

1
Module 10-
Questions environnementales mondiales : le changement climatique
et ses conséquences sur les pays en développement
Nguyen Huong Thuy Phan
Genève, 19-23 mars 2012
I. Concepts basiques des sciences du changement climatique
Le réchauffement est observé
1. Un changement à long terme du climat a été observé, notamment
Au niveau mondial
a. L’augmentation de la température de l’air et des océans (figure 1)
b. La fonte généralisée des neiges et de la glace
c. L’augmentation généralisée du niveau moyen des océans
Au niveau régional
d. Le changement généralisé des précipitations
e. Le changement de la salinité des océans
f. Le changement de la configuration des vents
g. Le changement dans les conditions climatiques extrêmes (sécheresse, importantes
précipitations, vagues de chaleur, tempêtes tropicales, etc.)
2. Toutefois certains aspects du climat ne changent pas, notamment :
a. L’amplitude thermique quotidienne (1979-2004) n’a pas changé car la température des
jours et celle des nuits a augmenté dans la même mesure.
b. La modification de la glace de l’Antarctique ne démontre pas de tendance moyenne
significative.
c. Il n’y a pas suffisamment de preuves pour déterminer s’il existe des tendances dans la
circulation méridionale de renversement (CMR) des océans ou des phénomènes à petite
échelle tels que des tornades, de la grêle, des éclairs et des tempêtes de sable.
3. Les changements observés dans les systèmes biophysiques tels que la fonte du permafrost,
l’altération des modèles et flux hydrologiques, la modification de certaines espèces terrestres, la
modification de la nature et l’abondance du plancton et du poisson sont des conséquences du
réchauffement observé (GIEC 2007a).
4. La compréhension du changement climatique s’améliore grâce à
a. L’amélioration et l’extension des données
b. Une meilleure compréhension des incertitudes

2
c. Une grande variété d’observations et de mesures : température de l’air et des océans,
glaciers et manteau neigeux (depuis 1960), niveau des océans et de la calotte glaciaire
(1980)
Figure n° 1 : Changement de la température mondiale et continentale (source : GIEC, 2007a).
5. En général, les tendances observées sont claires et pointent toutes dans la même direction.
6. Conclusion du GIEC : « Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. Il est
maintenant évident dans les observations de l’accroissement des températures moyennes
mondiales de l’atmosphère et de l’océan, dans la fonte généralisée de la neige et de la glace et
dans l’élévation du niveau moyen mondial de la mer. ».

3
Les causes du réchauffement
(Principale source : GIEC, 2007a).
7. La température sur Terre est régie par l’équilibre de l’énergie radiative disponible dans
l’atmosphère qui inclue l’énergie entrante et sortante. L’équilibre de l’énergie défini le budget
énergétique de la Terre ; un budget énergétique plus élevé entraine un climat plus chaud, et
vice-versa
1
. Quand cet équilibre énergétique se modifie, le climat change.
8. À court terme, l’équilibre dynamique de l’énergie radiative entraine une variation « normale »
de la température de la Terre et une variabilité « normale » du climat. À plus long terme, si la
température de la Terre continue d’augmenter, que l’on appelle le réchauffement climatique, le
changement climatique se produira.
9. De nombreux facteurs divers, appelés le forçage radiatif, ont un impact sur cet équilibre et
entraine des effets de réchauffement ou de refroidissement du climat mondial. Ces facteurs
peuvent être naturels et provoqués par l’homme (anthropogéniques). Ils incluent les activités
solaires (naturelles), les gaz à effet de serre
2
, les aérosols et les modifications de la surface des
sols (provoqués par l’homme).
10. Chaque forçage radiatif ne peut être précisément mesuré, ce qui entraine une incertitude.
3
11. Les chercheurs en changement climatique ont tenté d’expliquer les causes du réchauffement
climatique actuel. Afin d’évaluer si le réchauffement observé est quantitativement conforme
aux réponses attendues au forçage externe, des études d'attribution telles que les études
paléoclimatiques ont été menées.
12. Ces études paléoclimatiques sont utilisées pour déduire les changements passés au cours de
millions d’années. Cette approche utilise des données indirectes (telles que la largeur des cernes
des arbres) et des indicateurs sensibles au climat. On trouve des comportements cohérents
parmi plusieurs indicateurs dans différentes parties du monde (dont les effets locaux peuvent
être annulés) mais les incertitudes augmentent avec le temps dans le passé compte tenu de la
couverture spatiale progressivement limitée des données.
13. Les informations paléoclimatiques soutiennent la conclusion que la chaleur des 50 dernières
années est inhabituelle au regard des 1 300 dernières années. Les températures moyennes de
l’hémisphère nord au cours de la seconde moitié du 20
ème
siècle étaient supérieures à celles de
n'importe quelle autre période de 50 ans au cours des 500 dernières années, et probablement
les plus élevées des 1 300 dernières années. La dernière fois que la région polaire était aussi
1
http://web.mit.edu/newsoffice/2010/explained-radforce-0309.html
2
La sensibilité climatique à l’équilibre est définie pas le réchauffement mondial moyen de la surface suite au
doublement de la concentration de dioxyde de carbone. Celle-ci se situe probablement entre 2-4,5°C, avec une
moyenne de 3°C et très probablement pas moins de 1,5°C.
3
Même si tous les facteurs influençant le forçage radiatif comportent des incertitudes, l’un de ces facteurs affecte
l’incertitude de manière très importante : Les effets des aérosols (petites particules en suspension) dans
l’atmosphère. Ces effets sont en effet très complexes et souvent contradictoires. Par exemple, les aérosols brillants
(tels que les sulfatés provenant de la combustion du charbon) sont un mécanisme de refroidissement, alors que les
aérosols foncés (tels que le carbone noir provenant des moteurs diesel) entrainent le réchauffement. En outre,
l’ajout d’aérosols sulfatés aux nuages entraine des gouttelettes plus petites mais plus abondantes qui augmentent
la réflectivité des nuages, refroidissant ainsi la planète (http://web.mit.edu/newsoffice/2010/explained-radforce-
0309.html)

4
chaude qu'actuellement pendant une période
prolongée était il y a 125 000 ans, et la
réduction du volume de glace polaire a
entrainé une élévation des océans de 4 à 6
cm.
14. Les carottes de glace représentant plusieurs
milliers d’années indiquent que les
concentrations de dioxyde de carbone
4
, de
méthane et de protoxyde d’azote
5
(GES) dans
l’atmosphère mondiale ont nettement
augmenté depuis 1750 (aire industrielle). Voir
figure 2.
15. Les résultats des études d’attribution sont :
a. La majeure partie de l’augmentation
observée de la température moyenne
mondiale depuis la moitié du 20
ème
siècle s’explique très probablement
par l’augmentation des GES
anthropogéniques.
b. Les aérosols volcaniques et
anthropogéniques ont compensé une
partie du réchauffement (qui, sinon,
se serait produit).
c. Le réchauffement généralisé
6
et la
perte de masse de glace ne s'explique
probablement pas par des causes
naturelles sans forçage externe.
d. Les GES anthropogéniques expliquent
le réchauffement des mers et de la
troposphère, ainsi que la diminution
de l'ozone et le refroidissement de la
stratosphère.
e. Des difficultés persistent pour la simulation et l’attribution fiables des changements de
températures observées à plus petite échelle (locale).
16. La conclusion du GIEC est que « les changements que nous observons aujourd’hui sont dans une
large mesure amorcés par les émissions anthropogéniques de GES à longue durée de vie » (GIEC
2007a).
4
Provenant de l’utilisation des sols et de l’énergie fossile.
5
Provenant des activités agricoles.
6
Voir les données de la NASA relatives aux températures 1880-2011
http://www.youtube.com/watch?v=EoOrtvYTKeE&feature=share
Figure
n°
2
: c
hange
ment
s
des GES dans les carottes de
glace et les données modernes (source : GIEC, 2007a)

5
17. Les mécanismes de réchauffement sont appelés « l’effet de serre ». L’effet de serre est un
phénomène selon lequel, les GES présents dans l’atmosphère bloquent une partie des radiations
infrarouges que la Terre renvoie dans l’espace. Voir figure 3.
Figure n° 3 : L’effet de serre (source : http://wwf.panda.org)
18. On utilise le potentiel de réchauffement global (PRG) pour mesure la contribution des GES au
réchauffement. Celui-ci est exprimé en tonnes d’équivalent CO2 ou t CO2 e. Par convention, le
PRG du CO2 est de 1 ; le PRG d’autres GES mesure la contribution d’une masse donnée de GES
au réchauffement mondial par rapport à la même masse de CO2. Le PRG dépend de la période
de temps de calcul (voir tableau 1 ci-dessous). Les GES représentent la plus grande partie des
émissions de CO2.
Tableau 1 : Potentiel de réchauffement global de certains gaz à effet de serre (source : adapté
du GIEC 2007a, tableau 2.14, p 212).
GES Pendant 20 ans Pendant 100 ans Durée de vie (années)
Méthane 72 25 12
Protoxyde d’azote 289 298 114
CFC-11
7
6 730 4 750 45
HFC-23 12 000 14 800 270
7
Substance réduisant la couche d’ozone.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%