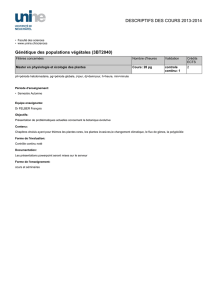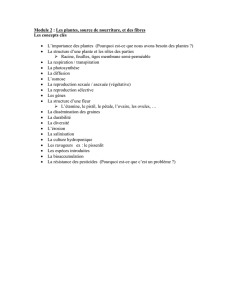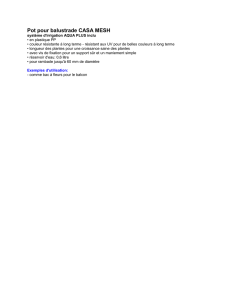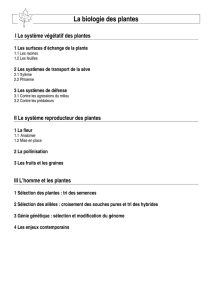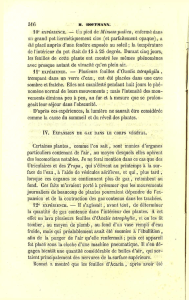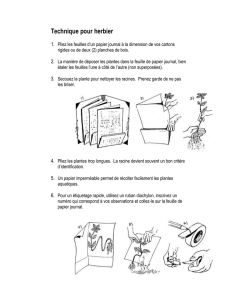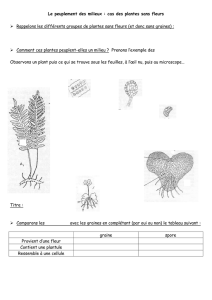plantes hommes

DES
PLANTES
QUI SOIGNENT
DES
HOMMES
&
Editions OUEST-FRANCE

3
Préface
S’il est un domaine qui touche au cœur des préoccupations du public,
c’est bien celui des plantes qui guérissent. Depuis la nuit des temps,
chamans et guérisseurs, dans toutes les cultures, ont soigné par les plantes.
Ces pratiques se poursuivent aujourd’hui dans de nombreuses régions du
monde et ont été relayées et reprises à son compte par la médecine moderne.
C’est cette longue et belle histoire que vous raconte cet ouvrage.
Les plantes médicinales sont au cœur de la thérapeutique, non seulement
les plantes douces consommées en infusions ou en gélules, mais aussi des
plantes à haut pouvoir thérapeutique comme la pervenche de Madagascar
et l’if dans le traitement du cancer. Et comment soulagerait-on les douleurs
même les plus sévèressans l’apport irremplaçable du pavotet de la morphine?
À une époque où les percées de la science lorsqu’elle est par trop prométhéenne
peuvent e rayer – ne parle-t-on pas de cyborgs, d’androïdes et d’hommes
«augmentés» ou immortels? – le recours et le retour à la nature o rent
un champ immense de possibilités fondées sur des savoirs millénaires.
Les plantes médicinales sont à la base de la phytothérapie, de l’aromathérapie,
de l’homéopathie, de la naturopathie, toutes ces pistes dont les béné ces
viennent opportunément renforcer ceux attendus de la médecine
conventionnelle.
Vous découvrirez tout cela dans cet ouvrage publié à l’occasion de
l’exposition présentée au Domaine de la Roche Jagu, et je vous souhaite
d’y prendre le plus vif intérêt et le plus grand plaisir.
Jean-Marie PELT
Président de l’Institut Européen d’Ecologie
Professeur Honoraire de l’Université de Metz
© Jacques Fleurentin / SFE
En couverture
© Shutterstock et Photononstop

Depuis l’origine, les êtres vivants ont su trouver dans la nature les ressources
qui leur sont essentielles et même vitales. L’Homme, apparu sur terre il y
a 3millions d’années, n’échappe pas à cette règle. Au l du temps, il assure sa
survie en sélectionnant dans son environnement les végétaux capables de le
nourrir, de l’habiller… et de le soigner. «Le remède végétal est sans doute
aussi ancien que la conscience humaine», selon Pierre Lieutaghi. Pourtant, la
découverte du pouvoir des plantes fut un long apprentissage qui, aujourd’hui
encore, pose de nombreuses questions.
Comment, au cours de l’histoire, l’homme a-t-il pu discerner la plante
bienfaisante de la plante toxique, la plante qui soigne de la plante qui tue?
Ce savoir est-il inné?
Les anthropologues s’accordent à dire que la connaissance du monde végétal
est le fruit d’une longue série d’observations et d’expérimentations. Cette
approche empirique des populations humaines, lesquelles ont agrégé une
foule d’informations au l des générations, leur a permis de sélectionner
progressivement les bons remèdes.
Sabrina Krief, primatologue au Muséum national d’histoire naturelle, précise
que les animaux sont les premiers à utiliser les plantes de manière thérapeutique.
Elle a ainsi identi é plus de vingt plantes consommées en automédication
par des chimpanzés de Tanzanie. L’observation des animaux domestiques
témoigne encore d’autres méthodes de soin instinctives: le mouton ingère des
fougères mâles pour se purger, le chat s’enivre de cataire…
Qui a copié qui? L’homme ou l’animal? Probablement les deux!
Cette connaissance aiguisée du végétal montre que l’espèce humaine a su lire
la nature à livre ouvert, allant même jusqu’à déjouer ses pièges, en dosant
intelligemment des plantes toxiques, susceptibles de causer sa mort. Peu à peu,
ce savoir s’est codi é, théorisé, tout en cherchant une logique dans les signes
révélés par la nature.
7
6
Des hommes et des plantes
qui soignent
Introduction
La Sauge
(Salvia o cinalis)
À travers les âges et dans toutes les cultures, les hommes ont contracté des liens très forts avec les plantes. La fl ore agit
sur nos corps, nos sens, notre esprit et notre imagination. Ses fragrances protectrices, fortifi antes, énergisantes
et médicales sont censées pénétrer par le nez, la bouche, les pores de la peau dans les organismes et
leur communiquer ses pouvoirs bénéfi ques. « Toute la vertu des médicaments ne consiste que dans la
communication d’un certain parfum », déclare l’abbé Rousseau, médecin de Louis XIV.
Dès l’Antiquité, les bonnes odeurs des plantes aromatiques sont utilisées pour lutter contre les
épidémies et les maladies. Elles apparaissent même comme les armes principales contre la
corruption de l’air et du corps, cause de tous les maux.
Du latin « salvare », « sauver », la sauge offi cinale est apparue très tôt en Occident
comme le paradigme de ces végétaux salutaires. Il est remarquable qu’elle tienne
un rôle équivalent dans la pharmacopée arabe sous le nom de « sâlma », ou
« sâlmiya », « celle qui procure le salut ».
Ce sous-arbrisseau à feuilles rugueuses, blanchâtres, recouvertes de poils
laineux qui les protègent du froid et aux grandes fl eurs d’un bleu-rose
lilas, est considéré depuis la nuit des temps comme l’herbe de tous
les bienfaits.
À partir de la révolution industrielle, la transmission des remèdes traditionnels
décline subitement. Les chercheurs copient les substances naturelles et les
reproduisent par synthèse, voire créent de toutes pièces des molécules originales.
La nature sauvage se trouve temporairement mise à distance à mesure que se
développent la biochimie et la biologie moléculaire.
Aujourd’hui, notre société urbanisée semble redécouvrir le végétal comme
«ré-initiateur» de son bien-être. On assiste donc à un réel engouement pour
la phytothérapie, et dans les o cines, les médicaments naturels font recette.
Mais quelle place «les plantes qui soignent» peuvent-elles occuper dans la
médecine occidentale actuelle, guidée par la recherche pharmaceutique de
pointe et la chimie? Un dialogue est-il encore possible entre les traditions
thérapeutiques à base de plantes et la médecine de demain?
© Biosphoto / Harold Verspieren / Digitalice

7
titre
La majorité des produits utilisés par les humains pour soulager leurs maux
trouve son origine dans le monde végétal, et la connaissance des vertus
médicinales des plantes est aussi ancienne que l’humanité! Longtemps, l’art
de guérir a été le fait de l’empirisme et de l’observation transmise au l des
générations, de pratiques de magie et de superstitions, et du fait de divinités
qui ont révélé leurs connaissances aux humains.
Dès le troisième millénaire avant J.-C. apparaissent néanmoins en Mésopotamie
et en Égypte les premières pharmacopées indiquant les prémices d’une
rationalisation du savoir. Aux côtés de ces premiers savoirs écrits, les
guérisseurs et leurs rituels conservent toutefois tous leurs pouvoirs.
En Chine, l’époque des «Printemps et Automnes» (770-476 av. J.-C.) marque
la n de la phase de développement strictement empirique de la médecine et le
début de sa transformation en système médical.
Dans la Grèce antique, Hippocrate (460-377 av. J.-C.) produit, par sa
«théorie des humeurs», ses premiers fondements scienti ques à la médecine
en la séparant de ses préceptes philosophiques, religieux et magiques.
Traduit en latin, le Canon du Persan Avicenne (Ibn Sînâ, 980-1037) reste la
base de l’enseignement médical en Europe jusqu’au e siècle.
Au e siècle, en Italie, l’École de Salerne constitue un établissement de renom
où se synthétisent les courants médico-pharmaceutiques grec, latin et arabe.
Dans l’Occident du Moyen Âge, alors que la Bible est la référence universelle,
la médecine se contente de répéter l’antique doctrine de Galien et de soigner
avec les plantes qu’il avait prescrites et les remèdes qu’il utilisait. Mais
les pratiques superstitieuses et magiques sont largement présentes, et les
femmes, «sorcières» pour certaines, sont les grands dépositaires des secrets
des « herbes » qui soignent. Toutefois, des communautés d’apothicaires se
constituent, et en 1258, le roi Saint Louis leur o re un statut, con rmé par
Philippe le Bel.
Ainsi, dans cette relation complexe qui lie plantes et humains depuis toujours,
la coexistence entre savoirs rationnels et empiriques s’est-elle toujours
étroitement poursuivie au travers des siècles. Et cette antinomie n’est-elle pas
encore largement présente aujourd’hui dans bien des endroits du monde?
Physicien consultant un papyrus médical,
tandis qu’une princesse malade et sa famille
attendent, lithographie de H. Herget
(1885- 1950).
© National Geographic Creative / Bridgeman Images
Évolution
de la pharmacopée :
entre théorie
et pratique
Histoire de la pharmacopée
végétale

9
En Mésopotamie, entre Tigre et Euphrate, les documents les plus anciens
attestant d’une pharmacopée ont été découverts à Nippour, au sud de Babylone,
où des milliers de tablettes d’argile, cunéiformes, datant de 2100 av.J.-C., ont
été exhumées. Des médecins possèdent alors une bonne connaissance des
vertus curatives de nombreuses plantes (250) ainsi que de substances animales
(écailles) et minérales (soufre). Ces pratiques thérapeutiques concernent
tant le médecin que le thaumaturge, guérisseur ayant recours au rituel et à
l’incantation. Si au l des générations l’empirisme est l’origine de la sélection
de beaucoup de ces plantes, la transmission des connaissances est également
le fait des dieux qui les ont révélées aux humains. Au vu de la présence
d’espèces exotiques dans les pharmacopées, une partie de ces savoirs provient
probablement aussi des peuples avec lesquels les Mésopotamiens ont été en
contact. La Mésopotamie a été en e et très tôt en lien avec le sous-continent
indien, à l’époque de la civilisation «de l’Indus».
8
L’héritage méditerranéen
Le papyrus médical Chester Beatty,
vers 1200 av. J.-C., Égypte ancienne
(XIXe dynastie). Son nom vient de Sir Alfred
Chester Beatty qui a fait don de dix-neuf
papyrus au British Museum.
© British Museum, Londres, UK / Bridgeman Images
En Égypte, des inscriptions funéraires
et des bas-reliefs renseignent sur de très
anciennes pratiques médicales, en liaison
avec Imhotep (c. 2686 à 2613 av. J.-C.),
vénéré comme dieu guérisseur. Une
dizaine de précieux papyrus fournit des
informations sur l’état de la médecine,
et en particulier le papyrus Ebers, l’un
des plus anciens documents médicaux
originaux connus. Il date du début de la
XVIIIe dynastie (vers 1580 av. J.-C.) et se
présente comme un long document de
plus de 20m et 30cm de large. Véritable
encyclopédie médicale, il se décline
en 877 paragraphes qui rapportent
de nombreuses maladies et pratiques chirurgicales, et plusieurs centaines de
remèdes contre toutes sortes d’a ections. Il contient aussi une importante
pharmacopée, principalement élaborée à partir de plantes, parmi lesquelles le
caroubier, l’encens, la gomme ammoniaque ou le térébinthe.
Tablette d’argile cunéiforme, Irak,
vers 2500 av. J.-C.
© Pictures From History / Bridgeman Images
Un papyrus médical, datant de la XVIIIe dynastie, le papyrus Ebers, nous fournit l’une des plus anciennes formules
connues de parfum thérapeutique, celle du Kyphi. Elle est également gravée sur les murs du temple d’Horus, à
Edfou, et sur ceux du temple de la déesse Hathor, à Dendérah. Dioscoride, Plutarque et Galien, trois auteurs
grecs des Ier et IIe siècles apr. J.-C., en donnent chacun une version un peu différente.
Souchet (famille des papyrus), baies de genièvre, raisins secs, résine de térébinthe, roseau odorant,
jonc odorant, fl eurs de genêt, vin d’oasis, miel, myrrhe, entrent dans la plupart de ces recettes,
complétées parfois de nard (plante herbacée aromatique), cannelle, safran, menthe, séséli
(apiacée), cardamome, henné.
Utilisé en pastilles à brûler pour honorer les dieux, ce parfum « deux fois bon », à
l’odeur fl orale, résineuse et sucrée, soigne aussi, sous forme liquide, les maladies
intestinales, hépatiques et pulmonaires. Le Kyphi est réputé en outre pour ses
vertus décontractantes et déstressantes. Il en émane une vapeur suave et
bénéfi que qui dénoue sans le secours de l’ivresse la pénible tension
des soucis de la journée. C’est le premier parfum aromachologique,
censé avoir des effets sur l’humeur et le comportement.
Le Kyphi
Bas-relief de la tombe de Pairkep montrant
des servantes pressant de l’huile de lys pour
fabriquer du parfum, Egypte ancienne
(XXVIe dynastie, 664-525 av. J.-C.)/Musée
du Louvre, Paris.
© Werner Forman Archive / Bridgeman Images
9
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%