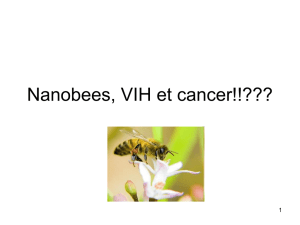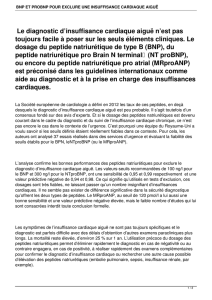iniguez bat - Revue de Médecine Vétérinaire

1. Introduction
L’expression de peptides ou de protéines à la surface des
bactériophages constitue un outil extrêmement puissant pour
la recherche sans a priori de ligands spécifiques d’une molé-
cule donnée. Les banques combinatoires peptidiques pha-
giques (BCPP) sont largement utilisées depuis maintenant
une dizaine d’années pour la sélection de ligands à des anti-
corps comme les anticorps monoclonaux [1, 2, 3], à d’autres
protéines [4, 5] ou à des molécules non protéiques [6, 7, 8].
Les ligands sélectionnés à partir de ces banques ne ressem-
blent pas forcément aux ligands naturels. Ils peuvent mimer
leur structure [9] ou bien représenter des épitopes conforma-
tionnels ou structuraux. Ces ligands sont donc sélectionnés
pour le seul critère de conformation homologue à l’épitope
initial.
Une des applications de la technologie des BCPP a été de
les cribler avec des anticorps polyclonaux anti-viraux. Une
BCPP a été soumise au criblage de ses composants par des
immunoglobulines de type G provenant de sera de souris
immunisées avec l’antigène S de surface du virus de l’hépa-
ARTICLE ORIGINAL
Sélection de déterminants antigéniques à partir
de banques peptidiques
Application au diagnostic de l’artérite virale équine
°P. INIGUEZ et °° S. ZIENTARA
°Institut Cochin de Génétique Moléculaire, 22 rue Méchain ,F-75014 Paris ; Tél. 33(0) 1 40 51 64 43 ; (33(0) 1 40 51 64 54 ; [email protected]
°° AFSSA, 22 rue P. Curie F-94703 Maisons-Alfort ; Tél. 33(0) 1 49 77 13 12 ; [email protected]
RÉSUMÉ
Les banques peptidiques réalisées à la surface des bactériophages fila-
menteux permettent de rechercher parmi des millions de séquences expri-
mées à leur surface celles qui ont une affinité pour une (ou des) molécule(s)
donnée(s). Les applications de cette technologie sont nombreuses :
recherche de drogues à visée thérapeutique, détermination de séquences
consensus, cartographie d’épitopes, etc...
Nous nous proposons dans cet article de donner un aperçu de la poten-
tialité de la technologie des phages recombinants en faisant une synthèse
des principales caractéristiques et des avantages apportés par l’utilisation de
cet outil. Nous illustrerons notre propos par un exemple appliqué à la
recherche de déterminants antigéniques viraux pour la mise au point de tests
de diagnostic en pathologie virale équine. Le but des expériences a consis-
té à sélectionner parmi les quarante millions de clones phagiques qui com-
posent une banque, ceux qui se liaient spécifiquement aux paratopes des
anticorps dirigés contre le virus de l’artérite virale équine. Une fois identi-
fiés, ces déterminants antigéniques ont été incorporés dans des tests ELISA.
L’utilisation de tels tests, moins coûteux et moins longs que les tests clas-
siques de sérologie, ne peuvent certes pas encore les remplacer mais ils
constituent assurément une avancée vers le diagnostic précoce d’une infec-
tion. Il a par ailleurs été montré que les phages sont d’excellentes entités
immunogènes et plusieurs auteurs ont décrit l’obtention d’anticorps dirigés
contre des peptides étrangers insérés dans une protéine de surface phagique.
Il est donc envisageable d’utiliser en tant que molécules présentatrices d’an-
tigènes des particules phagiques qui exposent à leur surface des épitopes
spécifiques dans le cadre d’une vaccination.
MOTS-CLÉS : virus - artérite équine - banque peptidique
- phage - diagnostic.
SUMMARY
Selection of viral epitopes from phage display libraries. Application to
diagnosis of Equine Arteritis Virus. By P. INIGUEZ and S. ZIEN-
TARA.
Peptide libraries achieved on the surface of filamentous bacteriophages
aim to discover among millions sequences those having affinity for one or
few molecules. This technology has a lot of applications : drugs discovering
applied to pharmaceutical medicine, sequences determination, epitope map-
ping, etc...
Our purpose in this paper is to give a global idea on recombinant phage
technology potentialities. For this, we relate the main caracteristics and
advantages of this tool. Our review will be illustrated by the example of
equine viral antigenic determinants selected from phage epitope library and
incorporated in diagnosis tests. The goal of these experiments was to select
among fourty millions of recombinant phages those who had specific affi-
nity for antibodies directed against equine arteritis virus. Once caracterised,
these antigenic determinants were incorporated in ELISA tests. Utilization
of ELISA tests, less expensive and quicker than classical serological tests,
should replace them in the future. Another application of the displayed epi-
tope library could be the use of phages carrying an immunogen peptide as
vaccines like it has been done for the gag gene of HIV and for the circum-
sporozoite protein of the human malaria parasite Plasmodium falciparum.
KEY-WORDS : Equine arteritis - epitope phage libraries -
diagnosis.
Revue Méd. Vét., 2001, 152, 5, 363-371

tite B (VHB). Il a été identifié à partir de ces expériences des
séquences reconnues spécifiquement par des séra anti-VHB
et correspondant soit à des épitopes linéaires de l’antigène S
soit à des mimotopes de celui-ci [10]. Cette technique n’avait
cependant pas encore été utilisée pour identifier des ligands
d’anticorps polyclonaux dirigés contre un virus entier.
L’identification de déterminants antigéniques spécifiques
d’un pathogène comme le virus de l’artérite équine pourrait
fournir de nouvelles classes de molécules utilisables pour le
diagnostic des pathologies virales. Il serait également très
intéressant de pouvoir discriminer grâce à ces molécules
entre des animaux infectés et des animaux vaccinés. De plus,
les phages porteurs de ces molécules antigéniques sont sus-
ceptibles de servir par la suite d’entités vaccinales.
2. L’artérite virale des équidés
L’artérite virale équine, anciennement appelée "fièvre
typhoïde du cheval", est une maladie due à un virus de la
famille des Arteriviridae auparavant classé dans celle des
Togaviridae [11, 12]. Le virus de l’artérite équine (VAE) est
un petit virus enveloppé d’environ 60 nm de diamètre. Son
génome est constitué d’une molécule d’ARN simple brin de
polarité positive longue de 12,7 Kb qui code pour 7 phases
ouvertes de lecture (Figure 1).
Les signes cliniques peuvent être très variables.
Classiquement, la maladie se caractérise initialement par de
l'hyperthermie pendant 4 à 5 jours, de l'anorexie et de l'abat-
tement ("fièvre typhoïde"), puis apparaissent des signes de
conjonctivite, de larmoiement, d'œdème des jambes ("en
chaussette") et d'œdème du scrotum chez les étalons. On
observe également du jetage et une congestion de la
muqueuse nasale. Peut parfois être observé un oedème des
fosses supra-orbitales. D'autres symptômes tels que de la
photophobie, une uvéite, de la toux, de la diarrhée mais aussi
un rash cutané, voire une stomatite ulcéreuse, ont également
été signalés.
C'est chez la jument gestante que les manifestations les
plus graves peuvent survenir ; l'infection peut entraîner des
avortements dans la proportion de 50 à 70 % survenant dans
les deux à quatre semaines après contamination [13]. Les
avortements se produisent aussi bien chez les juments ayant
présenté des signes cliniques que chez celles ayant fait une
maladie asymptomatique. L'avortement est dû à une nécrose
du myomètre et à un œdème secondaire entre trophoblaste et
endomètre provoquant un décollement du placenta et la mort
fœtale. Les produits d'avortement peuvent être totalement ou
partiellement autolysés. Mais il n'y a pas de lésion pathogno-
monique chez les foetus infectés. Les juments infectées par
un étalon excréteur ne semblent pas avoir d'infertilités secon-
daires contrairement aux étalons qui présentent une période
temporaire de subfertilité quelques jours après la primo-
infection. Des diminutions significatives de la motilité et de
la concentration des spermatozoïdes pendant 6 à 8 semaines
ont été décrites après infections expérimentales [14]. Les
caractéristiques du sperme redeviennent ensuite normales.
La première souche du virus de l’artérite équine a été iso-
lée en 1953 aux Etats unis (Ohio) dans la ville de Bucyrus
[15, 16]. Il s’agit de la seule souche dont la séquence du
génome soit connue ainsi que son organisation [11]. Il semble
exister une certaine stabilité antigénique entre les différents
isolats même si certains auteurs ont montré des différences
génétiques par analyse des profils électrophorériques des
ARN génomiques provenant de 29 isolats viraux d’origines
géographiques différentes [17] ainsi que des différences anti-
géniques entre protéines de différentes souches notamment
en ce qui concerne la protéine de surface GL[18]. Il n’existe
cependant qu’un sérotype du virus, les variations antigé-
niques observées étant mineures.
Le diagnostic sérologique de la maladie est effectué par la
mise en évidence des anticorps neutralisants (séroneutralisa-
tion). Il peut également être réalisé par le test de fixation du
complément, utile pour détecter une infection précoce (haut
titre entre deux et quatre semaines après l’infection). Les pre-
miers tests ELISA ont employé le virus purifié de l’artérite
équine comme antigène [19]. Ils ont donné beaucoup de
résultats faussement positifs essentiellement dus à la pré-
sence parasite de composants cellulaires et tissulaires réagis-
Revue Méd. Vét., 2001, 152, 5, 363-371
364 INIGUEZ (P.) ET ZIENTARA (S.)
FIGURE 1. — Structure du virus de l’artérite équine.

sant avec des anticorps présents en grande quantité dans le
sérum de cheval [20]. Un autre test ELISA a par la suite été
mis au point en utilisant cette fois-ci comme antigène un
fragment de la glycoprotéine GLlong de 43 acides aminés
[21]. Ce test pourrait remplacer avantageusement le test de
séroneutralisation virale notamment en terme de sensibilité.
La recherche de déterminants antigéniques encore plus courts
du virus, externes mais aussi internes au virus, voire l’identi-
fication d’épitopes, représente une voie très intéressante car
elle pourrait conduire à améliorer la spécificité et la sensibi-
lité d’un tel test. La mise en évidence d’épitopes internes
ouvrirait une voie vers la différenciation des sérums d’ani-
maux infectés de ceux d’animaux vaccinés.
3. Les banques combinatoires
biologiques de fusion
Les banques combinatoires (appelées aussi aléatoires) de
peptides sont comme de grandes bibliothèques dans les-
quelles chaque livre représente un peptide. Mario GEYSEN a
été le premier à introduire le concept de mimotope [9] c’est-
à-dire la recherche de la séquence peptidique minimale pou-
vant mimer un déterminant antigénique d’une protéine, d’un
polypeptide ou de toute autre molécule susceptible de possé-
der un pouvoir antigénique. Par une méthode de synthèse chi-
mique récurrente de peptides formés à partir d’un mélange
aléatoire d’acides aminés, il a trouvé des peptides mimant la
structure de l’épitope d’un anticorps monoclonal.
Les banques peptidiques peuvent être classées en quatre
catégories selon la façon dont elles sont construites ou pré-
sentées. Les deux premiers types de banques sont basés sur la
synthèse chimique des acides aminés. Celle-ci est réalisée
soit sur un support solide comme des billes de résine sur les-
quelles les peptides sont présentés [22] soit elle s’effectue
directement en solution [23]. Les deux autres types de
banques peptidiques sont réalisés dans des systèmes biolo-
giques, soit à la surface de bactéries [24, 25] soit à la surface
de bactériophages filamenteux en fusion avec des protéines
de capside [2]. Nous ne traiterons dans cet article que de cette
dernière catégorie.
A) HISTORIQUE
PARMLEY et SMITH [26] ont décrit une première
approche de la construction d’une banque peptidique aléa-
toire réalisée dans un système biologique, le bactériophage
filamenteux fd. SCOTT et SMITH [2] ont par la suite amé-
lioré le système, notamment le vecteur de clonage. Les
banques phagiques sont parmi toutes les banques peptidiques
de loin les plus utilisées pour la sélection de ligands vis-à-vis
de diverses molécules. Elles sont construites soit dans la pro-
téine mineure d’enveloppe pIII soit dans la protéine majeure
d’enveloppe pVIII. Ce système a fait ses preuves depuis
maintenant une dizaine d’années et, sans parler des peptides,
de nombreuses protéines ont dejà été exprimées de façon
fonctionnelle à la surface des bactériophages (Tableau I). Les
peptides aléatoires présents dans les banques de fusion biolo-
giques proviennent tous de la synthèse d’oligonucléotides
dégénérés. Ces oligonucléotides sont synthétisés chimique-
ment puis insérés dans un vecteur de type phagique ou plas-
midique, ou alors convertis en ARN pour être exprimés par
un système de traduction in vitro. La puissance des systèmes
d’expression biologiques réside dans la capacité à pouvoir
propager leurs clones à chaque étape de sélection. De plus,
les banques peptidiques biologiques peuvent être réampli-
fiées presque à volonté, contrairement aux banques pepti-
diques synthétiques.
B) CONSTRUCTIONS DES BANQUES PEPTIDIQUES
Les phages filamenteux ont représenté et représentent tou-
jours le matériel de choix pour la construction de banques
peptidiques de surface aléatoires. Les peptides aléatoires sont
la plupart du temps présentés en surface fusionnés aux pro-
téines d’enveloppe pIII ou pVIII du phage (Figure 2). Les
phages filamenteux (fd, M13, f1) représentent un groupe de
virus apparentés qui infectent spécifiquement les bactéries E.
coli à Gram négatif mâles (F+) en s’adsorbant sur leurs pilis.
Ils ont l’aspect en microscopie électronique de longs fila-
ments flexibles de longueur environ 1 µm et de largeur envi-
ron 10 nm. Ils contiennent une molécule d’ADN simple brin
circulaire longue de 6,4 Kb recouverte d’une enveloppe com-
posée d’environ 2700 copies d’une protéine, la protéine
majeure d’enveloppe pVIII. Il existe également quatre autres
protéines d’enveloppe mineures, présentes à environ cinq
copies chacune, les protéines pIII (responsable de l’adsorp-
tion du phage sur les pilis bactériens) et pVI localisées à une
extrémité du virion et les protéines pVII et pIX localisées à
l’autre extrémité.
Les banques peptidiques réalisées à la surface de bactério-
phages ont été initialement utilisées pour isoler des ligands se
liant à une région donnée d’une protéine. Elles ont prouvé
leur efficacité dans un premier temps pour la recherche de
sites de liaison à des anticorps monoclonaux [1, 27, 28] puis
à des protéines ou à des domaines protéiques [4] ainsi qu’à
des molécules non protéiques [7] et maintenant à des anti-
corps polyclonaux [3, 10]. Les études préliminaires sur les
phages filamenteux en tant que vecteurs de clonage ont
débuté en 1980 avec ZACHER et SMITH. Leur construction,
nommée fd-tet, a été à l’origine de nombreux vecteurs d’ex-
pression phagique (Tableau II), notamment la série des vec-
teurs fUSE [29]
C) STRATÉGIES D’EXPRESSION DES PEPTIDES
En 1985, SMITH a donné les bases de la technique de sélec-
tion des phages recombinants, le biopanning [30] dont le
principe est résumé par la figure 3. Idéalement, durant la
phase de biopanning, seul le peptide recombinant exposé à la
surface du phage devrait être en interaction avec la matrice
sur laquelle est fixée la molécule pour laquelle on recherche
un partenaire ligand. Cela étant évidemment irréalisable, il
faut optimiser les chances d’obtention d’interactions entre le
peptide exposé en surface phagique et la molécule immobili-
sée sur la matrice. Pour cela, l’accessibilité du peptide doit
être maximale tout en réduisant les interactions entre les
autres régions du phage et la matrice. Plusieurs paramètres
Revue Méd. Vét., 2001, 152, 5, 363-371
SÉLECTION DE DÉTERMINANTS ANTIGÉNIQUES À PARTIR DE BANQUES PEPTIDIQUES 365

366 INIGUEZ (P.) ET ZIENTARA (S.)
Revue Méd. Vét., 2001, 152, 5, 363-371
TABLEAU I. — Protéines fonctionnelles et peptides exprimés à la surface de bactériophages.
FIGURE 2. — Stratégies d’expression de peptides à la surface de phages filamentaux.
pV
pVIII
pIII

Revue Méd. Vét., 2001, 152, 5, 363-371
TABLEAU II. — Vecteurs d’expression phagique.
FIGURE 3. — Biopanning.
SÉLECTION DE DÉTERMINANTS ANTIGÉNIQUES À PARTIR DE BANQUES PEPTIDIQUES 367
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%