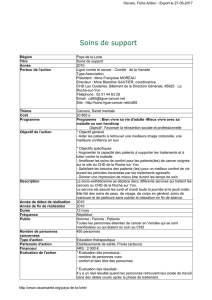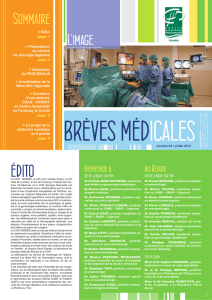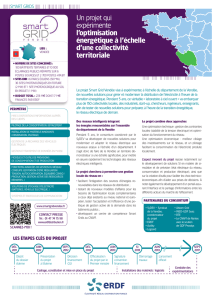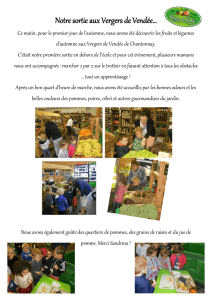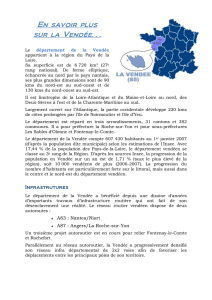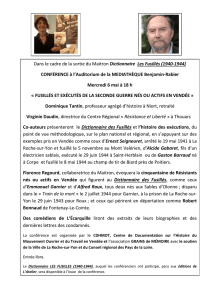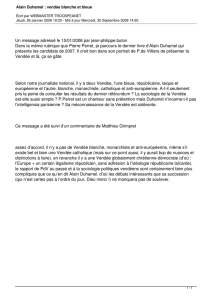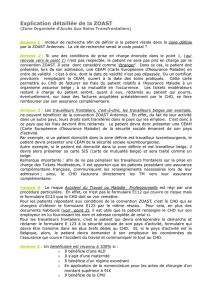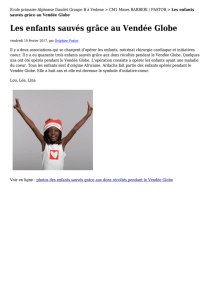L`image - C.H.D. Vendée

Bienvenue à
Site de la Roche-sur-Yon
> Dr Jesus José AGUILAR GARCIA,
assistant en imagerie médicale
> Dr Thomas CUVIER, praticien
contractuel en onco-hématologie
> Dr Anne-Cécile GOARIN, praticien
hospitalier en gynécologie-obstétrique
> Dr Jacques GOINEAU, praticien
contractuel aux soins palliatifs
> Dr Lionel HOMER, praticien
contractuel en gynécologie-obstétrique
> Dr Cyril LECONTE, praticien
contractuel au Centre Fédératif de Pré-
vention et de Dépistage
> Dr Cathelle LEMARCHAND,
assistante spécialiste au SAMU-SMUR-
Urgences
> Dr Elodie MENAGER TABOUREL,
praticien contractuel en onco-hémato-
logie
> Dr Elise MOIRE, assistante spécia-
liste en onco-hématologie
> Dr Marine MORRIER, assistante
spécialiste en médecine post-urgence
> Dr Jean-François RAMEE,
praticien contractuel en onco-
hématologie
> Dr Kristell TAILLANDY, assistante
spécialiste en onco-hématologie
Au Revoir
Site de la Roche-sur-Yon
> Dr Guillaume DEGENNE, assis-
tant spécialiste aux soins palliatifs
> Dr Louis Bertin FOGANG, praticien
hospitalier au SAMU –SMUR – Urgences
> Dr Nathalie MARTY, praticien
contractuel au Centre Fédératif de Pré-
vention et de Dépistage
> Dr Caroline POUDOU, assistante
spécialiste en gynécologie obstétrique
Site de Luçon
> Dr Lylia NADAF, praticien contrac-
tuel en soins de suite et de réadaptation
spécialisés
> Dr Yves DIDION, praticien hospita-
lier en imagerie médicale
Site de Montaigu
> Dr Nadjia BENYELLES, praticien
contractuel aux urgences
> Dr Josué SOUSSANA, praticien
attaché au Centre Périnatal de Proximité
Changement de Service
Site de Luçon
Dr Elyse VALSER, praticien hospi-
talier en addictologie (auparavant en
poste aux urgences)
Sommaire
> Édito
> Bienvenue /
Au Revoir /
Changement de Service
page 1
> Un gériatre dans le service
de chirurgie orthopédique du
CHD VENDÉE
page 2
> La recherche clinique issue
du CHD VENDÉE au cœur de
la lutte contre les infections
nosocomiales à travers le projet
de recherche clinique intitulé
DEMETER
> Relais de friction
hydro-alcoolique
des mains des soignants
sur une journée :
record du monde battu
au CHD VENDÉE le 5 mai 2015
> Nouvelles consultations
en pédiatrie
page 3
> Première naissance d’un bébé
issu d’une fécondation in vitro
au centre Procréalis
à La Roche-sur-Yon
> FLASH
page 4 BRÈVES MÉDICALES
numéro 46 > juillet 2015
édito
Le plan triennal 2015-2017 d’efcience et de performance du sys-
tème de soins, appliqué aux hôpitaux, porte sur tous les aspects de
leurs activités : invitation à développer l’ambulatoire, à améliorer la
pertinence des actes et de la prescription, à optimiser les achats, à
maîtriser les dépenses de transport sanitaire et de médicaments…
Le CHD VENDÉE s’inscrit dans cette stratégie de modernisation avec
notamment un projet d’unité commune de médecine polyvalente am-
bulatoire (hors chimiothérapies déjà regroupées) dont la mise en œu-
vre est attendue n 2015 avec une montée en charge en 2016.
L’établissement poursuit par ailleurs l’exécution de son schéma direc-
teur immobilier avec certains chantiers en voie d’achèvement comme
par exemple :
la livraison en septembre 2015 du nouveau bâtiment des urgences,
bientôt suivie par la réhabilitation des locaux existants (de la n octo-
bre 2015 à la mi-octobre 2016) ;
l’ouverture en octobre 2015 d’une plateforme logistique sur l’em-
placement de l’ex-magasin NETTO, qui aura pour effet de désen-
combrer le site de La Roche-sur-Yon d’une partie de la circulation
des transporteurs ;
la livraison de la grande aile rénovée du bâtiment principal
d’hospitalisation sur le site de La Roche-sur-Yon en novembre 2015.
Parallèlement l’établissement construit les bases nécessaires au
développement de ses complémentarités avec ses partenaires publics
ou libéraux en mettant en œuvre un Dossier Patient Interopérable
(dont une première étape a été le choix du groupe Maincare Solutions
le 22 juin dernier, à l’issue d’un dialogue compétitif de plusieurs mois),
et en déployant le réseau d’images PACS.
Ainsi, les sujets développés dans ce numéro des Brèves médicales,
tels que l’intégration d’un gériatre à l’équipe de chirurgie orthopédique,
ou le nancement d’un nouveau projet de recherche clinique
en réanimation, révèlent le dynamisme des équipes médicales
dans tous les domaines, mais ne sont pourtant que les prémices
des profonds remaniements dans l’organisation des soins qui se
préparent institutionnellement, en termes d’aménagement territorial,
de coopérations, d’échanges, de mutualisations et de qualité des
prestations.
Yvon Richir, Directeur Général
BRÈVES MÉDICALES > Publication semestrielle
> Directeur de publication : Y. RICHIR > Admi-
nistration, rédaction : R. Ouisse - Direction des
Usagers et de l’Accueil > n° ISSN : 1167-2072
> Dépôt légal : 1er trimestre 1992 > PAO : C. DUDIT
1
L’image
Un gériatre en chirurgie orthopédique
Vendée

Un gériatre dans le service
de chirurgie orthopédique du chd vendée
> L’orthopédie au CHD
Le service spécique de chirurgie orthopédique et
traumatologie a été créé au CHD en 1977 mais ce
n’est qu’en 1981 que la « garde » de chirurgie se
scindera en spécialités « viscérale » et « orthopé-
die ».
Aujourd’hui, ce service comprend 50 lits d’hospita-
lisation complète et un service de chirurgie ambu-
latoire.
L’équipe médicale sous la chefferie du Dr Guillaume
VENET se compose de 6 chirurgiens orthopédistes,
3 internes, 1 gériatre.
L’équipe paramédicale est importante avec 2 cadres
de santé (Lydie METEIER et Sylviane GOMEZ),
27 IDE, 35 aides-soignantes, 2 agents des services
hospitaliers et 7 secrétaires.
Ce service accueille des patients adultes, hospitali-
sés pour :
- de la chirurgie orthopédique programmée (pro-
thèse de hanche, genou, épaule…) ;
- de la chirurgie non programmée consécutive
à des traumatismes (fractures, accidents de la
route…) ;
- des infections des tissus osseux.
Ces patients sont admis dans le service :
- par le biais des urgences (pour les trauma-
tismes) ;
- par des transferts d’autres services ;
- par des entrées directes du domicile (pour la
chirurgie programmée, et après consultation du
chirurgien référent).
Le service de chirurgie orthopédique et trauma-
tologie a accueilli 773 patients (tout âge confon-
du) en 2014, qui sont restés hospitalisés en
moyenne 5 jours.
> Les patients âgés en orthopédie :
l’exemple des fractures
du col du fémur
> Quelques chiffres
d’épidémiologie générale
En France, le nombre de séjours pour fracture de
l’extrémité supérieure du fémur augmente de 0,3%
par an depuis 1998. La fracture de l’extrémité supé-
rieure du fémur touche surtout les sujets âgés, voire
très âgés. On constate une augmentation progres-
sive de l’âge moyen des sujets fracturés.
> Conséquences :
> Risque de décès : il s’agit d’une pathologie
grave, le risque de décès augmentant avec l’âge.
Il est de 2% chez les femmes de moins de 80 ans
au cours de l’hospitalisation, pour atteindre 8,3%
chez les plus de 95 ans. Ce taux de mortalité est
plus élevé chez les hommes, allant jusqu’à 15%
de mortalité chez les hommes de plus de 94 ans
au cours de l’hospitalisation. Les taux de mor-
talité à plus long terme sont variables selon les
études mais varient de 14,7% à un an à 46% à un
an chez les patients de plus de 90 ans.
Les études montrent une diminution progressive
de cette mortalité en France, avec une diminution
de la mortalité plus importante chez les patients
âgés, probablement par une meilleure prise en
charge opératoire et péri-opératoire de ceux-ci.
> Risque de perte d’autonomie : près de la moi-
tié des patients ne récupère pas leur autonomie
antérieure après un an. Seuls 25% des patients
mobiles sans aides regagnent leur autonomie
antérieure à 3 mois post-opératoire ; 20% des
patients deviennent grabataires. Les facteurs de
risque les plus importants sont le faible niveau
d’autonomie antérieure et la survenue d’un épi-
sode confusionnel post-opératoire.
Les conséquences d’une perte d’autonomie chez
les sujets âgés sont multiples. Elle entraine l’inter-
vention de personnes extérieures pour les actes
de la vie quotidienne, une modication du lieu de
vie, une modication de la vie affective intrafami-
liale, un risque de maltraitance des aidants. Les
conséquences économiques sont également im-
portantes : les dépenses de l’assurance maladie
pour les personnes âgées dépendantes seraient
de l’ordre de 20,9 milliard d’euros en 2011.
> Le CHD, un hôpital innovant
dans l’amélioration
de la prise en charge
des patients âgés en orthopédie
Depuis quelques années, les chirurgiens ortho-
pédistes ont décelé un besoin de prise en charge
adaptée pour ces patients âgés. Un partenariat
entre chirurgiens et gériatres s’est donc développé
progressivement sous différentes formes selon les
régions : consultations, avis spécialisés, création
des services dédiés…
Le service d’orthopédie du CHD VENDÉE est
doté d’un gériatre à temps plein depuis décembre
2013. Ce gériatre prend en charge les patients de
plus de 75 ans venus pour un motif traumatolo-
gique (fracture du col du fémur, fracture du bas-
sin, hématome sur chute…).
Les Drs Romain DECOURS et Martine MARTIN-
GRELLIER du pôle de gériatrie se partagent actuel-
lement cette mission.
> Objectif : adapter le mieux possible la prise en
charge chirurgicale, médicale et paramédicale à ces
patients fragiles, à risque de complications.
> Missions
Le gériatre :
- prend en charge les patients dès leur sortie du
bloc opératoire, voire avant si la chirurgie est re-
tardée et suit le patient tout le long de son séjour
en collaboration avec le chirurgien orthopédiste ;
- dépiste les pathologies fréquentes dans cette
population particulière : ostéoporose, troubles
des fonctions supérieures, polymédication… ;
- oriente les patients de la façon la plus adaptée
dans la lière gériatrique : retour à domicile avec
aides, transfert en service de soins de suite et
réadaptation, consultation gériatrique à distance,
hôpital de jour gériatrique mais aussi consulta-
tions spécialisées ;
- prend contact avec le médecin traitant ou la
structure d’accueil si besoin ;
- rédige un courrier de sortie résumant l’hospita-
lisation, les comptes rendus des examens com-
plémentaires et biologiques, le traitement à pour-
suivre ;
- propose une consultation d’évaluation géria-
trique à distance de l’hospitalisation ;
- sensibilise le personnel à la gériatrie par la
prise en charge globale de chacun des patients,
par des formations théoriques régulières, par la
mise en place de stratégies validées, spéciques
pour les pathologies et syndromes gériatriques
(par exemple : confusion aiguë, dénutrition, es-
carres..).
> Activité en 2014
320 patients traumatisés de plus 75 ans ont été sui-
vis par le gériatre.
Le bilan de fonctionnement à un an est globalement
positif concernant :
- la transmission des informations aux inrmières
pour les dossiers médicaux complexes ;
- la prise en charge globale et pas seulement de
la pathologie ;
- la prise en charge rapide des patients ;
- la communication avec les médecins traitants,
les familles, les autres structures d’hospitalisa-
tion pour améliorer les transferts ;
- la présence médicale quotidienne et perma-
nente dans le service pour une prise en charge
respectueuse et personnalisée de la personne
âgée.
> Projets
Depuis peu, des consultations pré-opératoires
pour les patients les plus fragiles (plus de 85 ans,
plus de 75 ans à la demande du chirurgien ou de
l’anesthésiste) sont mises en place pour les pa-
tients devant bénécier de la pose de prothèse de
hanche (chirurgie programmée), an de préparer au
mieux l’hospitalisation et d’éviter au maximum les
complications en particulier le syndrome confusion-
nel post opératoire.
Collaboration étroite avec le service de court séjour
de gériatrie qui va ouvrir prochainement.
> Conclusion
La présence permanente d’un gériatre dans le
service d’orthopédie du CHD est une avancée in-
déniable et innovante dans la région. Elle permet
une prise en charge optimale des patients âgés
dont la population s’accroit en nombre et en âge
chaque année en Vendée.
Contacts avec le gériatre :
Dr Martine MARTIN-GRELLIER
Chef du pôle médecine gériatrique
et SSR polyvalents et spécialisés
Nouvelles consultations
en pédiatrie
De nouvelles consultations ont peu à peu fait leur apparition au CHD
VENDÉE, répondant ainsi aux besoins de santé des enfants vendéens
et de leur famille. Ces consultations se déroulent au 2e étage du Bâtiment
T, au milieu des consultations de pédiatrie-néonatologie, tout à côté de
l’hôpital de jour et du secteur d’hospitalisation de pédiatrie. Il s’agit de :
> Consultation de génétique clinique, assurées par le Dr Bertrand
ISIDOR et le Dr Marie VINCENT, généticiens du CHU de Nantes. Elles
ont lieu un mardi et un vendredi par mois. Elles s’adressent bien sûr
aux enfants, mais aussi, de plus en plus, aux adultes atteints de pa-
thologie génétique. Il peut s’agir d’un avis consultatif demandé par un
autre spécialiste, du suivi de patients ayant une maladie connue, ou
d’une demande de conseil génétique en cas d’antécédents familiaux.
> Consultations d’onco-hématologie pédiatrique. Cette consulta-
tion conjointe est effectuée par le Dr Fanny RIALLAND, oncopédiatre
au CHU de Nantes, et le Dr Dominique MEDINGER, dans le cadre du
réseau Onco Pays de Loire. Elle permet d’assurer en proximité le suivi
des enfants atteints de leucémie et cancer en rémission, ou de maladie
hématologique bénigne. Elle a lieu l’après-midi du 2e mardi du mois.
> Consultation de médecine physique et réadaptation pédiatrique.
Depuis décembre 2014, le Dr Xavier COUTAND, médecin MPR spé-
cialisé pour les enfants, assure deux consultations hebdomadaires.
Toutes ces consultations ont d‘abord pour but d’apporter aux enfants
vendéens des consultations très spécialisées en proximité. D’autre part,
elles contribuent grandement à accroître nos compétences et à renforcer
les liens entre le service de pédiatrie-néonatologie et des services très
spécialisés, non disponibles au CHD VENDÉE.
Dr Pierre Blanchard
Chef de service de pédiatrie-néonatologie
Relais de friction
hydro-alcoolique des mains des
soignants sur une journée :
record du monde battu
au CHD VENDÉE le 5 mai 2015
Dans le cadre du dixième anniversaire de la campagne mondiale d’hy-
giène des mains « un soin propre est un soin plus sûr » organisée
par l’Organisation Mondiale de la Santé, le CHD VENDÉE s’est mobilisé
le 5 mai 2015 pour organiser un relais de friction hydro-alcoolique
des mains. Ce relais était réalisé par les personnels soignants médicaux
et paramédicaux appartenant à l’ensemble des services accueillant des
patients et des résidents sur les 3 sites du CHD VENDÉE (La Roche-sur-
Yon, Luçon et Montaigu).
Le record à battre était de 277 frictions réalisées par le personnel de l’hôpi-
tal Kowloon Tong de HONG-KONG en une journée datant du 5 mai 2014.
Le principe retenu par le relais au CHD était le suivant :
> Chaque soignant qui acceptait d’y participer réalisait une friction hy-
dro-alcoolique des mains selon une méthodologie rigoureuse (mains
sans bijoux, respect des 7 étapes de la technique, durée de friction
minimale 30 secondes), puis passait le acon de produit hydro-al-
coolique au soignant suivant et ainsi de suite.
> L’accompagnement était réalisé par le personnel médical et
paramédical du service d’hygiène hospitalière du CHD VENDÉE qui
a visité l’ensemble des services selon un parcours déni de 7H à 19H.
> L’ensemble du relais a été suivi par un Huissier de Justice asser-
menté.
Le record de HONG-KONG a été battu puisqu’un total de 463 frictions
a été réalisé et authentié par Huissier.
Ce nouveau record va faire l’objet d’une demande d’enregistrement dans
le Guinness Record.
Au-delà du chiffre réalisé, ce record est une preuve de l’engagement des
professionnels du CHD dans la prévention des infections nosocomiales et
de l’hygiène hospitalière.
Dr Guillaume KAC
Chef du service d’Hygiène Hospitalière
La recherche clinique
issue du CHD VENDÉE au cœur de la lutte
contre les infections nosocomiales
à travers le projet de recherche clinique
intitulé DEMETER
Après 2012 et le projet NUTRIREA 2 (portant sur l’évaluation des modalités d’ad-
ministration de la nutrition des patients sous assistance respiratoire en réanimation),
après 2013 et le projet HYPERION (portant sur l’évaluation de 2 cibles de température
corporelle dans les suites d’un arrêt cardio-circulatoire sur un rythme non choquable),
un nouveau projet de recherche clinique issu de la réexion de praticiens hos-
pitaliers du CHD VENDÉE a obtenu en 2014 un nancement à travers un appel à
projets organisé par le Ministère de la Santé et destiné à promouvoir des projets
de recherche clinique de grande ampleur. Il s’agit du projet intitulé DEMETER.
Le projet DEMETER est original à différents titres. Il s’agit avant tout d’une étude
de prévention, démarche inhabituelle dans notre
système de santé axé principalement sur le
soin curatif. Ainsi, le projet DEMETER va
évaluer la mise en place d’une stratégie
de prévention des pneumonies
bactériennes survenant pendant
le séjour des patients admis en
réanimation et dont l’état de santé
a nécessité la mise en place d’une
assistance respiratoire invasive via une
sonde d’intubation qui relie les poumons
du patient au respirateur articiel (ventilation
mécanique). Ces pneumonies acquises
sous ventilation mécanique (PAVM)
représentent la principale infection
associée aux soins dans les services
de réanimation. Les PAVM touchent,
en 2013, plus d’un patient sur
10 requérant une ventilation
mécanique. Leur survenue est
associée à une augmentation
de la morbidité (augmentation
de la durée de ventilation
mécanique, de la durée
du séjour hospitalier et une
moindre qualité de vie ultérieure
pour les patients ventilés plus de
21 jours) et de la consommation en
soins. La stratégie de prévention
évaluée dans le projet DEMETER
correspond à la mise en place
du drainage des sécrétions sous-
glottiques (DSS). Le principe du DSS
est de diminuer le passage de sécrétions
porteuses d’infection vers les poumons
normalement stériles.
La réalisation du drainage des sécrétions
sous-glottiques nécessite l’utilisation de sondes d’intubation spéciques dont l’ac-
quisition représente un surcoût initial (d’environ 15 € par sonde) indéniable. Dans le
contexte actuel de fortes contraintes nancières, ce surcoût qui peut paraître néglige-
able en comparaison des coûts liés à un séjour en réanimation, reste un véritable frein
dans la disponibilité des sondes d’intubation permettant la réalisation du DSS non
seulement au sein des services de réanimation mais aussi dans les unités de soins
susceptibles d’intuber les patients avant leur admission en réanimation (SAMU-SMUR,
urgences, bloc opératoire…). Ainsi, un des autres aspects originaux du projet DE-
METER est d’évaluer cette stratégie de prévention (le DSS) non seulement sur
l’efcacité clinique mais en mettant cet aspect fondamental en balance avec
les coûts liés aux dépenses de santé (principalement hospitalières) pendant
l’année suivant l’admission en réanimation. Le projet DEMETER rentre ainsi dans
le champ de l’évaluation médico-économique dont l’objectif est de déterminer les in-
terventions en santé les plus efcientes et d’apporter des éléments de réexion dans
la prise de décision publique.
Le projet DEMETER devrait débuter en novembre prochain et se terminer en novem-
bre 2018. Les résultats en seront connus courant 2019. S’ils s’avèrent positifs, la
diffusion du DSS au sein des services de réanimation pourrait représenter une réelle
avancée concernant la sécurité des patients requérant une ventilation mécanique :
moins d’infections nosocomiales, utilisation moindre d’antibiotiques, diminution de
la durée du séjour hospitalier et peut-être une meilleure qualité de vie des patients
survivants. En raison de la fréquence des PAVM, ces impacts potentiels pourraient
également participer au contrôle de l’émergence et de la diffusion des bactéries
multi-résistantes.
Docteur Jean-Claude LACHERADE
Service de réanimation polyvalente
Membre de la Commission d’Epidémiologie et de Recherche Clinique (CERC) de la
Société de Réanimation de Langue Française (SRLF)
32

Première naissance d’un bébé
issu d’une fécondation in vitro
au centre Procréalis à La Roche-sur-Yon
Le vendredi 27 mars 2015 est née Lilou, un peu plus de 10 mois après l’ouverture du centre
Procréalis à La Roche-sur-Yon.
Le centre d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) Procréalis est le fruit d’une collaboration de
trois acteurs de santé majeurs en Vendée : le Centre Hospitalier Départemental Vendée, la clinique
Saint-Charles et le laboratoire de biologie médicale Biorylis.
Les premières Fécondations In Vitro (FIV) y sont réalisées depuis juillet 2014. Les résultats sont très
encourageants avec 44% de chance de grossesse lorsqu’un embryon est transféré.
Procréalis s’est doté des dernières technologies en matière de biologie de la reproduction en
s’équipant d’un embryoscope qui permet le suivi en temps réel des embryons. Le centre vendéen est
le septième en France à s’équiper d’un tel matériau de pointe.
> Présentation du centre
Chaque structure apporte des moyens humains, matériels et immobiliers à travers un Groupement
de Coopération Sanitaire (GCS). Les locaux se situent dans la clinique Saint-Charles, 11 Bd René
Lévesque 85000 La Roche-sur-Yon.
Le centre fonctionne autour d’une autorisation clinique portée par la clinique Saint-Charles et une
autorisation biologique portée par le laboratoire Biorylis qui avait déjà une activité d’AMP mais limitée
à la prise en charge des inséminations articielles depuis 1998.
La création d’un centre AMP basé à La Roche-sur-Yon permet de compléter l’offre de soins
existante pour les couples vendéens. Elle vise à améliorer l’accès aux soins d’un point
de vue géographique, évitant les déplacements répétés vers les départements limitrophes
notamment.
Procréalis est une structure dédiée à l’AMP. Au même niveau, on retrouve l’activité clinique et le
laboratoire permettant ainsi des échanges constants et une communication clinico-biologique
optimale, indispensable à une prise en charge de qualité en AMP. Les locaux ont été conçus an de
faciliter ces échanges dans une atmosphère chaleureuse, calme et sereine.
Le centre a ouvert le 19 mai 2014 et est agréé pour les activités suivantes :
> préparation de sperme en vue d’insémination articielle ;
> fécondation in vitro sans micromanipulation ;
> fécondation in vitro avec micromanipulation ;
> conservation des embryons.
L’équipe est composée de 6 gynécologues, 2 biologistes, 2 inrmières, 3 secrétaires et 5 techniciennes
de laboratoire. Elle encadre aussi des internes qui sont en formation dans cette spécialité.
Pour optimiser le parcours de soin, un secrétariat unique centralise les rendez-vous pour les consul-
tations et les différents examens cliniques et biologiques (tél. : 02.51.44.10.60). Les couples peuvent
venir directement ou être adressés par leur gynécologue ou leur médecin traitant.
Cette plateforme multidisciplinaire permet aux couples qui le souhaitent une prise en charge com-
plète et optimale de leur désir d’enfant.
FLASH
> Approbation du Groupement
de Coopération Sanitaire « GCS BIOLOGIE 85 »
Par arrêté du 9 avril 2015, l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire a entériné la convention constitutive du
Groupement de Coopération Sanitaire « GCS BIOLOGIE 85 »
entre le CH de Fontenay le Comte, le CHD VENDÉE et le CH
Loire Vendée Océan. Il s’agit d’exploiter, pour le compte de ses
membres et pour répondre aux besoins de leurs patients, un
laboratoire de biologie médicale multi-établissements.
> Chirurgie ambulatoire
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90 CHD VENDEE
Objectif
201420132012
78,7% : c’est le taux de chirurgie ambulatoire pour le CHD
VENDÉE en 2014 pour 43 gestes marqueurs, contre 78,8% au
niveau départemental et 78% au niveau régional.
Il augmente de +5,1 points contre une hausse de +3,3 points
pour les établissements vendéens et +2,8 points pour les
établissements régionaux.
Ces données conrment la forte progression et l’accès en
bonne place de l’établissement au sein de la région.
> HéliSMUR
Comme les deux années passées, le deuxième HéliSMUR ré-
gional nancé par l’Agence Régionale de Santé, a repris son
positionnement estival en Vendée pour les quatre mois d’été.
Positionné au CHU d’Angers pendant le reste de l’année, il a
rejoint l’hélistation du site de La Roche-sur-Yon dès le lundi
1er juin au matin, et ce jusqu’au 30 septembre.
L’appareil mis à disposition par la société INAER est de marque
Eurocopter (EC135), de couleur jaune ; il peut transporter qua-
tre personnes en plus du patient. Il peut rejoindre n’importe
quel point du département en quelques minutes (maximum
20 mn pour Noirmoutier) et se poser soit sur une hélistation
aménagée, soit sur une zone plane et dégagée (terrain de
sport, plage, ...).
Il est opérationnel de 8H à 22H, 7 jours sur 7, sauf condi-
tions météos défavorables. Il doit cependant libérer l’hélista-
tion chaque soir pour permettre l’arrivée d’un autre appareil si
besoin, et de ce fait, il va se stationner tous les soirs à l’aéro-
drome des ajoncs.
Pour mémoire, il a effectué l’an passé 137 missions sur
la même période (dont 68 interventions primaires). Son dé-
clenchement, sous la responsabilité du SAMU 85, a permis de
réduire considérablement les délais d’interventions et de trans-
port retour, ainsi que le temps de mobilisation des équipes.
4
1
/
3
100%