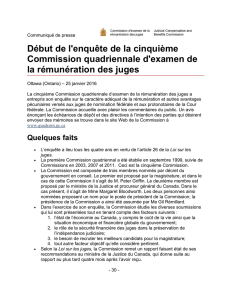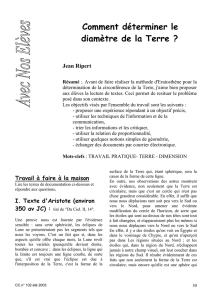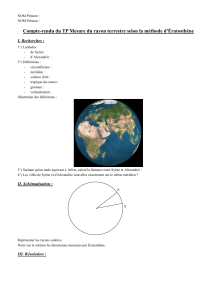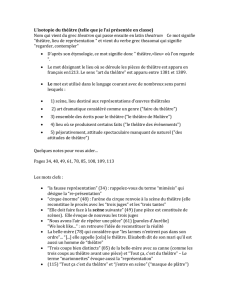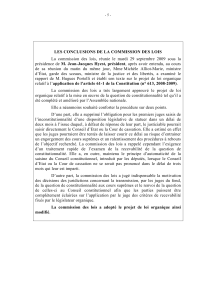SUR LE MEURTRE D`ÉRATOSTHÈNE Je donnerais

SUR LE MEURTRE D'ÉRATOSTHÈNE
Je donnerais beaucoup, Athéniens, pour que vous me jugiez, dans cette affaire, avec les sentiments que vous
auriez pour vous-mêmes, à ma place. Je suis sûr que si vous regardiez les maux d'autrui du même œil que les
vôtres, il n'est personne d'entre vous qui ne s'indignât de l'injure qu'on m'a faite ; pour de telles pratiques, vous
trouveriez tous les peines existantes trop légères.
Et vous ne seriez pas les seuls : on en jugerait ainsi dans toute la Grèce. Car c'est l'unique délit pour lequel,
dans tous les États, démocratiques et oligarchiques, la loi accorde aux faibles et aux puissants la même
vengeance ; sur ce point, grands et petits ont les mêmes droits ; tant cette injure est grave aux yeux de tous les
hommes ! Ainsi, sur la rigueur du châtiment, je pense que vous êtes tous du même avis, et que nul, parmi vous,
n'a assez peu de souci de la justice pour estimer que des actes aussi coupables méritent le pardon ou une peine
légère.
Maintenant, juges, j'ai à prouver qu'Ératosthène était bien l'amant de ma femme, qu'il l'avait séduite et qu'il
déshonorait mes enfants, qu'il s'est introduit dans ma maison pour m'outrager, qu'il n'existait jusque-là, entre lui
et moi, aucune inimitié, que je n'ai pas agi pour de l'argent, en vue de m'enrichir, et que je n'avais d'autre intérêt
que de me faire justice, conformément aux lois.
Je vais donc reprendre depuis ses débuts toute mon affaire ; je n'omettrai rien et je dirai la vérité : ma seule
chance de salut est de vous dire tout ce qui s'est passé, si je le puis.
Lorsque j'eus décidé de me marier, Athéniens, et que j'eus pris femme, voici quelle fut d'abord mon attitude :
évitant à la fois d'ennuyer ma femme et de lui laisser une liberté excessive, je la surveillais dans la mesure du
possible, et, comme de juste, j'avais l'œil sur elle. Mais, du jour où nous eûmes un enfant, je n'eus plus de
défiance, je lui confiai toutes mes affaires, estimant que nous étions maintenant unis par le plus fort des liens.
Dans les premiers temps, juges, c'était le modèle des femmes, ménagère adroite et économe, maîtresse de
maison accomplie. Mais je perdis ma mère, et cette mort a été la cause de tous mes malheurs. C'est en effet en
suivant ses funérailles que ma femme fut aperçue par Ératosthène, qui réussit, avec le temps, à la séduire : il
guetta l'esclave qui allait au marché, se mit en rapports avec sa maîtresse et la perdit. Il faut vous dire d'abord
(car ces détails mêmes sont nécessaires) que ma maisonnette a un étage ; la disposition y est la même en haut et
en bas, pour l'appartement des femmes et pour celui des hommes. Survint la naissance du petit, que sa mère
nourrissait. Chaque fois qu'il fallait le baigner, elle était obligée de descendre et risquait de tomber dans
l'escalier ; aussi habitais-je au premier étage et les femmes au rez-de-chaussée. C'était une habitude prise, et ma
femme allait ainsi à chaque instant se coucher près du petit pour lui donner le sein et l'empêcher de crier. Les
choses restèrent comme cela pendant longtemps sans jamais éveiller mes soupçons. Dans ma simplicité, je
croyais ma femme la plus sage de toute la ville.
A quelque temps de là, je revins de la campagne sans être attendu. Après le dîner, l'enfant était méchant et
criait : c'était la servante qui le tourmentait pour qu'il fît cette vie-là, car l'homme était dans la maison (j'ai tout
appris plus tard). Je dis à ma femme d'aller donner le sein au petit pour le faire taire. Elle ne voulait pas
d'abord : elle était, disait-elle, si contente de me voir revenu, depuis le temps. Mais je me fâchai et lui dis de
s'en aller. « Oui, répondit-elle, pour que tu restes à faire la cour à la petite esclave ; déjà, une fois que tu avais
bu, tu la serrais de près ». Moi, je me mets à rire ; elle, se lève, ferme la porte en s'en allant, comme pour
s'amuser, et tire la clef. Je n'y pris pas garde, et, sans le moindre soupçon, je m'endormis content, comme un
homme qui arrivait de la campagne. Un peu avant le jour, elle revint et ouvrit la chambre. Comme je lui
demandais pourquoi les portes avaient fait du bruit pendant la nuit, elle répondit que la lampe de l'enfant s'était
éteinte et qu'on avait été la rallumer chez les voisins. Je ne dis rien, croyant que c'était vrai. Il me sembla bien
qu'elle était fardée , trente jours à peine après la mort de son frère. Mais je ne fis encore aucune réflexion à ce
sujet et je m'en allai sans rien dire.
Puis, quelque temps se passa ; j'étais bien loin de me douter de mon malheur, quand, un jour, une vieille
m'aborde : elle m'était envoyée en secret par une femme mariée dont Ératosthène était l'amant (je l'ai su plus
tard). Furieuse contre lui et se jugeant offensée de ne plus recevoir aussi souvent ses visites, cette femme l'avait
fait surveiller et avait fini par savoir de quoi il retournait. La vieille me guette donc et m'accoste près de chez
moi. « Euphilétos, me dit-elle, ne va pas croire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas ; si je viens te
trouver, c'est que l'homme qui vous déshonore, ta femme et toi, est précisément notre ennemi. Prends l'esclave
qui va au marché et qui vous sert, et mets-la à la question, tu apprendras tout. C'est Ératosthène, du dème d'Oé,
le coupable. Ta femme d'ailleurs n'est pas la seule, il en a séduit bien d'autres : c'est son métier. »
Et sur ces mots, juges, elle s'éloigna. Tout de suite, je fus bouleversé ; toutes sortes de détails me revenaient à
l'esprit et j'étais plein de soupçon : je songeais qu'on m'avait enfermé dans ma chambre ; je me rappelais que les
portes de la rue et de la cour avaient fait du bruit cette nuit-là, ce qui ne s'était jamais produit, et que ma femme
m'avait paru fardée. Oui, tout cela me revenait à l'esprit, et j'étais plein de soupçon.

Rentré chez nous, j'ordonnai à la servante de m'accompagner au marché, et, je l'emmenai chez un de mes amis.
Là, je lui dis que j'étais au courant de tout ce qui se passait dans ma maison. « Tu as le choix entre deux partis,
ajoutai-je : être fouettée, jetée au moulin, réduite pour jamais à ce sort misérable, ou bien me dire la vérité, me
raconter tout, et, au lieu de te faire du mal, je te pardonnerai tes fautes. Ne mens pas, dis-moi tout franchement.
» Elle, de nier d'abord : je pouvais faire ce que je voulais, elle ne savait rien. Mais je prononçai le nom
d'Ératosthène. « C'est, lui dis-je, l'homme qui fréquente ma femme. » Alors, prise de frayeur à l'idée que je
savais tout exactement, elle tombe à mes genoux, et, m'ayant fait prendre l'engagement de ne lui faire aucun
mal, elle me dévoile tout : comment, après les funérailles, il l'avait abordée ; comment elle avait fini par lui
servir d'intermédiaire ; comment ma femme, avec le temps, s'était laissé séduire et comment on s'y prenait pour
le faire entrer ; comment enfin, aux Thesmophories, pendant que j'étais à la campagne, elle était allée au
sanctuaire, avec sa mère à lui. Bref, elle me raconte en détail tout ce qui s'était passé. Quand elle eut tout dit : «
Prends bien garde, repris je, que personne au monde n'apprenne rien de tout cela. Autrement, plus de promesses
qui tiennent. J'exige que tu m'aides à les prendre sur le fait. Ce ne sont pas des paroles qu'il me faut, mais la
preuve flagrante que tu dis la vérité. » Elle promit de le faire.
Là-dessus, quatre ou cinq jours s'écoulèrent... je l'établirai par de bonnes preuves. Mais je veux d'abord vous
raconter ce qui se passa le dernier jour. J'ai un ami intime qui s'appelle Sostrate. Après le coucher du soleil, je le
rencontre qui revenait de la campagne. Sachant qu'à pareille heure il ne trouverait plus rien chez lui, je l'invite à
venir souper avec moi. Nous arrivons à la maison, nous montons au premier et nous voilà à table. Il partit
quand il eut bien dîné, et moi, je me mets au lit. Ératosthène entre ; la servante me réveille aussitôt : « Il est là
», me dit-elle. Je la charge de veiller sur la porte, je descends sans bruit, je sors et je vais chez différents amis.
J'en trouvai quelques-uns chez eux ; les autres n'étaient pas à Athènes. J'emmenai avec moi le plus grand
nombre possible de ceux qui étaient là et me voilà en route. Nous prenons des torches à la boutique la plus
proche et nous entrons (la porte de la rue était ouverte et la servante à son poste). Ayant poussé la porte de la
chambre, les premiers entrés et moi, nous eûmes le temps de voir l'homme couché près de ma femme ; les
derniers le trouvèrent debout, tout nu, sur le lit.
Alors, juges, je le frappe, je le renverse, je lui ramène les deux mains derrière le dos, je les lui attache, et lui
demande pourquoi il a pénétré dans ma demeure pour m'outrager. Lui reconnaissait son crime. Il me priait, me
suppliait de ne pas le tuer et de n'exiger de lui que de l'argent. « Ce n'est pas moi qui vais te tuer, lui répondis-
je, mais la loi de la cité que tu as violée, que tu as fait passer après tes plaisirs, aimant mieux commettre une
faute aussi grave envers ma femme et mes enfants que d'obéir aux lois et de rester honnête. »
Ainsi, juges, cet homme a reçu le châtiment que les lois prescrivent pour de tels actes. Et qu'on ne dise pas,
comme mes accusateurs, qu'il avait été traîné de force de la rue dans la maison, ni qu'il s'était réfugié à mon
foyer. Est-ce possible, puisque, frappé dans la chambre même, il tomba sur le coup, que je lui liai les mains
derrière le dos, et qu'il y avait là tant de monde qu'il ne pouvait fuir, n'ayant d'ailleurs pas une arme, pas un
morceau de bois, rien pour se défendre contre ceux qui étaient entrés ?
Mais vous le savez, n'est-ce pas, juges, les gens qui n'ont pas le bon droit pour eux ne veulent pas reconnaître
que leurs ennemis disent la vérité. En revanche, ils recourent, eux, aux mensonges et aux artifices de ce genre
pour susciter la colère de l'auditoire contre ceux qui ont pour eux le droit. Lis donc d'abord la loi. Loi. Il ne
contestait pas, juges : il reconnaissait son crime ; il me suppliait instamment de ne pas le faire mourir, et il
m'offrait une réparation en argent ; mais je n'acceptai pas cette rançon ; j'estimai que la loi de la cité devait être
souveraine, et je lui fis subir la vengeance la plus juste à vos yeux, celle que vous avez édictée contre de pareils
coupables. Témoins, venez à la tribune déposer là-dessus. Témoins. Lis encore cette loi gravée sur la stèle de
l'Aréopage. Loi. Vous entendez, juges : le tribunal de l'Aréopage lui-même qui, comme au temps de nos
ancêtres, a aujourd'hui le privilège des affaires de meurtre, se voit interdire en termes formels de déclarer
meurtrier quiconque a surpris un homme en flagrant délit d'adultère avec sa femme et s'en est vengé comme je
l'ai fait.
Fermement convaincu que cette loi était juste quand il s'agit d'épouses légitimes, le législateur l'a même étendue
au cas des concubines, moins intéressantes pourtant. Evidemment, s'il y avait eu un châtiment plus fort que la
mort, il l'aurait appliqué au cas des femmes mariées ; mais, n'en pouvant imaginer de plus rigoureux, il décida
de prescrire la même peine, alors même qu'il s'agit de concubines. Lis-moi aussi cette loi. Loi. Vous entendez,
juges : en cas de viol commis sur la personne d'une femme ou d'un enfant libre, la composition sera portée au
double. S'il s'agit d'une des femmes dont on a le droit de tuer l'amant pris en flagrant délit, la peine est la même.
Ainsi, juges, pour ceux qui usent de violence, le législateur a été moins sévère que pour les séducteurs : ces
derniers, il les a condamnés à mort, les autres à une amende du double. Ceux qui accomplissent leur acte par la
force, a-t-il pensé, s'attirent la haine de leurs victimes : au contraire, les séducteurs corrompent leurs âmes, au
point que les femmes des autres leur appartiennent plus intimement qu'aux maris ; ils deviennent les maîtres de
toute la maison et on ne sait plus à qui sont les enfants, aux maris ou aux amants. Voilà pourquoi l'auteur de la
loi a établi contre eux la peine de mort.

Ainsi, les lois ne m'absolvent pas seulement de toute faute : elles m'ordonnaient de punir comme j'ai fait. A
vous de voir si leur autorité doit être respectée ou méprisée.
Pour moi, j'estime que, s'il y a des lois, dans toutes les cités, c'est pour qu'on y recoure dans les circonstances
embarrassantes, où l'on se demande ce qu'il faut faire. Or, dans un cas comme le mien, ce sont elles qui
engagent les victimes à se venger comme moi. Je vous demande d'être d'accord avec elles ; sinon, assurant ainsi
l'impunité à l'adultère, vous encouragerez les voleurs à se faire passer, eux aussi, pour des séducteurs. Ils
sauront en effet que, s'ils invoquent ce prétexte pour leur défense, s'ils prétendent qu'ils allaient à un rendez-
vous en pénétrant dans les maisons d'autrui, nul n'osera les toucher : car personne n'ignorera que les lois sur
l'adultère sont lettre morte, et qu'il faut craindre seulement votre vote, souverain arbitre dans toutes les affaires
de la cité.
Examinez maintenant, juges, les imputations de mes accusateurs : c'est moi qui, ce jour-là, aurais ordonné à la
servante d'aller chercher le jeune homme. Et d'abord, je pouvais me croire dans mon droit, en essayant par
n'importe quel moyen de prendre le séducteur de ma femme. Si je l'avais envoyé chercher lorsqu'il n'y avait eu
que des paroles échangées, sans aucun acte irréparable, j'aurais été coupable. Mais du moment que tout était
déjà consommé et qu'il était souvent entré dans ma maison, tous les moyens pour le perdre pouvaient me
sembler permis.
Aussi bien, sur ce point encore ils mentent : voici qui vous en convaincra sans peine. Je vous ai dit que Sostrate
était mon ami, que nous étions intimement liés, que, le rencontrant un soir qu'il rentrait de la campagne au
coucher du soleil, je remmenai dîner avec moi, et qu'il partit après avoir bien mangé. Or — j'attire votre
attention sur ce premier point — supposons que, cette nuit-là, j'aie voulu tendre un piège à Ératosthène : le
meilleur parti pour moi n'était-il pas de dîner moi-même dehors, au lieu d'amener chez moi un convive et
d'empêcher ainsi notre homme de pénétrer dans ma maison avec autant d'assurance ? Et puis, croyez-vous que
j'aurais laissé partir mon invité, restant seul et sans secours, au lieu de le retenir pour m'aider à me venger de
l'adultère ? Ne vous semble-t-il pas encore que j'aurais convoqué mes amis dans la journée, que je leur aurais
demandé de se réunir chez l'un d'entre eux, tout près de chez moi, au lieu d'attendre l'alerte pour courir dans la
nuit de droite et de gauche, sans savoir qui je trouverais chez lui et qui était absent ? J'allai ainsi chez
Harmodios et tel autre qui, je l'ignorais, étaient en voyage ; d'autres n'étaient pas chez eux ; je ramenai donc
ceux que je pus. Si j'avais prévu la chose, n'aurais-je pas, dites-moi, apposté des serviteurs ? N'aurais-je pas
donné le mot d'ordre à mes amis ? C'était pourtant le meilleur moyen d'entrer chez moi sans danger (savais-je
en effet si lui aussi n'avait pas une arme ?) et de m'entourer d'un grand nombre de témoins au moment de me
venger. Mais, réellement, je ne savais rien de ce qui allait se passer cette nuit-là, et c'est pourquoi j'amenai qui
je pus. Témoins, venez à la tribune déposer sur ces faits. Témoins. Vous avez entendu les témoins. Et
maintenant, demandez-vous dans votre for intérieur s'il y eut jamais entre Ératosthène et moi d'autre sujet
d'inimitié : vous n'en trouverez pas. Il ne m'avait pas, comme un sycophante, intenté d'action publique : il
n'avait pas essayé de me faire exclure de la cité ; nous n'étions pas en procès ; il ne savait pas sur mon compte
de vilaine histoire, et la peur d'être trahi ne pouvait me pousser à me débarrasser de lui ; je n'espérais pas, en
accomplissant mon acte, en retirer de l'argent (il y a en effet des assassinats qui n'ont pas d'autre mobile). Quant
à une dispute provoquée par des insultes, l'ivresse ou une contestation quelconque, il ne peut pas y en avoir eu,
puisque je n'avais jamais vu cet homme que cette nuit-là. Dans quel but me serais-je donc exposé à de tels
risques, s'il ne s'était rendu coupable envers moi de l'offense la plus grave ? Aurais-je aussi convoqué tant de
témoins pour commettre ce crime, quand je pouvais, si vraiment j'avais voulu le tuer injustement, ne mettre
personne dans mon secret ?
Ainsi, juges, ce n'est pas seulement dans mon intérêt personnel que j'ai fait justice, mais, j'en ai le sentiment,
dans l'intérêt de la cité tout entière. Les hommes qui se livrent à de semblables pratiques, voyant le prix dont la
loi fait payer ce genre de fautes, seront moins disposés à les commettre, s'ils trouvent chez vous la même
sévérité.
Autrement, autant vaut abolir les lois existantes et en établir d'autres réservant les châtiments aux maris qui
prétendent garder leurs femmes, et assurant une complète impunité aux galants coupables. Ce serait au moins
beaucoup plus juste ; les lois ne tendraient pas aux citoyens un véritable piège. D'un côté, en effet, elles les
invitent, s'ils surprennent un amant avec leur femme, à se venger comme ils l'entendent ; mais, d'autre part,
elles les exposent, quoique victimes, à des procès plus redoutables pour eux que pour ces gens qui, au mépris de
la loi, déshonorent les femmes d'autrui.
De fait, si je risque moi-même de perdre aujourd'hui ma vie, ma fortune et tout le reste, c'est pour avoir obéi
aux lois de la cité.
Lysias, Sur le meurtre d'Ératosthène, traduction de Gernet et Bizos, 1924 (en ligne à l’adresse suivante :
http://hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/Lysias_Discours01/lecture/1.htm )
1
/
3
100%