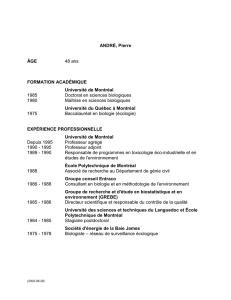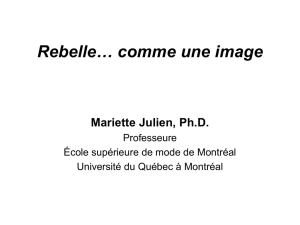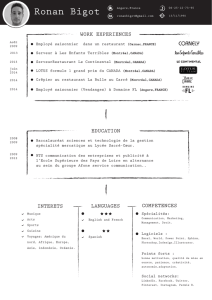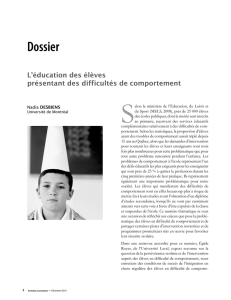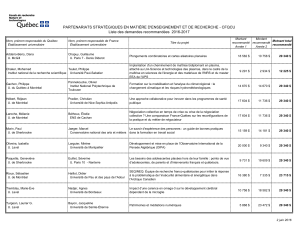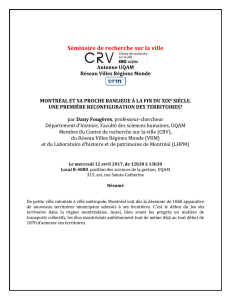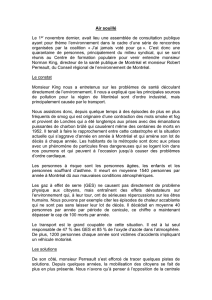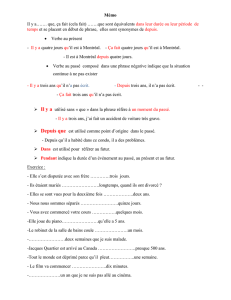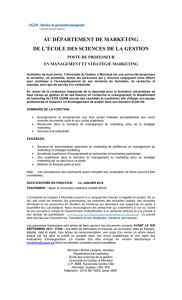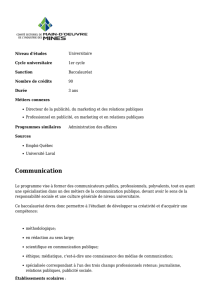Les enjeux du développement de la région métropolitaine de

Les enjeux du développement de la région métropolitaine de
Montréal
Par Marcel Côté, associé fondateur, Groupe SECOR
Mise en contexte
Au cours des 150 dernières années Montréal a pu accéder au rang de métropole influente en
Amérique du Nord. C’est par sa position stratégique, sa force d’innovation et son arrimage à un réseau
de transport développé que Montréal a pu s’affirmer comme le cœur économique du Canada.
Cependant, cette situation ne perdurera pas dans le temps et la ville aux Mille Clochers sera reléguée
en deuxième position face à la progression de Toronto.
La région de Montréal connaît depuis des décennies un problème récurrent qui affecte
réellement le potentiel de croissance de la métropole. En effet, la région montréalaise est aux prises
avec l’enjeu fondamental de la production insuffisante de richesse. Cette problématique contrecarre les
possibilités de développement et de croissance que devrait connaître une métropole de cette taille.
Cette situation s’illustre par le fait que la région de Montréal se retrouve en queue de peloton en
Amérique du Nord en terme de richesse. Comprendre la situation stratégique structurelle de la
métropole permettra de cerner ses faiblesses et ses potentiels. En fait, en contrôlant la pratique
économique de la région montréalaise, les autorités seraient à même de se pencher sur d’autres
problématiques qui affectent la santé économique, sociale et culturelle de la région métropolitaine.
Diagnostic d’une métropole
En termes de taille, la région métropolitaine de Montréal se situe en seizième place en
Amérique du Nord avec ses 3,6 millions d’habitants. Par sa population, la région montréalaise se
retrouve en seconde place au Canada. Cette situation devrait rester inchangée au cours des 10 à 15
prochaines années. Or, en terme de marché, elle se retrouve à siéger dans une position bien inférieure.
Ceci s’explique par la faiblesse du revenu per capita de ses habitants.
Montréal s’inscrit dans
la situation des villes de la côte
est américaine, soit les grandes
villes centenaires. Par ce fait, la
métropole se situe dans la même
situation que des villes comme
Boston, Philadelphie ou
Baltimore, soit une augmentation
très faible de sa population,
moins de 1 % de croissance de
population. Or, à la différence de
celles-ci, Montréal n’arrive pas
à hausser le revenu per capita de
ses habitants dans les mêmes
taux que ses consoeurs. En fait, la métropole tout en restant en croissance, demeure au ralenti face aux
grandes villes américaines du continent. Par contre, fait intéressant, Montréal connaît un
développement équivalent à celui de Toronto mis à part le haut taux de croissance démographique de
cette dernière. Somme toute, Montréal continue d’avoir le plus bas taux par revenu per capita de
l’ensemble des grandes villes canadiennes et un des niveaux les plus bas en Amérique.
En fait, de nombreux indicateurs démontrent la perte de vitesse en terme de croissance de la
métropole québécoise vis-à-vis des autres grandes villes canadiennes. Par exemple, Toronto, avec
seulement 40 % de plus de population, possède deux fois plus de sièges sociaux d’affaires et deux fois

plus d’espaces à bureaux. Ces faits complétés par une immigration 4 fois plus importante sont des
facteurs décisifs pour l’avenir d’une ville. Ces indicateurs témoignent des problèmes structurels que
connaît la ville. La combinaison de la faible localisation de sièges sociaux et une immigration aussi
timide illustrent l’état de l’attractivité de la capitale économique de la province de Québec. Ainsi, tous
ces éléments combinés désavantagent la métropole et se posent dans la productivité des citoyens de la
région métropolitaine montréalaise. Dans la période de 2002 à 2007, la productivité, par heure
travaillée, de Montréal a diminué de 0,2 %.
Ces facteurs témoignent de l’un des problèmes fondamentaux que connaît Montréal depuis
près de 20 ans, soit sa faible productivité. Dans ce domaine, la métropole se situe quasiment à la
traîne en Amérique du Nord. Plus précisément, elle se situe à la 29e place sur un palmarès de 30 villes,
juste avant Riverside… une banlieue de Los Angeles.
Par contre, il est admis que la région a réussi à légèrement améliorer son sort au cours des
années, notamment en diminuant son taux de chômage. En effet, celui-ci est dorénavant plus bas que
celui d’une ville comme Toronto. Cette situation permet d’affirmer que la ville a réussi à améliorer la
situation de son marché du travail. Cependant, cette situation ne suffit pas à produire un phénomène
d’attractivité. Ceci peut se confirmer par un facteur clé, soit la hausse des prix des logements. Cet
indicatif leur permet de témoigner de la demande pour le sol que la ville subit. Donc, si le prix par
mètre carré augmente faiblement, il en résulte nécessairement une demande faible, ce qui est
sensiblement le cas de Montréal.
Pronostic d’une situation
L’explication classique de cette situation reviendrait à la base économique moins dynamique
de la région face à ses concurrents. En effet, Montréal se retrouve à être le lien central d’un des
hinterlands les plus pauvres du pays, soit la province du Québec. Ceci expliquerait la perte de
principaux centres d’affaires du Canada.
À ce premier problème s’ajoute l’enjeu primordial de la métropole, soit celui de l’éducation.
En effet, normalement, on considère Montréal comme une capitale du savoir et une ville d’étudiants
avec ses nombreux centres universitaires, mais dans les faits, la métropole connaît un des taux de
scolarité les plus bas en Amérique du Nord. Dans un contexte de productivité, c’est un élément
essentiel pour assurer à un milieu les outils nécessaires pour se développer. En effet, une population
instruite est à même de connaître les techniques et les processus pour produire efficacement et
rapidement des biens tangibles ou des services.
À ces éléments s’ajoute une immigration faible vue la taille de la métropole. L’immigration est
incontestablement un élément incontournable à la productivité d’une ville puisque ces nouveaux
arrivants amènent avec eux un ensemble de savoirs et de techniques potentiellement utiles à
l’émancipation de la région en termes de rendement de temps ou d’innovations scientifiques,
bureautiques ou manufacturières. Avec la situation présentement en cours au Québec, soit le problème
de la reconnaissance des acquis de ces populations, la région ne peut tirer au maximum les bénéfices
que cette tranche de la population pourrait apporter à la société.
Enfin, la région montréalaise est affectée par un facteur important qui est sa singularité
linguistique. Celle-ci représente un coût inhérent à Montréal au niveau des investissements au sein de
l’Amérique du Nord anglaise puisqu’elle rebute à un nombre important de compagnies. La barrière de
la langue continue après des décennies d’efforts de constituer un frein au développement économique
de la métropole au sein du continent. Les entreprises sont toujours aussi frileuses à venir faire des
affaires dans une région largement dominée par la langue française.
En somme, on observe un indice de globalisation assez faible. Cet indicateur illustre les liens
qu’entretient une région avec le reste du monde. Celui de Montréal se situe au 86e rang selon le GaWC

(Toronto se situe au 15e rang). Ceci s’explique par l’ensemble des facteurs, subséquemment
mentionnés, accablant la capitale économique du Québec d’un manque de lien avec l’extérieur.
Perspectives et avenir
Cependant, malgré tous ces éléments défavorables à Montréal, il faut constater que la
métropole parvient à tirer son épingle du jeu en ce qui a trait au développement de son propre marché
du travail. En effet, certains signes permettent de percevoir la création d’une toute nouvelle économie,
celle du savoir.
Les chiffres le
confirment, la vieille économie
manufacturière montréalaise
qui est présentement en déclin
se renouvelle vers de nouveaux
domaines. Ces secteurs se
situent dans les hautes
technologies comme
l’aérospatiale, les technologies
des télécommunications, des
sciences de la vie, de la chimie,
etc. Cependant, il est à noter
que le manufacturier de haute
technologie plafonne en termes
de création d’emplois. Ceci
pourrait tirer sa source du fait
que la ville a su plus rapidement que ses compétitrices tirer profit de ces créneaux spécialisés et
entreprendre la mise en place d’un marché des hautes technologies. Ceci s’illustre par l’importance de
ce marché au sein de l’économie de Montréal. Le secteur manufacturier de haute technologie constitue
2.7 % de l’ensemble des emplois comparativement à seulement 1.9 % pour Toronto.
Par la suite, un
autre élément
encourageant se dessine
pour la métropole, soit
celui de la progression
constante et importante du
domaine des services de
haute technologie. En
effet, Montréal se situe,
comme l’ensemble des
grandes villes
canadiennes, un essor de
son domaine de service high-tech. Sachant que les services de haute technologie se localisent
relativement dans des milieux innovants et prospères, ceci témoigne du changement de cap qui
s’opère au sein de la ville de Montréal. Ce domaine fournit actuellement près de 4,5 % des emplois
dans la métropole, un niveau comparable à celui observé dans les autres grandes métropoles
canadiennes. Cependant, il est à noter qu’il y a quelques années Montréal figurait comme le leader
dans ce type d’industries et que présentement elle se fait dépasser en nombre absolu d’emplois par la
ville Reine, Toronto.
Cependant, dans l’ensemble, la ville de Montréal se retrouve dans une position relativement
acceptable en Amérique du Nord en ce qui a trait à l’ensemble des secteurs de hautes technologies.

En effet, la métropole se situe au 8e rang comme ville manufacturière high-tech et au 6e rang dans la
concentration des emplois de services de haute technologie. Cette situation engendre au sein de la
métropole québécoise une réelle intensité dans le domaine des hautes technologies en regard à
l’importante concentration des emplois au sein de cette région. Cet indicateur abonde dans le sens du
renouvellement de la base économique de la ville, puisque le générateur de toute cette effervescence
repose sur la recherche et le développement de nouvelles technologies qui elles-mêmes se modifient
au cours des années. Donc, une ville, qui conserve son intensité dans ce domaine, témoigne d’un
continuel renouvellement de sa base technologique. En chiffres, ce domaine équivaut à près de
111 000 emplois dans la région montréalaise répartis principalement dans les domaines des sciences
de la vie, de l’aérospatial et des technologies des communications.
Un autre secteur ayant un fort potentiel de développement est incontestablement l’industrie
culturelle. Montréal se retrouve à être, depuis quelques années, un milieu très riche pour la création de
tous genres. Ceci peut se comprendre par deux facteurs clés :
• La rencontre de divers courants culturels stimulant la créativité
• Des investissements élevés en production française
La rencontre de différents courants culturels s’explique en partie par la langue française
prédominante. En effet, puisque cette langue prédomine dans la région montréalaise, ceci permet de
garder une certaine distance face à la culture américaine. Cette situation permet à la culture québécoise
de s’émanciper sans être submergée par l’exposition anglo-saxonne. Cette immunité linguistique a
fourni les bases nécessaires pour conserver et développer une culture typiquement québécoise. Cette
même situation favorise l’émancipation de cultures étrangères sur le territoire de la province en
laissant une fenêtre de développement au sein de la ville. Ceci permet un choc des idées entre diverses
conceptions artistiques provenant de milieux bien différents. Cette situation est idéale pour un créateur
qui peut dans un même endroit s’approvisionner dans un large spectre d’idéologies et de conceptions
bien différentes les unes des autres.
Cette immunité linguistique promulguée par la langue française a favorisé l’apparition de toute
une industrie de production artistique. En effet, le besoin de produire ses propres produits culturels
découle de cette rétention linguistique empêchant la complète submersion par la culture américaine.
En produisant leur propre culture, ceci favorise l’économie artistique dans des domaines aussi variés
que le cinéma, la musique, la télévision, l’écriture, etc. Par contre, leurs produits ne sont conçus que
pour des marchés locaux. Le système permet de produire beaucoup de biens culturels mais ne possède
pas les caractéristiques nécessaires à leur exportation vers de nouveaux marchés.
Un autre domaine excessivement vigoureux dans cette région est celui de l’éducation. Avec
ses 175 000 universitaires, Montréal se situe dans une position enviable. Ses 34 000 étudiants aux
études supérieures (maîtrise et doctorat) lui confèrent la seconde place en termes d’importance en
Amérique du Nord. Ceci se traduit par une importance toute particulière en ce qui a trait à la
recherche. En effet, Montréal est la ville au Canada où les investissements en R&D sont les plus
importants. Cependant, cette situation tend à disparaître au profit de Toronto qui pourrait dépasser
cette métropole sous peu comme ville numéro #1 en recherche au Canada. Ceci n’est pas l’idéal
puisque ceci pourrait faire perdre les meilleurs chercheurs de Montréal qui seraient attirés vers les
Universités torontoises ayant de plus importants budgets de recherche.

Les enjeux de région métropolitaine de Montréal
L’éducation
Depuis la décision par le gouvernement du Québec de moins soutenir financièrement les
Universités mais bien plus les élèves par des prêts et une diminution de leur coût de scolarisation,
l’écart entre les sommes versées aux Universités québécoises et celles du reste du Canada s’est creusé
par une différence de l’ordre de 15 %. Ce manque de financement ne peut qu’affecter la recherche
auprès de ces institutions d’enseignement en les rendant moins attractives pour les chercheurs. Or,
pour une ville qui possède le plus de centres de recherche au Canada, cette situation est dramatique et
pourrait affecter les perspectives d’avenir de Montréal.
En fait, la décision
du gouvernement de
financer en priorité les
étudiants au lieu des
établissements
d’enseignement va à
l’encontre des résultats de
nombreuses recherches. En
effet, une corrélation
négative entre les frais de
scolarité et le nombre
d’étudiants peut être développée puisque les données entre les régions nous indiquent qu’il n’y a pas
de lien entre le fait de subventionner l’accessibilité aux études et le nombre d’étudiants entrants. C’est
ce qui prédomine actuellement dans la métropole québécoise. En effet, celle-ci possède l’un des
niveaux de diplomation secondaire et universitaire les plus bas en Amérique pour une grande ville.
Ceci affecte inévitablement la productivité puisqu’une grande majorité d’individus n’accède pas aux
études techniques et universitaires permettant de développer les capacités génératrices de plus-value.
Comparativement, Montréal possède un taux de diplomation universitaire de 26 % contre 33
% à Toronto et 31 % à Vancouver. Ceci pourrait tirer sa source du retard contracté durant la période
précédent la Révolution tranquille. En effet, les villes du Québec avaient un retard important au niveau
de la scolarité comparativement au reste du Canada. Cette situation fut inversée avec la Révolution
tranquille mais pourrait continuer à conserver une trace sur cette société expliquant ce retard en la
matière.
Cependant, sachant qu’une seule année de plus de scolarité permet en moyenne de développer
de 2,8 à 3,2 % de plus en productivité, en rendant les travailleurs plus habiles, en leur inculquant de
meilleures techniques, en développant de bonnes facultés de raisonnement, en leur permettant de
posséder une meilleure capacité analytique, etc. les autorités d’une ville devraient davantage se
pencher sur l’enjeu de l’éducation de leur population dans une perspective économique. En fait, les
retards contractés en éducation minent les possibilités de croissance de la métropole.
Néanmoins, il faut comprendre que ce n’est pas réellement l’action de la formation ou de la
recherche qui engendre un réel développement économique. En effet, le poids des études universitaires
sur l’économie ne contribue qu’à un faible 0,6% comme valeur ajoutée au PIB. Le véritable apport se
situe plutôt dans les résultats de la formation. Ceux-ci permettent de développer une plus grande
efficacité et une efficience accrue de la part des travailleurs. Ceci dans le contexte du travail permet
d’engendrer des profits substantiels et accroit la productivité de la région. Donc, tant que la question
de la scolarisation des citoyens ne sera pas réglée, la métropole subira des manques de croissance
dus à la faiblesse des ressources humaines.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%