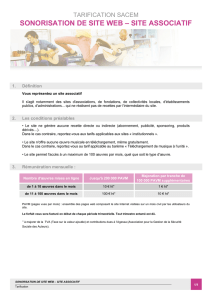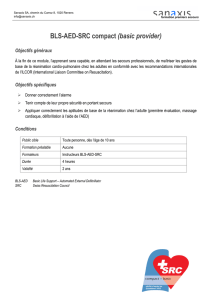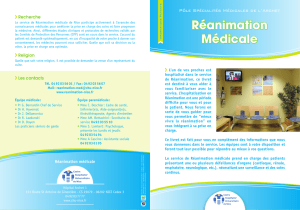Infections nosocomiales (2)

Réanimation (2012) 22:S210-S213
DOI 10.1007/s13546-012-0597-z
SESSION POSTER / Poster session MÉDECIN
SP236
Prévalence des colonisations à bactéries multirésistantes
à l’admission des patients du groupement
médicochirurgical de l’hôpital militaire international
de KaIA, Afghanistan
J.V. Schaal1, P. Pasquier2, H. Delacour3, A. Jarrassier2, S. Mérat2
1Centre de traitement des brûlés,
hôpital d’instruction des armées Percy, Clamart, France
2Service de réanimation médicochirurgicale, HIA Bégin,
Saint-Mandé, France
3Laboratoire de microbiologie, HIA Bégin, Saint-Mandé, France
Introduction : Le groupement médicochirurgical (GMC) de KaIA
(Kaboul International Airport) est chargé d’accueillir les blessés des
forces de la coalition provenant des zones de guerre en Afghanistan,
mais également des civils et militaires afghans. La présence de bac-
téries multirésistantes (BMR) est connue pour compliquer les soins
des blessés de guerre. Le principal mode de diffusion des BMR est
l’acquisition nosocomiale (transmission croisée, pression de sélection,
pression de colonisation). Des données récentes suggèrent un taux
de prévalence de BMR important à l’admission des patients dans les
hôpitaux militaires en zone de guerre. L’objectif de cette étude est de
rapporter la prévalence du portage de BMR à l’admission des patients
dans le service de réanimation du GMC KaIA (rôle 3) dans le cadre des
opérations de l’OTAN.
Patients et méthodes : Dans le service de réanimation du GMC fran-
çais de KaIA (six lits de réanimation, quatre lits de déchoquage), des
prélèvements microbiologiques de dépistage de BMR ont été réalisés à
l’admission des patients entre le 12 juillet et le 30 septembre 2012. Ces
prélèvements consistaient en un écouvillonnage nasal à la recherche de
Staphyloccocus aureus résistant à la méticilline (SARM) et rectal à la
recherche de bactéries productrices de bêtalactamase à spectre élargi
(BBLSE). Un patient était dit colonisé si le dépistage effectué revenait
positif. Les données démographiques, durées de séjour, hospitalisa-
tions antérieures, types de bactéries identifiées ont été reportées. Les
variables qualitatives sont exprimées en nombre et en pourcentage.
Les valeurs continues sont exprimées en valeur moyenne ± écart-type.
Les comparaisons sont réalisées à l’aide du test de Mann-Whitney.
Résultats : Soixante-trois patients ont été admis en réanimation pendant
la période d’inclusion (80 jours). La durée de séjour moyenne était de
3 ± 3 jours [1–18], l’âge moyen de 25 ± 147 [2–62] ; 13 patients (21 %)
étaient âgés de moins de 15 ans. Les patients étaient hospitalisés pour
traumatologie et blessures de guerre (74 %), traumatologie non liée à
la guerre (8 %), pathologies médicales (10 %), période postopératoire
(8 %). Les patients étaient afghans (92 %) ou occidentaux (8 %). Trois
modes d’admission ont été identifiés : dix patients (16 %) étaient hos-
pitalisés directement en réanimation, 12 patients (19 %) étaient trans-
férés depuis un autre hôpital ou un service de KaIA, 39 patients (62 %)
ont été transférés depuis une structure médicochirurgicale de rôle 2.
Pour les deux derniers modes d’admission, les durées d’hospitalisation
antérieures étaient respectivement 14 ± 28 jours et 8 ± 6 heures. Les
prélèvements ont été réalisés systématiquement sauf chez huit patients
(13 %). Le taux de colonisation à BBLSE à l’admission était de 43 %
(23 patients). Les souches identifiées étaient Escherichia coli (22
patients), Klebsiella pneumoniae (un patient), Acinetobacter baumanii
(un patient). Un patient était colonisé à E. coli et à K. pneumoniae
simultanément. Aucun SARM n’a été isolé. Parmi les 23 patients colo-
nisés, trois patients (13 %) étaient hospitalisés directement en réani-
mation, 16 patients (70 %) étaient transférés depuis une structure de
rôle 2 (durée de séjour 8 ± 7 heures), et quatre patients (17 %) étaient
transférés depuis un autre hôpital ou un service de KaIA (durée de
séjour 31 ± 40 jours). Parmi les patients transférés depuis une structure
de rôle 2, il n’y avait pas de différence de durée de séjour entre les
patients colonisés ou pas : 8 ± 7 vs 9 ± 6 heures (p = 0,5 — test de
Mann-Whitney).
Conclusion : Dans cette étude, les taux de colonisations de BBLSE
apparaissent élevés. Le dépistage des BMR est indispensable chez les
patients hospitalisés sur le théâtre d’opérations afghan afin de maîtriser
la diffusion des BMR, en prévenant les transmissions croisées (pré-
cautions standard) et en optimisant la prescription des antibiotiques
(pression de sélection). Les mesures d’hygiène ont déjà été renforcées
à l’hôpital militaire international de KaIA et l’étude de l’impact du
portage de BMR chez ces patients est en cours.
Bibliographie
1. Hospenthal DR, Crouch HK, English JF, et al (2011) Multidrug-
resistant bacterial colonization of combat-injured personnel at
admission to medical centers after evacuation from Afghanistan
and Iraq. J Trauma 71(1 Suppl):S52–S7
2. Whitman TJ (2007) Infection control challenges related to war
wound infections in the ICU setting. J Trauma 62(6 Suppl):S53
SP237
PAVM à Acinetobacter baumanii :
prévalence et profil de résistance
M. Elkhayari, I. Chaibi, M.O. Dilai, A. Ziadi, A. Hachimi,
M.A. Samkaoui
Service de réanimation polyvalente, CHU Mohammed-VI Marrakech,
Marrakech, Maroc
Introduction : Acinetobacter baumanii est un agent pathogène oppor-
tuniste qui émerge ces dernières décennies, sa capacité à acquérir des
résistances s’ajoute à un fort potentiel épidémique intrahospitalier.
Ce qui en fait l’agent de prédilection des infections nosocomiales,
notamment les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique
(PAVM). Le but de note travail est d’étudier l’évolution de la préva-
lence des pneumopathies nosocomiales à A. baumanii et leur profil de
résistance ces deux dernières années.
Infections nosocomiales (2)
Nosocomial infections (2)
© SRLF et Springer-Verlag France 2012

Réanimation (2012) 22:S210-S213 S211
Patients et méthodes : On a mené une étude rétrospective sur une
période de 24 mois (novembre 2010–octobre 2012), dans un service
de réanimation polyvalente au CHU de Marrakech. Tous les patients
admis durant la période d’étude ont été observés, les patients inclus
sont ceux ayant présenté une PAVM définie par un infiltrat radiolo-
gique nouveau et persistant, au moins un signe clinique ou biologique
d’infection (température ≥ 38,5 ou ≤ 36,5, hyperleucocytose, throm-
bopénie, CRP élevée), des sécrétions purulentes et un germe retrouvé
au PDP. Les patients avec PDP négatif ont été exclus de l’étude. Les
paramètres démographiques, cliniques, biologiques, microbiologiques
et pronostiques ont été relevés et analysés.
Résultats : Durant la période d’étude, 654 patients ont été admis, 90
ont présenté une PAVM, soit 14,5 %. 21,4 % des PDP étaient positifs.
L’A. baumanii était présent chez 62 patients, soit 69 %. Les autres
germes retrouvés étaient Pseudomonas aeruginosa (35,6 %), Kleb-
siella pneumoniae (16,7 %), les entérocoques (20 %) et le staphylo-
coque (14,4 %). L’âge moyen des patients ayant présenté une PAVM
était de 38,32 ± 18 ans, 89,1 % étaient de sexe masculin, la durée
moyenne de séjour était de 24 ± 15 jours. La durée moyenne de ven-
tilation mécanique était de 22,2 ± 10 jours. Une trachéotomie a été
réalisée dans 23,3 % des cas. Tous les patients ont reçu une antibio-
thérapie probabiliste puis adaptée par la suite en fonction de l’anti-
biogramme. La PNAVM était tardive dans 66,7 % des cas. Parmi les
motifs d’admission, la pathologie traumatique était de 67,8 %, suivie
des pathologies médicales (21,1 %), postopératoires (6,7 %) et toxi-
ques (3,6 %). La mortalité globale était de 64,4 %. Parmi les patients
ayant eu une PAVM à A. baumanii, on a noté une prédominance mas-
culine 79 %, l’âge moyen était de 37 ± 15 ans, une durée moyenne de
séjour 25,7 ± 14 jours. La durée moyenne de ventilation mécanique
était de 23,4 ± 12 jours. La trachéotomie a été réalisée dans 32,3 %
des cas, tous les patients ont reçu une antibiothérapie probabiliste. La
mortalité était de 74 %. Parmi les complications retrouvées, le choc
septique était de 48,4 %, les troubles de la coagulation (9,7 %), l’insuf-
fisance rénale (6,5 %) et le SDRA (1,6 %). Le profil de résistance de
l’A. baumanii dans notre étude était comme suit : 18,2 % résistants à la
colistine, l’amikacine (55,6 %), le sulfaméthoxazole (51,5 %), l’imipé-
nème (66,7 %), la teicoplanine (69,8 %), la fluoroquinolone (75,6 %),
les céphalosporines 3G (88,9 %).
Conclusion : L’incidence des PAVM à A. baumanii est plus élevée
dans notre étude par rapport à la littérature. Les taux de résistance de
l’A. baumanii restent assez élevés avec augmentation de la consom-
mation des antibiotiques. Il nous paraît donc important de souligner
l’intérêt de poursuivre une surveillance épidémiologique prospective
et continue de l’infection nosocomiale à A. baumanii en réanimation
afin d’évaluer les mesures mises en place dans le but de diminuer
l’incidence des PAVM.
SP238
Pneumopathies nosocomiales à Acinetobacter baumanii :
facteurs de risque et profil de sensibilité
dans un hôpital universitaire marocain
Y. Qamouss1, L. Arsalane2, M. Zoubir3, M. Boughalem3
1Réanimation postopératoire, hôpital militaire Avicenne,
Marrakech, Maroc
2Bactériologie–hygiène, hôpital militaire Avicenne, Marrakech, Maroc
3Réanimation, hôpital militaire Avicenne, Marrakech, Maroc
Introduction : Acinetobacter baumanii (AB) est un agent pathogène res-
ponsable d’infections nosocomiales en milieu de réanimation avec une
sensibilité de plus en plus réduite aux antibiotiques et une mortalité éle-
vée. Le but de cette étude est d’étudier les facteurs de risque d’acquisition
de ce germe ainsi que son profil de sensibilité dans notre contexte.
Matériels et méthodes : Étude rétrospective sur deux ans (janvier
2009–janvier 2011), menée au service de réanimation de l’hôpital
militaire Avicenne de Marrakech, avec inclusion de tous les patients
ayant développé une pneumopathie acquise sous ventilation mécani-
que (PAVM) à AB.
Résultats : Trois cent quarante-deux patients ont été admis en milieu
de réanimation durant cette période dont 64 % (220) ont été ventilés
plus de 48 heures, 32 patients ont développé une PAVM dont l’exa-
men direct a isolé l’Acinetobacter chez dix patients, soit 31 %, l’âge
moyen était à 41 ± 18,2 ans avec une nette prédominance masculine
(sex-ratio à 3), IGS II à l’admission : 49 ± 12,3, la durée moyenne
de ventilation mécanique : 15 ± 19,3 jours, le délai de survenue de
pneumopathie à AB était de 8,4 ± 4,06 jours, les motifs d’admis-
sion sont la détresse respiratoire dans cinq cas (décompensation de
BPCO, asthme aigu grave), une chirurgie récente dans trois cas et
une méningoencéphalite dans deux cas, avec évolution vers l’état
de choc septique et SDRA dans 90 et 50 % des cas respectivement.
À l’antibiogramme, 60 % des souches isolées étaient résistantes à
l’imi pénème et 20 % résistantes à la colistine, le taux de mortalité
global a été de 75,5 %, l’imputabilité de la PAVM à AB a été retenue
dans 80 %. Dans ce travail, le taux de mortalité est élevé par rapport
aux différentes séries de la littérature probablement en rapport avec
la gravité des patients admis, la provenance d’une autre structure hos-
pitalière (cliniques privées), l’émergence de souches multirésistantes
ainsi que le manque de personnel paramédical.
Conclusion : Le taux de pneumopathies à AB ne cesse de s’accroître
en milieu de réanimation avec de plus en plus de résistance aux anti-
biotiques, ce qui impose une politique préventive sérieuse ainsi que
l’adoption d’un protocole de surveillance et de soins.
SP239
Impact d’une toilette quotidienne à l’octénidine
chez les patients colonisés à entérocoques résistants
aux glycopeptides
M. Alves1, F. Barbut2, A. Lemire3, N. Bigé1, H. Ait-Oufella1,
A. Galbois1, J.L. Baudel1, G. Offenstadt1, B. Guidet1, E. Maury1
1Service de réanimation médicale, CHU Saint-Antoine, Paris, France
2Unité d’hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales,
hôpital Saint-Antoine, Paris, France
3Laboratoire de bactériologie, hôpital Saint-Antoine, Paris, France
Introduction : L’utilisation d’un savon antiseptique pour la toilette
des patients colonisés par des bactéries multirésistantes pourrait per-
mettre de limiter leur dissémination. L’octénidine est un antiseptique
cationique de la famille des Bispyridines. Nous avons testé l’impact
d’un savon à base d’octénidine utilisé pour la toilette quotidienne de
patients colonisés par une souche d’Enterococcus faecium résistant
aux glycopeptides (ERG).
Patients et méthodes : Lors d’une épidémie à ERG, les patients
hospitalisés en réanimation médicale colonisés ont été isolés dans
une unité dédiée de six lits. Durant six semaines consécutives, nous
avons mesuré la colonisation cutanée des patients (charge bactérienne
prélevée sur une surface de 50 cm2 au niveau des deux avant-bras et
des aines) juste avant la toilette (h0), une heure après la toilette (h1)
et quatre heures après la toilette (h4). La toilette des patients a été
réalisée en utilisant le savon doux habituel (Aniosafe®, Anios, Lille-
Hellemmes, France) pendant les trois premières semaines, puis avec
un savon à base d’octénidine (Octenisan®, Schülke Mayr, Norderstedt,
Allemagne) pendant les trois semaines suivantes. Pendant les deux
périodes, la présence d’ERG a été recherchée dans l’environnement
(support pompe solution hydroalcoolique, barres de lit, télécommande

S212 Réanimation (2012) 22:S210-S213
barres de lit, tablette, respirateur, écran du scope, interrupteur déclen-
chant l’ouverture de la porte, sonnette, émail lavabo, plan de travail
infirmier). La présence d’ERG a aussi été recherchée sur les mains
des soignants à divers moments de leur service. Les conditions de
réalisation des empreintes des différents personnels étaient colligées
en insu. Les prélèvements ont été ensemencés sur milieux chromoID
VRE (Biomérieux) 48 heures à 37 °C directement (environnement et
mains des soignants) ou après dilution dans 1 ml de sérum physiolo-
gique (prélèvements cutanés). L’identification se faisait à l’aide d’une
gélose tellurite de K, bile esculine. La présence d’ERG sur la peau des
patients était exprimée en UFC/ml (ou en log10 UFC/ml) et comparée
à l’aide du test de Wilcoxon.
Résultats : Huit patients colonisés et leur environnement ont été étu-
diés. La présence d’ERG dans les prélèvements environnementaux
était moins fréquente lors de l’utilisation d’Octenisan® 3/468 vs 13/456
(p = 0,02). La fréquence de la contamination des mains des soignants
était identique pendant les deux périodes 2/298 vs 2/299 (p = 1).
Les prélèvements cutanés des patients étaient moins souvent positifs
lors de l’utilisation d’Octenisan® 21 vs 12,5 % (p = 0,005). De plus, la
charge bactérienne était moindre à h0 (p = 0,04), à h1 (p = 0,05), et à
h4 (p = 0,7) lorsque le savon à base d’octénidine était utilisé.
Conclusion : Cette étude suggère un intérêt potentiel à utiliser un
savon à base d’octénidine chez les patients colonisés à ERG. Ces
données devraient être confirmées à plus grande échelle par un essai
randomisé.
SP240
Prévalence et facteurs de risque des infections associées
aux soins (IAS) dans un centre hospitalo-universitaire
tunisien
A. Trifi1, H. Maghraoui2, L. Ammari3, S. Abdellatif1, K. Majed2,
F. Daly1, I. Boutiba4, S. Ennigrou5, H. Tiouiri3, N. Borsali Falfoul6,
S. Ben Lakhal7
1Réanimation médicale, hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
2Urgence, hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
3Service des maladies infectieuses, hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
4Laboratoire de microbiologie, hôpital Charles-Nicolle,
Tunis, Tunisie
5Département médecine préventive, faculté de médecine de Tunis,
Tunis, Tunisie
6Service des urgences, hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
7Service de réanimation médicale, hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
Introduction : Les infections associées aux soins (IAS) constituent
une préoccupation majeure et sont responsables d’une lourde morbi-
mortalité. La disponibilité de données épidémiologiques actualisées
permet de mieux cibler les programmes de prévention des IAS et
d’évaluer ces actions de lutte. Dans ce cadre, nous avons opté pour une
étude de prévalence ponctuelle multicentrique dont les objectifs étaient
de calculer les taux de prévalence globale des IAS et spécifiques selon
les services et les sites anatomiques, décrire les facteurs de risque asso-
ciés et préciser l’écologie bactérienne ainsi que les principaux profils
d’antibiorésistance des germes incriminés.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une enquête descriptive transversale
menée au CHU La Rabta de Tunis, il s’agit d’un passage pour chaque
service un jour donné, on a calculé ainsi une prévalence instantanée.
On a inclus tout malade présent le jour du passage de l’enquêteur ;
ont été exclus de l’étude : les malades de pédiatrie, de néonatalogie
et de maternité, les malades ambulatoires des consultations externes
et des urgences, ainsi que les hospitalisations du jour. Le recueil des
informations est effectué à l’aide de deux fiches (une fiche par service
et une fiche de type questionnaire par malade). Le diagnostic d’IAS est
évoqué par l’enquêteur, confirmé par le médecin traitant et documenté
par le laboratoire de bactériologie. L’analyse des données est effectuée
après leur validation à un double niveau par le médecin traitant et par
le groupe de travail.
Résultats : Le CHU La Rabta est un hôpital de structure pavillonnaire
d’une capacité totale de 970 lits, composé de six services de chirurgie,
11 services de médecine et huit services à caractère intensif médical
et/ou chirurgical que nous appellerons groupe de soins aigus (GSA) :
un service de réanimation médicale, un service d’anesthésie-réanima-
tion et six unités de soins intensifs. Cinq cent vingt-quatre malades
ont été inclus, d’âge moyen 52,2 ± 18,3 ans. 15,6 % proviennent du
GSA. Quarante-quatre patients étaient infectés le jour de l’enquête,
soit un taux de prévalence de 8,4 % : 38 patients avaient une seule IAS,
cinq patients avec deux IAS, et un patient avait trois IAS, le taux de
prévalence des IAS chez les patients du GSA est de 22,9 %. Les sites
anatomiques des IAS sont pulmonaires dans 41 % des cas, urinaires
31,4 %, infection du site opératoire 13,6 %, bactériémies 6 % et infec-
tions liées au cathéter 6 %. Soixante pour cent des patients étaient sous
antibiothérapie. La culture des prélèvements bactériologiques est reve-
nue positive dans 38 cas, avec un profil de multirésistance dans 69,4 %
des cas, les BGN représentant 68 % des germes isolés (K. pneumoniae
[13,15 %], E. coli [13,15 %]). Parmi les CGP, Staphylococcus spp est
le plus fréquent (10,5 %). Certains facteurs de risque se sont révélés
significativement liés au développement des IAS : la ventilation arti-
ficielle, le cathétérisme veineux central, le sondage urinaire (p < 10–3),
le diabète et l’obésité (p < 0,05).
Conclusion : Notre taux de prévalence, calculé à 8,4 %, est compara-
ble à ceux des enquêtes de prévalence des IAS (France02, London08).
Par contre, et comparativement à une enquête nationale tunisienne
menée en 2005 (NOSOTUN05), on note une élévation de ce taux ainsi
que du pourcentage des microorganismes multirésistants. Cela peut
être expliqué en majeure partie par l’usage accru des antibiotiques. La
prédominance des BGN (68 %), ainsi que les différents sites infectieux
restent comparables à ceux rapportés dans la littérature. Par ailleurs,
on retrouve une association étroite entre la survenue d’une IAS et un
certain nombre de facteurs intrinsèques (diabète, obésité) et d’actes
invasifs (CVC, VMC, sondage vésical).
Bibliographie
1. Health Protection Agency (2008) Surveillance of Healthcare Asso-
ciated Infections. London Health Protection Agency, July 2008
2. Ministère de la Santé publique — Direction de l’hygiène du milieu
et de la protection de l’environnement, Première enquête natio-
nale de prévalence des infections nosocomiales (NOSOTUN05) :
Résultats 2005
SP241
Implémentation d’un programme de prévention
et de diagnostic précoce de la pneumonie associée
à la ventilation mécanique à La Havane, Cuba
J. Pugin1, S. Campelo1, T. Crivelli1, A. Wanders1, S. Merlo1,
A. Stefani1, M. Herrmann2, B. Allegranzi3, P. Nuñez4, N. Lim4
1Service des soins intensifs, hôpitaux universitaires de Genève,
Genève, Suisse
2Medicuba, ONG, Genève, Suisse
3Organisation mondiale de la santé, faculté de médecine, Genève, Suisse
4Cuidados Intensivos, Hospital Hermanos Ameijeiras, La Havane, Cuba
Introduction : Le taux de pneumonies associées à la ventilation méca-
nique (PAVM) est élevé dans le service de réanimation polyvalente de
l’hôpital Ameijeiras à Cuba (14 lits). Une collaboration s’est établie

Réanimation (2012) 22:S210-S213 S213
depuis le début 2011 avec notre service en Suisse pour implémenter un
programme multifacettes de type « qualité » pour diminuer l’incidence
des PAVM dans un pays à bas revenus et sous embargo.
Matériels et méthodes : Lors de voyages tous les trois mois, une
équipe médico-infirmière suisse a dispensé à Cuba un enseignement,
des ateliers pratiques et mis en place des principes de prévention
adaptés du ventilator bundle de l’Institute for Healthcare Improve-
ment (http: //www.ihi.org/knowledge/Pages/Changes/Implementthe-
VentilatorBundle.aspx) et du programme espagnol « Neumonía Zero »
(http: //hws.vhebron.net/neumonia-zero/Nzero.asp). Ont été intro-
duites la mesure de densité d’incidence des PAVM et une check-list
comportant les éléments suivants : soins de bouche et lavage des dents
3 ×/j, règles d’aspirations trachéales, maintien de la pression du bal-
lonnet de la sonde d’intubation entre 20 et 30 cmH2O, surélévation
du torse supérieure ou égale à 30°, réveil et estimation de l’extuba-
bilité journalier. La production locale et l’introduction d’une solution
hydroalcoolique (SHA) pour la désinfection des mains dans le service
ont été nécessaires.
Résultats : Après quelques mois d’introduction de la SHA, le taux
d’adhérence au geste de désinfection des mains des soignants est pro-
che de 40 % avant de toucher le malade ou d’accomplir un acte asepti-
que. Cette adhérence a été mesurée par trois étudiantes en médecine de
Genève (> 400 observations), formées par l’OMS. Les connaissances
de l’hygiène des mains ont nettement augmenté parmi les médecins
et infirmières depuis le démarrage de la campagne (basé sur des ques-
tionnaires « avant-après »). Sur les six premiers mois, la densité d’inci-
dence de la PAVM a baissé de 30 à 13 épisodes de PAVM/1 000 jours
de ventilation. Le diagnostic précoce de la PAVM a aussi été amélioré
par l’importation de Combicath® et l’enseignement des minilavages
broncho alvéolaires basés sur un score de probabilité clinique de PAVM.
Conclusion : L’implémentation d’un programme de diagnostic et de
prévention de la PAVM est possible dans un pays comme Cuba et sem-
ble diminuer l’incidence de ces complications infectieuses graves. Ce
projet a nécessité de modifier les pratiques de lavage des mains au savon
au bénéfice de la friction hydroalcoolique, avec une adhérence des soi-
gnants en augmentation au fur et à mesure de l’avancement du projet.
1
/
4
100%