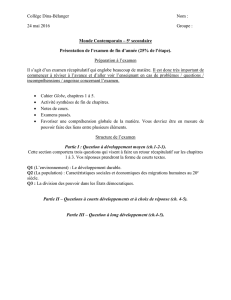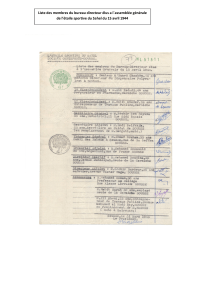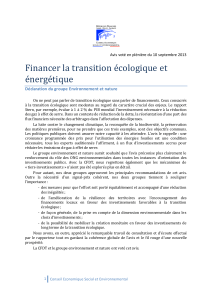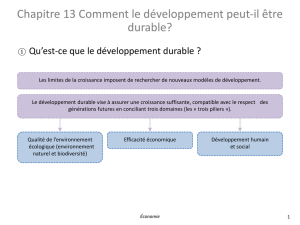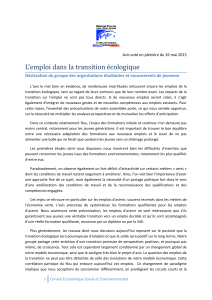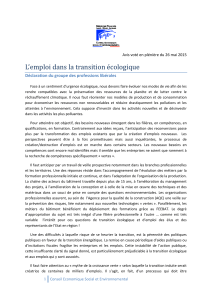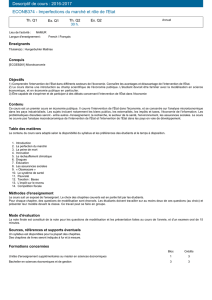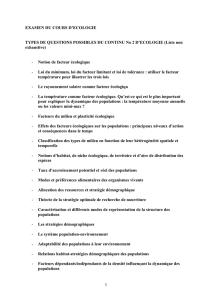Le Sahel face aux changements climatiques Enjeux pour un

232 Sécheresse n° 3, vol. 21, juillet-août-septembre 2010
Le Sahel face aux changements
climatiques
Enjeux pour un développement durable
Bulletin mensuel du Centre
régional AGRHYMET
N° spécial
2010
43 p.
AGRHYMET
BP 11011
Niamey
Niger
Sous un titre qui nÊen reflète quÊen partie
le contenu, puisquÊil y est autant question
de la variabilité naturelle des dispositions
thermo-pluviométriques que de lÊinstalla-
tion éventuelle de ÿ nouveaux climats Ÿ
induits par les activités humaines, le
Centre régional AGRHYMET de Niamey
vient de publier un numéro spécial qui
mérite de retenir lÊattention de tous les
lecteurs de Sécheresse. Par-delà une réfé-
rence obligée aux travaux du Groupe
dÊexperts intergouvernemental sur lÊévo-
lution du climat (GIEC), le propos de
ce petit fascicule est double. Il sÊagit
dÊabord de décrire aussi finement que
possible lÊévolution du climat régional
depuis les grandes sécheresses qui ont
sévi au début des années 1970 et 1980.
Il sÊagit ensuite dÊévaluer la vulnérabilité
des systèmes de production et des modes
de vie des populations sahéliennes face
aux fluctuations des températures et des
précipitations.
On sÊattachera en premier lieu aux
pages, brèves mais suggestives, consa-
crées par Benoît Sarr aux fortes pluies et
aux inondations qui, de 2000 à 2009,
et spécialement en 2007, ont en divers
endroits mis à mal les hommes, les acti-
vités agricoles et les infrastructures écono-
miques. On sÊattachera plus encore à la
solide réflexion dÊAbdou Ali pour tenter
de déterminer si la ÿ grande sécheresse Ÿ
est ou non révolue et si le prétendu ÿ tour-
nant climatique Ÿ de 1993 correspond
bien à une réalité. DÊune part, plutôt
que dÊévoquer des périodes sèches et
des périodes humides, lÊauteur préfère
parler de modes différents de variabilité
interannuelle de la pluviométrie, la fin
de la décennie 1990 et la totalité de la
suivante étant caractérisées par lÊalter-
nance rapide dÊannées très humides et
dÊannées très sèches ce qui rend les
prévisions plus difficiles que par le passé
et impose de nouvelles stratégies dÊadap-
tation. DÊautre part, il ne saurait y avoir
de tendance valable pour lÊensemble
du Sahel. On serait plutôt, depuis une
quinzaine dÊannées, en présence dÊune
ÿ fracture climatique Ÿ avec, à quelques
nuances près, poursuite de la séche-
resse dans lÊOuest et retour progressif à
des conditions plus humides dans lÊEst.
DÊoù un accroissement de la variabilité
spatiale des pluies, qui rend inopérante
la vision dÊun Sahel globalement sec ou
globalement arrosé si tant est que de
telles images aient jamais eu un sens.
Les autres contributions traitent des
impacts de la variabilité climatique sur la
dégradation des sols, sur les ressources
en eau, sur la productivité des cultures
et sur lÊélevage. On en retiendra par
exemple, sous la plume de Benoît Sarr et
de Seydou Traore, que toutes les cultures
ne réagissent pas de la même façon.
Les années chaudes font ainsi chuter le
rendement des mils et du sorgho (de plus
de 10 % pour une élévation de tempé-
rature de 2 °C), mais elles accroissent
les rendements dÊautres céréales (de
10 à 35 % dans le cas du riz, toujours
pour une hausse de 2 °C et à condition
que les besoins en eau soient satisfaits).
Dans un registre voisin, Issa Garba rela-
tivise la thèse largement répandue dÊune
baisse systématique, dÊaucuns disent
même irréversible, de la productivité des
pâturages. Là encore, il est absurde de
raisonner à lÊéchelle du Sahel tout entier,
comme le montre la campagne agricole
2008-2009 où la production fourragère
a été largement excédentaire dans les
pays de la façade atlantique (Sénégal
et Mauritanie), ainsi que dans lÊOuest
du Mali et dans la majeure partie du
Burkina Faso, alors que le Tchad a connu
une situation critique et que le Niger a
dû affronter une véritable catastrophe,
avec un déficit fourrager de plus de
16 millions de tonnes. Il en est résulté un
déplacement massif du gros bétail vers
les secteurs côtiers et une exacerbation
des conflits entre exploitants agricoles et
éleveurs. Mais, parallèlement, lÊauteur
rappelle que les aléas climatiques nÊaf-
fectent quasiment pas les petits fermiers
qui élèvent des caprins⁄
La leçon qui se dégage de lÊensemble,
cÊest quÊil faut éviter les interprétations
trop simplistes. Non, le Sahel nÊest pas
uniforme. Non, le climat ne présente pas
de tendance, mais une infinité de modes
de variabilité. Non, toutes les cultures
nÊont pas les mêmes exigences. Non,
tous les cheptels ne sont pas au même
point vulnérables⁄ Hubert NÊDjafa
Ouaga explique ensuite quÊà lÊéchelle
locale, les paysans ont en général une
bonne lecture des manifestations de la
variabilité climatique, et quÊils réagissent
de façon pertinente pour préserver leurs
moyens dÊexistence, avec ou sans lÊaide
des services techniques et des projets de
développement.
En fin de compte, cette brochure claire
et bien illustrée remplit parfaitement son
objectif, qui était de toucher le public le
plus large possible. On regrettera tout
au plus que la bibliographie finale, à
une ou deux exceptions près, renvoie
uniquement à des rapports non publiés,
auxquels lÊimmense majorité des lecteurs
ne pourra pas avoir accès.
Jean-Pierre Besancenot
doi : 10.1684/sec.2010.0257
jlesec00327_cor3.indd 232jlesec00327_cor3.indd 232 8/20/2010 10:01:57 AM8/20/2010 10:01:57 AM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Sécheresse n° 3, vol. 21, juillet-août-septembre 2010 233
Water and sustainability in arid regions
Bridging the gap between physical
and social sciences
G. Schneier-Madanes,
M.F. Courel, eds.
Dordrecht: Springer Netherlands
Coll. „Earth and Environmental
Science‰
ISBN 978-90-481-2775-7
2010, 22 + 349 p.
158,20 euros
Du 9 au 15 octobre 2006, en présence
de quelque 250 scientifiques venus
de plus de quarante pays, lÊuniversité
du Xinjiang a organisé à Urumqi une
conférence internationale sur lÊeau,
les écosystèmes et le développement
durable en domaine aride ou semi-aride.
Après une longue décantation, les prin-
cipaux enseignements de cette mani-
festation viennent de fournir la matière
dÊun ouvrage original, codirigé par les
géographes Graciela Schneier-Madanes
et Marie-Françoise Courel. Une cinquan-
taine dÊauteurs, hydrologues, écologues,
climatologues, spécialistes de télédétec-
tion, politologues, économistes, archéo-
logues, historiens ou architectes, ont
mis leurs compétences en commun afin
de mieux comprendre les défis auxquels
sont confrontés les hommes vivant dans
les déserts chauds ou sur leurs marges
et dÊévaluer les stratégies mises en place
pour juguler la précarité des ressources
hydriques et la médiocrité des aptitudes
agricoles.
Les sept chapitres qui composent la
première partie, axée sur les problèmes
contemporains, soulignent la complexité
des interactions entre la disponibilité
de lÊeau, les biotopes, les biocénoses
et les interventions humaines. LÊaccent y
est dÊabord mis sur le Nord-Ouest de la
Chine, avec un plaidoyer en faveur dÊun
aménagement mieux coordonné, respec-
tant davantage la nature et justifiant donc
lÊappellation dÊéco-reconstruction. LÊap-
port potentiel de la télédétection pour la
réalisation de diagnostics précis et pour
lÊanalyse des processus est excellemment
illustré sur lÊexemple de lÊoasis de Keriya,
dans le sud du désert de Taklimakan. La
distorsion entre ressources (superficielles
aussi bien que souterraines) et besoins
en eau est ensuite analysée en Iran et au
Maghreb. Le cas de la Tunisie est traité
à part, en insistant sur lÊaggravation des
risques qui pourrait résulter de lÊévolution
du climat, puis sur lÊimpérieuse néces-
sité de concilier le respect de lÊintégrité
environnementale et la recherche de
la sécurité alimentaire, dÊautant quÊun
choix crucial commence à se poser entre
le souci de nourrir la population natio-
nale et la tentation de se lancer dans la
production de bio-énergie, pour satisfaire
la demande extérieure.
La deuxième partie, forte de cinq chapi-
tres, sÊapplique à tirer les leçons de
lÊhistoire et, par une analyse fouillée de
leurs systèmes techniques et sociocultu-
rels, à améliorer notre connaissance des
sociétés vivant dans les zones arides. Les
galeries drainantes souterraines (khettara
au Maroc, qanat en Iran, karez dans la
dépression de Turpan au Xinjiang) et lÊar-
chitecture des villes oasiennes (comme
Kashgar, au point de rencontre des
routes nord et sud de la soie) montrent
ainsi comment lÊingéniosité des hommes
a réussi, au fil des siècles, à rendre
habitables et économiquement viables
des milieux a priori hostiles. La question
sous-jacente est de savoir sÊil y a encore
place, dans le monde actuel, pour des
technologies traditionnelles. La réponse
est positive, si lÊon en juge à travers le
cas de Marrakech où coexistent dans
une relative harmonie des aménagements
multiséculaires et des aménagements à la
pointe du progrès, mais ayant encore à
faire la preuve de leur efficacité.
Encadrée par une présentation géné-
rale des ressources en eau, qui fait une
large place à la géopolitique, et par une
réflexion historico-épistémologique sur
les exigences contradictoires du dévelop-
pement et de la conservation de lÊenvi-
ronnement dans un contexte de pénurie
hydrique, la troisième partie rassemble
sept chapitres sur le thème de la gouver-
nance et de la durabilité des aménage-
ments hydrauliques. Cette fois, en dehors
dÊune mise au point sur la réhabilitation
des écosystèmes secs de la rive nord de
la Méditerranée, les exemples viennent
majoritairement du Nouveau Monde,
que ce soit le Sud-Ouest des États-Unis
(où la surexploitation des eaux souter-
raines hypothèque gravement lÊavenir et
où la législation encadrant le pompage
semble ignorer les principes élémentaires
de lÊhydrologie), les confins septentrio-
naux du Mexique (où un développement
urbain incontrôlé amplifie de façon alar-
mante le manque dÊeau) ou le bassin de
la rivière San Juan en Argentine (où lÊon
réfléchit à des méthodes permettant de
rationaliser lÊirrigation). Mais il ne suffit
pas de disposer dÊeau en quantité suffi-
sante, encore faut-il quÊelle soit de bonne
qualité ; cÊest pourquoi sont également
évoquées les contaminations arsenicales
dans le Cône sud.
Les éditrices nÊont pas souhaité gommer
de petites divergences de fond ou de
forme entre les auteurs, certains privilé-
giant par exemple la notion structurelle
dÊaridité là où dÊautres sÊen tiennent à la
notion conjoncturelle de sécheresse. De
même, il nÊest pas sûr que tous se réfè-
rent exactement à la même définition
dÊune oasis. Mais cela nÊempêche en
rien quÊil se dégage de lÊensemble une
réelle unité. En renonçant aux grandes
synthèses au profit de méticuleuses
études de cas et en jouant astucieuse-
ment avec les échelles de temps et dÊes-
pace, lÊouvrage attire opportunément
lÊattention sur trois points. Le premier est
un constat dÊhétérogénéité, tant dans les
paysages, dans leur contenu naturel et
humain, que dans les ressources quÊils
offrent et les contraintes quÊils imposent.
Le deuxième, corrélatif du précédent,
réside dans le fait que lÊeau ne peut
désormais être valablement gérée quÊaux
échelles fines, en prenant très largement
en compte les valeurs, les connaissances
et les pratiques des populations locales.
Le dernier souligne lÊatout précieux que
peut représenter la collaboration des
sciences sociales et des sciences dites
ÿ dures Ÿ. Puissent ces trois conclusions
être méditées et mises en pratique par
tous ceux qui ont quelque responsabilité
dans le devenir des milieux arides !
Jean-Pierre Besancenot
jlesec00327_cor3.indd 233jlesec00327_cor3.indd 233 8/20/2010 10:01:58 AM8/20/2010 10:01:58 AM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

234 Sécheresse n° 3, vol. 21, juillet-août-septembre 2010
La restauration écologique
Principes, valeurs et structure
d’une profession émergente
André F. Clewel, James Aronson
Actes Sud 2010, 340 p.
28 euros
La version originale de cet ouvrage a
été publiée en 2007 chez Island Press
dans la série ÿ Science et pratique de la
restauration écologique Ÿ. Il a été traduit
en français en 2010. Cet ouvrage est le
13e de la série et sÊintéresse plus directe-
ment à la réalisation de programmes et
de projets. Il sÊadresse plus particulière-
ment aux personnes qui sont engagées
sur le terrain dans des actions de restau-
ration dÊécosystèmes à travers le monde.
Mais cet ouvrage peut toucher un public
plus large allant des ingénieurs écolo-
gues aux professionnels des ressources
environnementales en passant par les
étudiants qui envisagent une carrière
dans la restauration écologique.
Il vise à consolider les définitions, clari-
fier les concepts, faire la lumière sur les
tendances actuelles en matière de restau-
ration écologique. Il met en avant les
synergies possibles avec les activités qui
lui sont proches : lÊingénierie écologique,
lÊéconomie écologique et la science de
la durabilité.
De manière plus concrète cet ouvrage est
constitué de 12 chapitres organisés en
cinq parties. La partie I intitulée ÿ Intro-
duction et contexte général Ÿ précise
les fondements de la restauration écolo-
gique selon des perspectives écologiques
et culturelles ; la partie II sÊintéresse aux
éléments des projets de restauration ;
la partie III est consacrée aux valeurs
abordées par la restauration ; la partie
IV décrit la structure dÊune profession
émergente et enfin le livre se termine par
la partie V ÿ La restauration écologique
holistique Ÿ.
La plupart des chapitres sont indépen-
dants et peuvent se lire dans nÊimporte
quel ordre. LÊoriginalité de cet ouvrage
est quÊentre les chapitres se trouvent ce
que les auteurs appellent des ÿ visites
de terrains virtuels Ÿ. Il sÊagit de brefs
encadrés qui présentent des projets de
restauration permettant dÊillustrer divers
points soulevés dans les chapitres. Ces
visites de terrain proviennent du monde
entier et certaines concernent plus parti-
culièrement les zones arides puisque la
première traite de la restauration dÊune
végétation aride en Australie.
André Kergreis
Rédacteur en chef
jlesec00327_cor3.indd 234jlesec00327_cor3.indd 234 8/20/2010 10:01:58 AM8/20/2010 10:01:58 AM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
1
/
3
100%