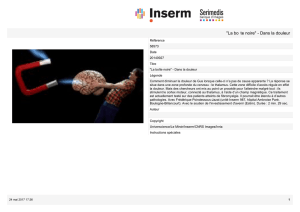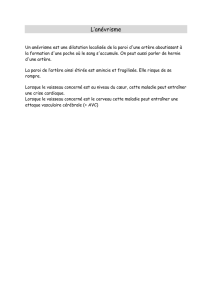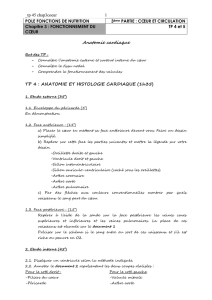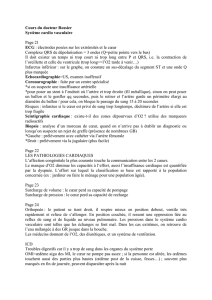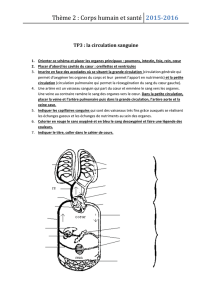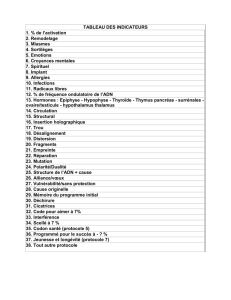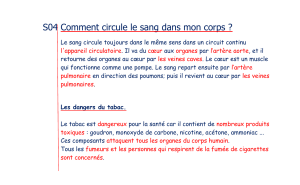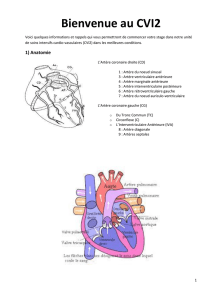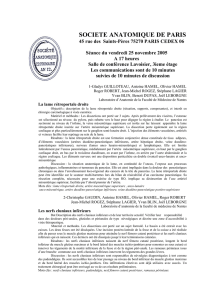Société Anatomique vendredi 22 janvier 2016 SOCIETE

Société Anatomique vendredi 22 janvier 2016
SOCIETE ANATOMIQUE DE PARIS
45 rue des Saints-Pères 75270 PARIS CEDEX 06
Séance du Vendredi 22 janvier 2016
amphithéâtre giroud (3
ème
étage)
17h
Les communications sont de 10 minutes
suivies de 10 minutes de discussion
1-Jérôme ADNOT (1), Fabrice DUPARC (2), Olivier TROST (1,2)
1) Hôpital Charles Nicolle, Service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, CHU de Rouen
2) UFR mixte de médecine et de pharmacie, Laboratoire d’Anatomie, Rouen
Comparaison des forces de traction nécessaires à l’exposition du col mandibulaire dans les voies
d’abord cervicale basse et périmandibulaire : applications au traitement des fractures du condyle
mandibulaire.
Comparaison of the traction forces necessary for the exposure of the mandibular neck in low cervical
(Ridson) and perimandibular approaches : applications to the treatment of condylar fractures
Introduction : Le risque de paralysie facial périphérique, essentiellement segmentaire du rameau
marginal de la mandibule représente la principale complication de la voie d’abord cervicale basse (de
Ridson) du condyle mandibulaire, et la principale raison de la réticence de certains auteurs à opérer les
fractures du condyle mandibulaire. Depuis quelques années, l’utilisation d’une voie de Ridson modifiée
(voie périmandibulaire) s’est généralisée, développée à Strasbourg et Besançon par Wilk et Myer, puis
modifiée par Trost en 2008. Ces auteurs rapportent une très faible morbidité vis-à-vis du nerf facial.
But : Comparer les forces de traction nécessaires à l’exposition du col mandibulaire dans ces deux
voies d’abord afin de déterminer laquelle de ces deux techniques est la moins agressive pour les parties
molles. Matériel et méthodes : Une étude anatomique de chirurgie expérimentale a été réalisée au premier
semestre 2015 au laboratoire d’anatomie de Rouen. Tous les sujets inclus dans cette étude étaient
indemnes de signes de traumatismes ou d’interventions chirurgicales cervico-faciales. Sur chaque sujet,
on réalisait une voie d’abord de référence de Ridson du côté gauche, et une voie périmandibulaire du côté
droit. Le sujet était installé au plus proche de la position opératoire et immobilisé dans un référentiel
orthonormé, un écarteur de Dautrey relié à un dynamomètre permettait de mesurer la force de tension à
appliquer sur les tissus pour exposer la région sous-condylienne, jusqu’à voir l’incisure mandibulaire.
Les mesures ont été comparées par analyses statistiques selon le test de Wilcoxon pour séries appariées,
test bilatéral.
Résultats : 18 sujets ont été inclus dans cette étude, l’âge moyen était de 85 ans. Dans la
technique de référence, la force moyenne nécessaire à l’exposition du col mandibulaire était de 32
Newton, soit 3,2 kg. Dans la voie périmandibulaire, la force moyenne nécessaire à l’exposition du col
mandibulaire était de 19 Newton, soit 1,9 kg. Il existait une différence statistiquement significative entre
les deux côtés (p<0,001)
Conclusion : Dans la voie périmandibulaire, la force de traction nécessaire à récliner les parties
molles était très significativement inférieure à celle mesurée dans la voie cervicale basse de Ridson, voie
de référence. Cette observation fiable et reproductible apporte une explication supplémentaire à la
remarquable sécurité de la voie périmandibulaire pour le nerf facial. En effet, en plus de la technique de
dissection « en marche d’escalier » qui protège le rameau marginal de la mandibule, la moindre
rétraction des parties molles explique très certainement l’absence de parésie des rameaux buccaux ou de
la partie inférieure du muscle orbiculaire de l’œil. Cette étude apporte un argument supplémentaire en
faveur de la généralisation de la voie périmandibulaire dans le traitement des fractures de la région
condylienne de la mandibule.
Mots clés : fracture, condyle mandibulaire, chirurgie, nerf facial.

Société Anatomique vendredi 22 janvier 2016
2-Annabelle GOURINAT (1,2), Jacques HUBERT (1), Ibrahim Michel KARAM (1,2)
Michel ESCHWEGE (1), Richard DOUARD (3), Vincent DELMAS(3)
1
) CHU de Nancy, Hopital Brabois, service de chirurgie urologique
2) Faculté de Médecine de Nancy, Laboratoire d’Anatomie, Vandoeuvre lès Nancy
3) Université Paris Descartes, URDIA, EA 4465, Anatomie
Etude de la vascularisation artérielle prostatique dans le cadre de l’embolisation prostatique
comme traitement de l’hypertrophie de la prostate
Prostatic anatomy and prostatic artery embolization for the treatment of benign prostatic hyperplasia
Objectifs : Etudier l’angio-anatomie prostatique par une revue de la littérature et illustrer le
propos par des dissections sur sujets anatomiques
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une revue de la littérature comparant les différentes
méthodes, technique par technique : angio-TDM, dissections en utilisant les bases de données
(Pubmed/Sciences direct/EMC) et de dissections de 3 hémipelvis masculins de sujets de 65 et 86 ans du
laboratoire d’Anatomie de Nancy (Don du corps) après une injection de latex rouge dans l’artère iliaque
interne. Résultats : Dans la littérature, les dissections ont montré une distribution vasculaire prostatique :
1) supérieure par un pédicule majoritairement d’une artère vésico-prostatique, puis de l’artère rectale
moyenne , de l’artère pudendale interne, de l’artère obturatrice et d’une artère pudendale accessoire. Il se
divisait en une branche médiale, intéressant la zone centrale et la zone transitionnelle de la prostate, et en
une branche latérale. 2) inférieure par un pédicule issu constamment de l’artère pudendale interne mais
pouvant avoir des suppléances accessoires. Sa terminaison s’anastomosait avec la branche latérale du
pédicule supérieur. Les dissections des 3 hémipelvis ont montré : 1-une artère prostatique issue d’un tronc
vésico-prostatique issu de la face antérieure de l’artère iliaque interne, 2- une artère prostatique issue de
l’artère pudendale interne dans sa portion extra-pelvienne, 3-une artère vésico-prostatique issue de l’artère
pudendale interne dans sa portion intra-pelvienne. Dans la littérature, les études par angio-TDM ont
montré que dans 57 % des cas il n’y avait qu’une seule artère prostatique par hémipelvis, issue du tiers
moyen de l’artère pudendale dans sa portion pelvienne (34.1%) d’une artère vésico-prostatique (20.1%)
de la face antérieure d’un tronc glutéo-pudendal (17.8%) de l’artère obturatrice (12.6%) de l’artère rectale
moyenne (8.4%), de l’artère glutéale inférieure (3.7%), d’une artère pudendale interne accessoire (1.9%),
de l’artère glutéale supérieure (1.4%) ; elle se divisait en une branche antéro-latérale intéressant la partie
centrale de la glande et en une branche postéro-latérale.
Conclusion : La vascularisation artérielle prostatique connait une grande variabilité étudiée par
des méthodes retrouvant des résultats divergents. Dans le cadre de l’embolisation artérielle sélective
prostatique comme traitement de l’hypertrophie bénigne de prostate, une cartographie angio-anatomique
par imagerie pré-opératoire semble indispensable
Mots clés : angio-anatomie prostatique, embolisation prostatique, artères prostatiques
3-Marina DOCKES(1), Olivier AMI (1,2, 3), Jean-Christophe MARAN(1, 3)
1) Université Paris Descartes, URDIA, EA 4465, Anatomie
2) Université d’Auvergne, CHU de Clermont Ferrand
3) Imaginaître
Obturateur interne et deuxième phase du travail
Obturator internus muscle and second phase of labor
Objectifs : Explorer les modifications anatomiques du muscle obturateur interne en deuxième
phase de travail afin de mieux comprendre son implication dans la biomécanique musculaire
obstétricale.
Matériel et méthodes : Six parturientes sans risque obstétrical prévisible, ayant donné leur
consentement ont participé au protocole d’imagerie. Deux examens d’IRM en séquences statiques T1 ont
été réalisés, respectivement avant et pendant la deuxième phase du travail. Les imageries ont été post-
traitées pour permettre la reconstruction en maillage vectoriel des différents éléments constitutifs du
canal de naissance et du mobile fœtal. Les données ainsi recueillies ont été qualitativement et
quantativement évaluées afin de mettre en évidence les déformations appliquées aux muscles obturateurs
internes.

Société Anatomique vendredi 22 janvier 2016
Résultats : Les acquisitions ont permis la génération de maillages vectoriels modélisant les
constituants du canal de naissance. La confrontation des reconstructions avant et pendant la deuxième
phase du travail a objectivé des déformations significatives sur le plan de l’obturateur interne
bilatéralement. Une déformation asymétrique a été constatée lors de la mise en décubitus latérale d’une
patiente. L’influence mécanique du mobile fœtal sur l’obturateur interne est accompagné par une
descente du plan de l’ATLA ( arc tendineux du levator ani ) en regard de l’inversion de la courbure de
la coupole des muscle élévateurs de l’anus. Les lésions périnéales observées en post-partum pourraient
être en partie corrélées aux modifications anatomiques décrites.
Conclusion : L’imagerie de la naissance apporte les moyens d’approfondir significativement les
connaissances sur la biomécanique obstétricale par l’apport d’arguments anatomiques réels, en vue de
l’amélioration des modèles théoriques de simulation de la confrontation céphalo-pelvienne. L’obturateur
interne se profile comme acteur potentiel de l’orientation fœtale.
Mots clés : accouchement, obturateur interne, mécanique obstétricale
4-Nina DECUYPERE, Alexis GUEDON, Odile PLAISANT
Université Paris Descartes, URDIA, EA 4465, Anatomie
Groupe medial du thalamus : de l’atlas au Bigbrain
The medial nuclear group of the thalamus : from the atlas to big brain
Objectifs : Reproduire la description de Mai et Paxinos
1
2012 sur les coupes de cerveau du projet
germano-canadien Big Brain.
Méthodes : Les 7404 coupes utilisées dans le projet Big Brain sont issues d’un cerveau d’une
femme de 65 ans sans antécedent neurologique ni psychiatrique. Ce cerveau a été inclus dans de la
paraffine et coupé dans le plan frontal. Une coloration argentique de Merker a été alors réalisée. Les
coupes ont été numérisées ; une reconstruction 3D a été effectuée en s’aidant des coupes IRM réalisées
en pré-inclusion. Afin de lire le fichier final et pouvoir y dessiner, le logiciel MRIcron sur Mac a été
utilisé. La description utilisée pour tracer les limites était issue de l’atlas de Mai et Paxinos
1
Résultats : Les groupes médiaux des deux thalamus droit et gauche ont été dessinés. C’étaient
des noyaux ovoïdes de 18-20 mm de longueur en moyenne, constitués d’un seul élément : le noyau
médio-dorsal. Ses limites ont été l’adhésion interthalamique en antérieur, la commissure habénulaire en
postérieur, la paroi du IIIième ventricule en médial et la lame médullaire interne en latéral, supérieur et
inferieur.
Commentaires : Le dessin a présenté comme difficulté l’absence de l’adhésion interthalamique
sur les coupes et donc la nécessité de replacer artificiellement ce repère. L’atlas stéréotaxique de
Talairach
2
a permis de le resituer. Toutefois le résultat obtenu sur la position de cette adhésion n’était pas
cohérent puisqu’elle était bien en avant des deux thalamus.
Conclusion : La description purement anatomique de Mai et Paxinos présente une limite majeure
à sa reproductibilité, du fait qu’elle se base sur un critère non retrouvé dans toute la population, Ce
critère étant l’adhésion interthalamique en antérieur. Une définition se basant sur des critères cellulaires
semble plus appropriée pour être appliquée le plus largement possible.
Mots clés : Big Brain, Thalamus, groupe médial.
Références :
1) Mai JK, Paxinos G. Thalamus in the human nervous system, 3d edition : Academic Press, 2012
2) Talairach J. Co-planar steretoaxic atlas of the human brain, Stuttgart : Thieme, 1988
5-Solène VALERY, Nina DECUYPERE, Alexis GUEDON, Odile PLAISANT
Université Paris Descartes, URDIA, EA 4465, Anatomie
Noyaux médiaux du thalamus et Big Brain : Etude bibliographique de la délimitation des noyaux
médiaux
Medial group of the thalamus and Big Brain : a litterature review of the nuclei delineations
Introduction : Etude bibliographique sur les nomenclatures et la délimitation des noyaux médiaux
du thalamus. Elle fait suite à une revue de la nomenclature complète des noyaux médiaux du thalamus
par Alexis Guédon (2009). Cette étude, préalable à la réalisation d’un atlas tridimensionnel sur Big Brain
(cerveau numerisé en trois dimensions [Amunts et al. ; 2013]
1
) rassemble les résultats d’une sélection
d’auteurs de référence parmi lesquels : Percheron, Morel, Hirai, Jones, Feremustch, Hassler, Simma, Mai
et Paxinos (in Mai et Paxinos, 2012)
2,
Nieuwenhuys
3,
Dewulf
4

Société Anatomique vendredi 22 janvier 2016
Objectifs : Obtenir une nomenclature et une délimitation des noyaux médiaux du thalamus pour
les limiter morphologiquement, sur un Atlas 3D en cours de réalisation sur le Big Brain.
Matériel et méthodes : Consultation de PubMed et des ouvrages de références de Mai & Paxinos
[2012] et Morel
2
[1997]. Ont été sélectionnés sept sources principales telles que, Dewulf[1971], Hirai et
Jones[1988], Peschanski,[1994], Morel[1997] et Percheron [2003], Nieuwenhuys [2007] , Mai et
Paxinos[2012]. Ces sources font référence dans le domaine du thalamus, comme le prouve le très grand
nombre de leurs citations.
Résultats : Pour chaque noyau du groupe médial, sont présentés selon les différents auteurs, leurs
limites et celles des sous-noyaux ainsi que les techniques de mise en évidence de leurs délimitations. Il
n’existait pas de consensus quant aux noyaux considérés même si la majorité des auteurs s’accordait sur
un noyau médiodorsal et sa subdivision en 3 parties parvocellulaire (MDpc), magnocellulaire (MDmc),
paralamellaire (MDpl). L’existence d’un noyau médio-ventral restait plus controversée.
L’étude des
colorations et des immuno-marquages utilisés montrait que la délimitation des noyaux est largement
dépendante des techniques utilisées.
Discussion : La discussion met en évidence que l’ont ne peut réellement identifier qu’un seul
noyau : le médiodorsal, dans le thalamus médial. Même si Percheron considère la régio medialis comme
une seule entité [Percheron, 2003], on retiendra la subdivision du noyau médiodorsal : en MDpc lateral,
MDmc médial, MDpl. Le noyau médioventral ne fait pas consensus, notamment en raison de frontières
peu définies avec le noyau reuniens et les noyaux de la ligne médiane. On ne retient pas, dans cette étude,
le medioventral comme un noyau du groupe médial. Enfin les différentes techniques de mise en évidence
des noyaux, qui sont couplées pour délimiter les sous-noyaux dans le noyau médiodorsal posent
problème. En effet, la coloration argentique de Merker, utilisée pour le Big Brain est peu adaptée à la
mise en évidence des sous - noyaux. Le choix a été fait de ne délimiter sur Big Brain que le noyau médio-
dorsal dans sa globalité.
Conclusion : Cette revue de la littérature a permis la mise en évidence des délimitations du noyau
médio-dorsal dans le groupe médial des noyaux du thalamus. Cela permet le « contouring » des noyaux
médiaux du thalamus sur Big Brain, réalisé par Nina Decuypère. Il est facile de comprendre l’intérêt de
cette représentation 3D manipulable de manière interactive pour l’enseignement de l’anatomie, voire
pour la pratique clinique.
Mots-clés : délimitations, groupe médial, nomenclature , thalamus, Big Brain.
Références :
1)Amunts K et al Big Brain. An Ultrahigh-Resolution 3D human Brain Model. Sciences, 2013, 340, 1472
2)Mai JK, Forutan F. Thalamus in the human nervous system, editors Mai JK, Paxinos, 3
e
ed, Academic Press, 2012,
3)Nieuwenhuys R, Voogd J., Van Huijzen C. The human central nervous system : a synopsis and atlas, Springer, 2007
4)Dewulf A : Anatomy of the normal human thalamus : topometry and standardized nomenclature, New-York, Elsevier, 1971
5) Morel A. Stereotactic atlas of the human thalamus and basal ganglia, New York : informa healthcare, 2007
6) Decuypère N, Groupe medial du thalamus : de l’atlas au Bigbrain, Soc. Anat. Paris, 22/1/2016
6-Pierre PESCHELOCHE(1, 3), Elsa PONS(2), Bakar BA (2), Xavier DURAND(3)
1) Université Paris Descartes, URDIA, EA 4465, Anatomie
2) Hôpital d’Instruction des Armées du Val de Grâce, service de radiologie, Paris
3) Hôpital d’Instruction des Armées du Val de Grâce, service urologie, Paris
Existe-t-il une corrélation entre longueur des uretères et taille des individus? Application quant au
choix de la sonde double J.
Correlation between ureter length and individual height : implementation for the ureter stent size choice
Objectifs : Entre 50 et 80 % des patients traités par sonde ureterale double J présentent des
difficultés de tolérance. Celle-ci est étroitement liée au positionnement de la sonde : une boucle distale
incomplète ou une boucle dépassant la ligne médiane sont liés à une augmentation significative de la
symptomatologie irritative. Ces deux cas de figure résultent du choix de la taille de la sonde, inadaptée au
patient. Or, il n’existe pas de méthode standardisée quant au choix de la longueur de sonde. En pratique
clinique courante, le choix de la longueur de la sonde est fait de façon assez subjective, selon le gabarit
(taille, IMC) du patient. Ce travail a pour objectif de confirmer ou d’infirmer cette intuition clinique et
donc d’essayer de déterminer s’il existe ou non une corrélation entre longueur des uretères et taille des
individus, afin de choisir une longueur de la sonde JJ adaptée à chaque patient.
Matériel et méthode : l’étude rétrospective a été réalisée sur les uroscanners réalisés en 2013 et
2014. La mesure de la longueur de l’uretère entre la jonction pyélo-urétérale et la jonction urétéro-

Société Anatomique vendredi 22 janvier 2016
vésicale a été
déterminée par reconstruction 3D des temps artériels, puis nous avons procédé à une
mesure linéaire de la taille de ces uretères.
Résultats : 97 examens ont été sélectionnés dont 32 ont pu être analysés et 65 ont été exclus (32
non hospitalisés, 22 non injectés/ absence de temps tardif, 5 patients ayant déjà bénéficié de dérivation
urinaire, 6 patients présentant une dilatation des cavités excrétrices). Concernant les 32 scanners inclus,
45 uretères ont pu être mesurés. 19 uretères n’ont donc pu être mesurés ; 13 uretères spasmés sur une
longueur trop importante ou dans leur proportion pelvienne ou pré-vesicale ; 3 néphrèctomies, 3 examens
avec artéfacts (prothèses). Quel que soit le critère considéré (longueur moyenne des uretères droits ou
gauches), il n’a pas été mis en évidence de corrélation avec la taille des individus.
Discussion : De nombreux examens (22/97, 22,7%) étaient inutilisables pour la réalisation du
protocole de mesure étudié. Par ailleurs, au sein des examens exploitables, 22,4 % des uretères ne sont
pas mesurables du fait de leur caractère « spasmé ». Cela, ajouté à la durée nécessaire à la mesure-
environ 10/15 minutes par examen rende ce protocole de mesure inutilisable en pratique quotidienne.
Cependant réalisée sur des examens sélectionnés, c'est-à-dire permettant la visualisation d’un uretère
injecté sur toute sa longueur, la mesure nous paraît fiable. Il serait donc intéressant de comparer les
résultats obtenus selon cette méthode à des mesures directes, réalisées en peropératoire, sur guide. Nos
résultats semblent toutefois confirmer ceux de plusieurs études antérieures, qui malgré la diversité des
techniques employées (mesure direct sur guide pyélographie intra-veineuse), ne retrouvent pas de
corrélation entre longueur des uretères et taille des individus. En l’absence d’élément prédictif fiable de
la longueur de l’uretère, une autre alternative constituerait à utiliser la même longueur de sonde chez tous
les patients en première intention. La longueur moyenne des uretères mesurés dans notre étude est de
27,7 mm. L’utilisation systématique d’une sonde de 24 cm de longueur conduirait à une sonde trop courte
dans 26% des cas (12/45), alors que celle d’une sonde de 26 cm aboutirait au même résultat de 11% des
cas (5/45). Des études complémentaires pourraient évaluer les résultats en terme de tolérance de l’emploi
systématique de sondes de 24 ou 26 cm.
Conclusion : La technique de mesure de longueur des uretères utilisée dans ce travail nous paraît
relativement fiable, mais non réalisable en routine. Cette étude ne retrouve pas de corrélation entre
longueur des uretères et taille des individus. Ces données devraient remettre en question nos pratiques
quotidiennes quant au choix de la longueur de la sonde double J
Mots clés : Sonde double J, sonde uréterale, uretère, lithiase urinaire, syndrome irritatif
 6
6
1
/
6
100%