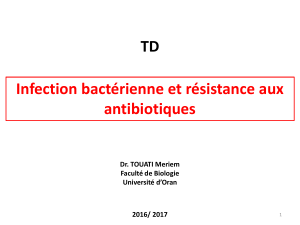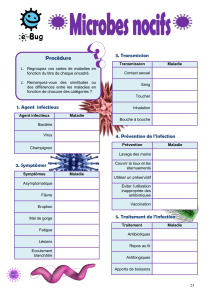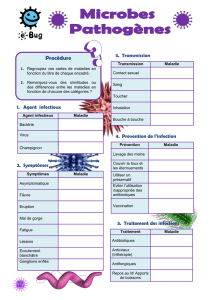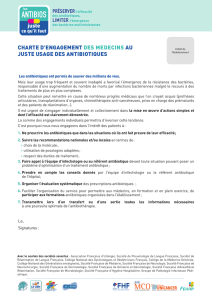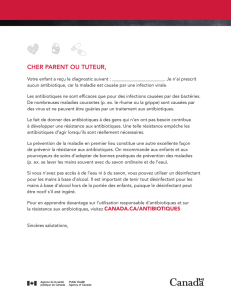Université Montpellier 2 - Master Sciences pour l`Environnement

Université Montpellier 2 - Master Sciences pour l’Environnement
Mention : Biologie des Plantes, des Microorganismes, Bioingéniéries, Bioprocédés
Spécialité : IMHE (Interactions Microorganismes, Hôtes, Environnements)
Renvoyer la proposition de sujet de stage à
[email protected] , patricia.quemener@univ-montp2.fr
Responsable des stages d’Initiation à la Recherche de M1 et de M2 :
Tatiana Vallaeys : [email protected] Tél : 04 67 14 40 11
Administration :
Patricia Quéméner : patricia.quemener@univ-montp2.fr
Sujet de stage préciser le niveau souhaité M1 et/ou M2 (le cas échéant indiquez vos
préférences:
Lutte contre les résistances aux antibiotiques dues à des enzymes bactériennes de
modification
Préférentiellement Stage de M2
Responsable (s) de stage :
Dr. Corinne LIONNE
Personnel technique éventuellement impliqué dans la formation du stagiaire : oui
Tel et Email du Responsable de stage et de l’encadrant (si différent du Responsable de
stage) : 04 34 35 94 65
Laboratoire d’Accueil et nom du Directeur : Centre d'études d'agents Pathogènes et
Biotechnologies pour la Santé (CPBS)
Directeur : Dr. Christian DEVAUX
Equipe d’Accueil : Enzymes bactériennes de résistance aux antibiotiques de type
aminoglycoside
Membres: Dr. Corinne LIONNE (responsable, CR1 CNRS), Dr. Laurent CHALOIN (CR1
CNRS), Dr. Nadia LEBAN (Post-doctorante Infectiopôle Sud), Elise KAPLAN (Doctorante
Université Montpellier 1)
Dans quel contexte s’insère le sujet de stage (démarrage d’un projet, travail partiel d’un sujet
de thèse...) :
Travail partiel d’un sujet de thèse
Techniques utilisées :
Biochimie des protéines: purification, mutagénèse dirigée, test cinétique, mesure d'affinité,...
Biologie structurale: cristallographie aux rayons X, modélisation moléculaire, docking.
Microbiologie: antibiogramme, mesure de CMI

Description du stage : donner un résumé (contexte, problématique, matériels et méthodes).
Contexte
Les infections bactériennes sont la cause de très nombreuses pathologies parfois
mortelles et souvent extrêmement contagieuses. Certaines bactéries comme Mycobacterium
tuberculosis sont responsables de deux millions de morts par an dans le monde. L’utilisation
quasi-systématique et abusive d’antibiotiques durant les dernières décades a eu pour
conséquence l’apparition rapide de souches bactériennes résistantes rendant inefficaces les
antibiotiques actuels. L’utilisation combinée de plusieurs antibiotiques pouvait être dans un
premier temps un moyen de palier au développement de résistance. Cependant, il existe de
plus en plus de souches résistantes à plusieurs antibiotiques et les phénomènes de résistance
apparaissent, la plupart du temps, extrêmement tôt après le début de l’utilisation clinique de
ces agents thérapeutiques. Le développement des phénomènes de résistance engendre une
menace vitale pour l’homme dans le cas notamment des bactéries telles que E. coli
(entérohémorragique), M. tuberculosis, S. aureus ou encore P. aeruginosa. Les bactéries ont
développé une panoplie de parades pour inactiver les antibiotiques. Les mécanismes de
résistance mis en jeu par les bactéries sont de plusieurs sortes :
1. Imperméabilité membranaire : l’antibiotique ne peut plus rentrer dans la
bactérie et atteindre sa cible.
2. Efflux actif : l’antibiotique est rapidement éjecté à l’extérieur de la bactérie
par un système de pompes actives.
3. Cible non reconnue : par exemple l’ARN 16S cible peut être muté ou méthylé.
4. Inactivation enzymatique :
- -lactamases qui dégradent les -lactames.
- enzymes de modification des antibiotiques.
C’est cette dernière voie qui nous intéresse. Dans le cas des aminoglycosides, il existe
3 types de modifications par les AME (Aminoglycoside-Modifying Enzymes) : acétylation
par les AAC, adénylation par les ANT, phosphorylation par les APH (1). Les
aminoglycosides sont des antibiotiques à large spectre, produits par des bactéries du sol. Par
exemple, la streptomycine, la kanamycine et l’amikacine sont des aminoglycosides qui ont
été utilisés contre la tuberculose. Leur cible est l’ARN ribosomal 16S de la sous-unité 30S du
ribosome bactérien. En se fixant spécifiquement au site aminoacyl (A), l’aminoglycoside
stabilise l’état "On", ce qui entraîne une diminution de la vitesse de dissociation de
l’aminoacyl-ARNt, une augmentation de la probabilité de mésappariement, et par
conséquence des erreurs de traduction conduisant à la mort bactérienne (2).
Cependant, ces antibiotiques sont devenus moins efficaces ces dernières années à cause
principalement de l’acquisition par les bactéries de la capacité à les modifier
enzymatiquement. La figure ci-dessous illustre les sites préférentiels de modification de la
kanamycine B par les aminoglycoside nucléotidyltransférases (ANT), acétyltransférases
(AAC) et phosphotransférases (APH) (3). Les chiffres suivant les abréviations des noms
d’enzyme indiquent la position de l’atome de carbone de la kanamycine B portant la fonction
modifiée. Certaines enzymes sont bifonctionnelles (duplication de gène) comme par exemple
l’AAC(6’)-Ie/APH(2’’)-Ia qui peut à la fois acétyler l’amine en C6’ et phosphoryler
l’hydroxyle en 2’’ (4).

Etant donné le savoir faire de l'équipe dans le domaine des kinases, nous nous sommes
d’abord intéressés aux APH qui sont des enzymes responsables de l’inactivation des
aminoglycosides par O-phosphorylation. Les deux principales fonctions modifiées par les
APH sont les hydroxyles portés par les carbones 3’ et 2’’. Les chiffres romains et la lettre
suivant le nom de l’enzyme rendent compte du profil de résistance auquel elle est associée et
la nature du nucléotide donneur de phosphate (5). La classification se complexifie encore
actuellement car de nouvelles APH sont identifiées régulièrement; la dernière en date est
l’APH(2’’)-If (6). Il est important de comprendre le mécanisme par lequel les APH modifient
les aminoglycosides dans le but de trouver des médicaments efficaces empêchant leur action.
Programme de travail
Le projet de stage présenté ici repose, d’une part, sur la recherche d’inhibiteurs des
AME, et d’autre part, leur validation et leur caractérisation par des tests d’inhibition in vitro
et sur des isolats cliniques résistants issus du CHU de Montpellier. L’objectif final consistera
à administrer un antibiotique conjointement avec un inhibiteur de l’enzyme qui l’inactive.
Cette stratégie a déjà été appliquée avec succès dans le cas des -lactames avec l’utilisation
combinée de l’amoxicilline et d’un inhibiteur des -lactamases, l’acide clavulanique
(Augmentin
). Les inhibiteurs recherchés seront de trois types: compétititif vis à vis de
l'antibiotique, allostérique (perturbation de la dynamique fonctionnelle de l'enzyme) ou
incompétitif (piégeant l'enzyme dans un état réactionnel intermédiaire).
Nous avons récemment élucidé le mécanisme réactionnel de l'APH(3')-IIIa (7). Dans
cette étude, un intermédiaire réactionnel prépondérant a été mis en évidence et constitue une
cible de choix pour l'élaboration d'inhibiteurs incompétitif des APH. Sur la base d'un criblage
virtuel dans une cavité des APH dont le volume change au cours de la dynamique
moléculaire, 20 composés ont été retenus et commandés. Deux sont effectivement des
inhibiteurs allostériques des APH: 1 non compétitif, l'autre incompétitif vis à vis de la
kanamycine A.
Nous avons également collaboré avec une équipe de chimistes de l'Université Rennes 1
(Prof. Bertrand Carboni) ayant synthétisé une série d'analogues de néamine qui ont été testés
avec différentes APH. Certains composés sont 2 fois moins bien phosphorylés que la
néamine. De plus, bien que leur activité antibiotique soit relativement mauvaise, ils
permettent de restaurer la sensibilité à la kanamycine A de souches surexprimant une APH à
un niveau comparable à celui d'une souche sensible. Ces analogues de néamine identifiés ont
été synthétisés sous forme de mélange de 2 régioisomères. Or, sur la base du docking, seul
l'un d'entre eux est prédit comme efficace, ce qui pourrait expliquer les 50% d'activité
enzymatique résiduelle. L'équipe de Rennes est en train de réaliser la séparation des deux
isomères dont le pouvoir inhibiteur pourra être mesuré séparément. Cette même équipe se
chargera de la synthèse chimique de composés sélectionnés après optimisation des 2
inhibiteurs allostériques précédemment identifiés. Tous les inhibiteurs seront testés sur des
souches surexprimant une APH ou sur des isolats cliniques dont le profil de résistance aura
été déterminé. Ils seront co-cristallisés avec les APH pour déterminer leur site de fixation et
les interactions clés. Ceci servira de base pour l'optimisation des composés chef de file.

Résultat attendu :
Les résultats attendus seront donc :
1) la caractérisation d’inhibiteurs spécifiques des APH préalablement identifiés par
l’utilisation de méthodes de criblage virtuel de chimiothèques, ainsi que l’optimisation de
composés ayant déjà montré une activité in vitro;
2) la validation de l’efficacité de l’antibiotique avec cet inhibiteur sur des souches
bactériennes résistantes (sur-exprimant une APH) et multi-résistantes (isolats cliniques) en
collaboration avec l'équipe CHU (Dr. Sylvain Godreuil, Département de Bactériologie-
Virologie);
3) la compréhension des mécanismes moléculaires mis en jeu par des études biochimiques et
structurales (mesures d'affinité, cinétiques enzymatiques, cristallographie aux rayons X des
complexes enzyme-substrat-inhibiteur ou avec des analogues d'état de transition, mutagénèse
dirigée,...)
Références :
1- Wright G. D. Aminoglycoside-modifying enzymes. 1999 Curr. Opin. Microbiol. 2, 499-
503.
2- Wirmer J. & Westhof E. Molecular contacts between antibiotics and the 30S ribosomal
particle. 2006 Methods Enzymol. 415, 180-202.
3- Kotra L. P., Haddad J. & Mobashery S. Aminoglycosides: perspectives on mechanisms of
action and resistance and strategies to counter resistance. 2000 Antimicrob. Agents
Chemother. 44, 3249-3256.
4- Frase H., Toth M. & Vakulenko S. B. Revisiting the nucleotide and aminoglycoside
substrate specificity of the bifunctional AAC(6')-Ie/APH(2'')-Ia enzyme. 2012 J. Biol. Chem.
287, 43262-43269.
5- Toth M., Chow J. W., Mobashery S. & Vakulenko S. B. Source of phosphate in the
enzymic reaction as a point of distinction among aminoglycoside 2''-phosphotransferases.
2009 J. Biol. Chem. 284, 6690-6696.
6- Toth M., Frase H., Antunes N. T. & Vakulenko S. B. Novel aminoglycoside 2''-
phosphotransferase identified in a gram-negative pathogen. Antimicrob. Agents Chemother.
2013 57, 452-457.
7- Lallemand P., Leban N., Kunzelmann S., Chaloin L., Serpersu E.H., Webb M.R., Barman
T. & Lionne C. Transient kinetics of aminoglycoside phosphotransferase(3′)-IIIa reveals a
potential drug target in the antibiotic resistance mechanism. 2012 FEBS Lett. 586, 4223-7.
1
/
4
100%