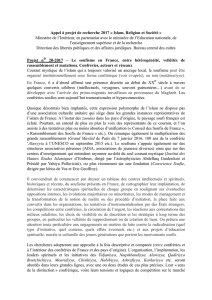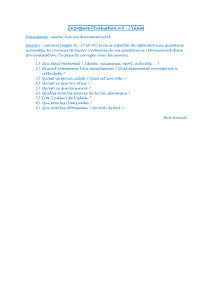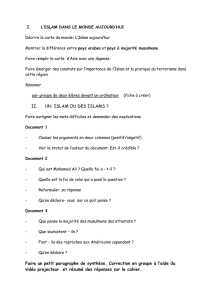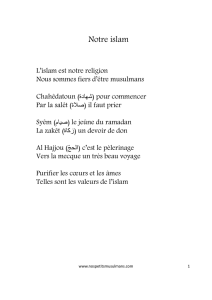Hubert Ricard - Association lacanienne internationale

139
Penser une « identité musulmane » peut sembler une entreprise
assez vaine, ne serait-ce qu’à cause de la généralité du terme.
Mais on ne doit pas récuser a priori toute forme de généralité. Lacan,
quant à lui, n’hésitait pas, même à propos de vastes ensembles culturels
ou historiques, à proposer des articulations très générales qui concernent
notamment la structure subjective, la relation du sujet à l’Autre ou la
mise en place du désir. Il n’a pas hésité à le faire par exemple pour le
christianisme à propos de l’Amour divin.
Ainsi dans le séminaire « Les Non-dupes errent », si, en introduisant le nœud
borroméen, il considère d’abord la perspective d’une équivalence stricte
des trois ronds, il se donne dans un second temps le droit de leur attribuer
des « sens » distincts, et ce en particulier pour caractériser ce qu’il appelle
une position chrétienne. Parmi les trois ronds, il en distingue un auquel il
donne un rôle privilégié, celui d’un intermédiaire qui, en tant que troisième,
rend possible le nouage des deux autres ; et, pour le caractériser, il se réfère
curieusement au moyen terme aristotélicien en tant qu’il occupe la place
de la cause dans un schéma de nalité – avec un commencement, puis le
moyen terme causal, et une n du processus (il suggère d’ailleurs qu’on
peut renverser l’ordre mais il ne le fait pas dans la suite de son propos). À
partir de là, de manière sauvage, il procède à une nomination des ronds, et
ce sont des termes qui sont censés présenter un « écart maximum », des
termes élémentaires où la métaphore ne peut plus jouer et trouve sa limite,
sur le modèle de la triade : réel, symbolique, imaginaire, qui constitue la
première référence de la nomination. Et, pour caractériser la position
chrétienne, il situe comme premier rond, dans la position de l’imaginaire,
le corps, puis dans la position du moyen terme symbolique, l’amour de
Dieu, et enn comme terme ultime, le réel de la mort.
Lacan n’est, ni ne se veut philosophe, mais cela ne l’empêche pas d’être
rigoureux : on peut dire qu’il recherche des articulations conceptuelles,
et plus radicalement et au-delà, des écritures pour lesquelles il utilise
des éléments mathématiques, des mathèmes, qui font question au
niveau du sens, parce qu’il lui arrive de les charger de sens diérents,
L’a mou r de l ’ Un
psychanalyste
Hubert Ricard
Paris

140
Colloque de Fès – 2006
selon les niveaux de réalité ; ce qui reste invariable, c’est l’articulation
que manifeste l’écriture. À partir de cette articulation, on peut toujours
essayer de faire surgir d’autres sens particuliers, pour voir si eectivement
çà peut fonctionner. Alors il a été question pour le judaïsme de la référence
à la sexualité, mise au premier plan, si du moins on se réfère à certains
textes de la Kabbale, sous le primat de la jouissance phallique, il est vrai
dans un registre très obsessionnel ; alors que dans le christianisme, c’est
l’amour divin qui est à la place organisatrice, la place de la cause, qui est
aussi la place du désir, ce qui entraîne une élision de la sexualité : Lacan
parle de l’insensibilisation du corps qui se manifeste dans la béatitude.
Enn à propos de l’islam, on en était venu à parler d’une écriture sous la
dictée qui jouerait le rôle fondamental, à partir du fait que, dans le texte
coranique, c’est une législation qui organise le désir et la sexualité – le
Dieu musulman en parle de façon relativement précise – ce qui n’est sans
doute pas sans poser quelques problèmes du côté du désir. Pour aborder la
question de l’islam, j’ai choisi de me décaler un peu, en m’intéressant au
soufisme. Et pour me justifier, je commencerai par quelques remarques
très générales sur la situation respective du Coran et des textes soufis.
D’abord quand on s’interroge sur l’islam, on doit pouvoir aborder
ses productions culturelles dans toute leur ampleur : l’islam est une
religion qui a fait civilisation. Le rôle exceptionnel qu’y joue son texte
fondateur ne doit pas occulter ce que la civilisation musulmane a
produit dans tant de domaines de la culture, qu’il s’agisse du droit, des
mathématiques ou de la philosophie et plus encore peut-être dans ce
domaine indissolublement lié au discours religieux qui est celui de la
mystique. C’est d’ailleurs un fait que jusqu’à une époque relativement
récente les penseurs et les intellectuels occidentaux ne se sont guère
intéressés au Coran. Il ne suffit pas pour l’expliquer d’invoquer
l’ignorance de la langue du Prophète. C’est sans doute un point essentiel,
étant donné le rôle capital du signifiant dans un texte qui relève avant
tout de la parole et de l’adresse, quels que soient les problèmes que pose
sa transcription écrite. Mais on ne doit pas oublier que notre tradition
chrétienne, dont le texte fondateur est un texte déjà traduit, considère
avant tout les significations et les interprétations symboliques. Et face à
notre culture marquée par notre tradition philosophique et rationaliste,
la morale populaire qu’enseigne le Coran et les preuves théologiques
exhortatives, fondées sur la finalité, dont la philosophie des Lumières
a fait justice, ne pouvaient avoir que bien peu de poids. Tout au
contraire, la mystique musulmane a fait l’objet d’un accueil enthousiaste
d’intellectuels passionnés et de grands universitaires, pour ne citer que
Massignon, Corbin ou Eva de Vitray-Meyerovitch ; tous ceux d’ailleurs

141
L’amour de l’Un
qui ont un peu lu les grands mystiques de l’islam, mettons de Bistâmî à
Shabestari, savent que la mystique musulmane est sans égale en ce qui
concerne le nombre des grandes individualités créatrices, la richesse et la
variété des textes, le lien intime avec la création poétique.
Il y a d’ailleurs aussi un écart historique incontestable entre le monde
culturel où est né le Coran, riche et créatif – comme le montre la poésie
antéislamique –, mais relativement latéral par rapport aux grands foyers
culturels qui avaient jusque-là dominé l’Orient et le monde, et d’autre
part le monde de l’islam ultérieur : la conquête arabe s’étendant à des
pays de très vieille civilisation, Iraq, Syrie, Égypte, Perse, a eu pour eet
un élargissement considérable des thèmes et des modes culturels, qui peut
faire poser la question d’une rupture à l’intérieur de la culture islamique.
Force est en tout cas de remarquer l’originalité incontestable du sousme
par rapport au texte coranique, même si elle est inlassablement déniée
par les textes sous et par leurs références aux « versets mystiques »
du Coran, et si les sous étaient pour la plupart des sunnites tout à fait
orthodoxes. Disons d’emblée que, comme pour le christianisme, c’est
l’Amour divin qui semble prendre dans le sousme la place primordiale,
l’expérience amoureuse de Dieu, plutôt que la référence au Texte sacré.
Pour justier ces remarques bien générales, je me référerai à Arberrry,
éminent spécialiste de la mystique musulmane, auteur notamment d’une
édition critique et d’une traduction anglaise de l’œuvre d’un sou peu
connu, mais remarquable, Niarî, mais aussi d’un très bon petit livre de
vulgarisation, intitulé Le Sousme, qui dénit d’emblée le sousme comme
le « mysticisme de l’Islam ». Cette mystique musulmane, Anawati, pour
la caractériser, parle dans Mystique musulmane (p. 13) d’une « union
intime et expérimentale » – le mot est important – avec Dieu. Et dans
le même livre, Gardet remarque que seul l’amour peut conduire aux
profondeurs inatteignables de Dieu et que c’est l’expérience intérieure du
sou qui semble constituer le critère suprême et non la référence au texte
coranique. En se référant aux versets dits « mystiques » du Coran, le sou
peut considérer qu’il ne fait que reprendre les expressions et la pensée du
Prophète ; mais ces versets sont peu nombreux, ils sont surinterprétés
et la continuité proclamée peut sembler illusoire. Beaucoup de passages
du Coran suscitent sans doute le sentiment de l’unité du monde et de
la grandeur de Dieu mais les versets consacrés à l’amour divin, quoique
indéniables, sont rares et ne se réfèrent pas à une expérience directe.
Citons dans la traduction de Blachère les versets III, 29 :
« Dis : “Si vous vous trouvez aimer Allah, suivez-moi ! Allah vous [en] aimera
et vous pardonnera vos péchés. Allah est absoluteur et miséricordieux.” »

142
Colloque de Fès – 2006
Et dans V, 59 :
« … Allah amènera un peuple qu’Il aimera et qui L’aimera … »
Arberry, présentant l’équilibre général de la pensée coranique, caractérise
plutôt le Coran comme un texte législatif, un texte qui pose la loi et appelle
à l’obéissance, et dans lequel ne se trouve aucune injonction directe à
l’amour comme on en trouve dans le Nouveau Testament. Anawati énonce
le point de vue proprement coranique (M.M. p.16) : « Être musulman,
c’est avant tout s’abandonner à Dieu, s’en remettre à Lui, obéir à sa Loi
– non avoir avec Lui une vie d’amour. »
Un grand penseur traditionaliste, Ibn Taymiyya, ennemi des soufis
et inspirateur du fondamentalisme moderne, assure qu’il ne faut pas
parler d’amour de Dieu au sens d’une relation personnelle à la façon des
soufis, car Dieu est inconnaissable, mais que le croyant doit aimer avant
tout l’ordre de Dieu, la Loi divine. On peut donc se poser la question de
l’exception que constitue le soufisme, de son sens et de sa portée.
Je n’évoquerai que de façon grossière l’histoire du soufisme. Je vais mettre
l’accent dans cet exposé non pas sur le premier temps du soufisme, la
période généralement dénommée « ascétique », la moins originale, me
semble-t-il – le cas de Râbi’â est sans doute à mettre à part –, et qui
ne nous est connu que par des fragments ou des doxographies, mais
sur l’époque qui suit, la plus haute à mon sens, qui correspond, très
en gros, au IXe et au Xe siècle de notre ère, et dont les noms les plus
importants sont ceux de Bistâmî, de Junayd et bien sûr de Hallâj, qui
fut exécuté en 922. On peut dire de cette période qu’elle est celle de
l’affrontement amoureux aride et difficile avec le Dieu-Un, même si
chez Junayd la relation à Dieu a un caractère plus tempéré. Ce n’est
que dans la période suivante – qui va en gros jusqu’au XIIIe siècle –
que cette aporie radicale de la transcendance de l’Un sera, si je puis
dire, au moins en partie, « exorcisée » soit par l’admirable système
théosophique d’inspiration néo-platonicienne d’Ibn Arabî, soit par une
référence imaginaire très intense à la beauté et à l’amour platonique,
comme le montrent les splendides créations littéraires ou poétiques
de Rûzbehân, d’Ibn al Fâridh ou de Rûmi. Mais tout ceci peut-être au
prix d’un recouvrement, de ce qui faisait la difficile vérité de la période
précédente. Et je n’évoquerai qu’en passant le rôle essentiel de Ghazâli,
moins pour la valeur de son œuvre de soufi que pour les conséquences
historiques de son intervention dans la pensée musulmane, à savoir
le rejet de la philosophie aristotélicienne, mais aussi bien en quelque
sorte l’intégration du soufisme dans l’orthodoxie, aux yeux de la plus
grande partie des autorités religieuses. Il est vrai que, dès lors, avec

143
L’amour de l’Un
le grand développement des confréries, le soufisme fait bon ménage
avec l’orthodoxie et cesse d’être le lieu d’expression privilégié de
l’individualité en Islam.
Notons néanmoins que si l’esprit général du sousme est très diérent
de celui du texte coranique, la plupart des sous ont professé le sunnisme
et proclamé leur soumission à la loi coranique. Ce que montre leur vie
personnelle. Les mêmes hommes qui font des expériences bouleversantes
dans le registre d’une érotique divine sont de bons époux et de bons pères
de famille qui se plient aux devoirs de leurs charges. C’est aussi bien le cas
de Rûzbehân qui a décrit dans ses « visions spirituelles » des anges d’une
troublante beauté et représenté l’union amoureuse avec un Dieu qui
prend la forme de ses créatures, ou de Rumî qui éprouva pour son maître
spirituel Chams de Tabriz, un derviche sexagénaire vêtu de haillons, un
amour sublime qui apparaît dans ses poèmes avec une intensité et une
authenticité incomparables. Même Hallâj avait femme et enfants. On
pourrait en tirer l’idée que l’islam législateur et le sousme appartiennent
à la même conguration structurale, ce qui n’exclut pas que l’amour
sou puisse répondre à quelque chose qui fait question dans la position
subjective qu’implique le texte coranique. Si beaucoup de sous ont pu
prendre quelque distance à l’égard de la Loi – je pense à Shabestari et
à sa magnique Roseraie du Mystère – c’est dans la perspective d’un
universalisme tolérant qui ne remet nullement en cause le cadre religieux
de l’islam et la valeur de l’adresse à un Dieu d’amour.
Quand on compare l’islam aux autres monothéismes, on le fait souvent
de façon négative, en insistant sur ce qui lui manque : on remarquera
par exemple que dans le judaïsme la référence à la paternité divine
est fondamentale, au moins de façon métaphorique, dans maintes
expressions du Texte sacré, alors que le Dieu de l’islam ne saurait être
dit père, l’évocation d’une relation de parenté portant atteinte à sa
transcendance et à son unicité. D’un côté on évoquerait le Nom-du-
père, de l’autre un Un tout à fait incommensurable avec sa créature
en position d’idéal inaccessible. Mais au niveau des conséquences,
l’islam y gagne un privilège : dans le judaïsme, il y a impossibilité
d’une érotique divine, d’une union amoureuse avec un Dieu-Père : il
y a plutôt parallélisme entre l’Amour qui se situe en Dieu lui-même et
l’amour humain. Ainsi, la Bien-aimée du « Cantique des Cantiques »
représentera Israël par métaphore ou aussi bien l’attribut divin de la
Chekhina, comme dans le bouleversant commentaire du Cantique
que donne le Zohar, le drame amoureux se déroulant d’abord en Dieu
lui-même. Alors que le caractère apparemment non sexué du Dieu de
l’islam semble avoir libéré dans la sublimation la possibilité d’un amour
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%