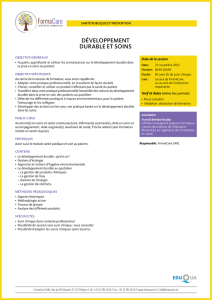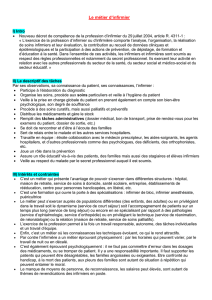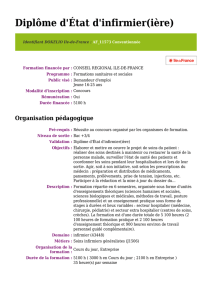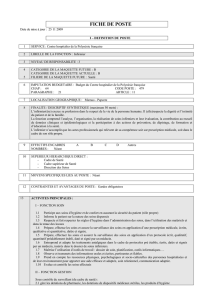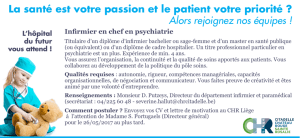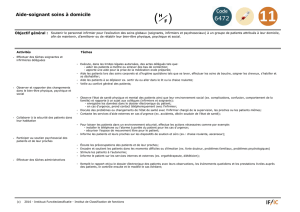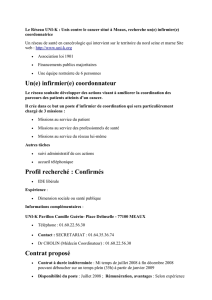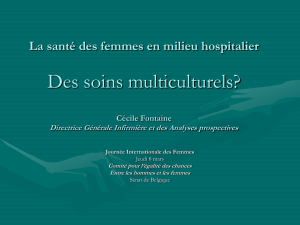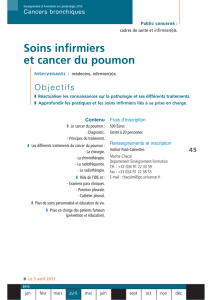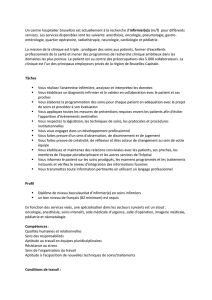Métiers d`avenir

MÉTIERS D’AVENIR -
LA SANTÉ
1
Service d’analyse du marché de l’emploi et de la formation
Le Forem
–
Septembre 2013
Métiers d’avenir
États des lieux du secteur de la santé
Recueil prospectif

2
Préambule
Le Forem a initié un projet centré sur la détection de
métiers d’avenir pour la Wallonie d’ici les 5 prochaines
années. Ce projet vise non seulement à adapter et amé-
liorer l’offre de prestations en regard des évolutions du
marché mais aussi à l’anticiper, que celle-ci soit organi-
sée par le Service Public Régional de l’emploi ou par les
nombreux acteurs présent sur le marché.
En septembre 2013, Le service de l’Analyse du Marché
Et de la Formation du Forem (AMEF), après avoir consul-
té plus de 300 experts wallons, publiait une première
analyse sur les métiers d’avenir pour la Wallonie.
Cette vaste étude balaie largement les différents fac-
teurs d’évolution sectoriels et leurs effets présumés
sur l’évolution des métiers (sans se limiter au cadre
strict de la réserve de main d’œuvre).
Plusieurs évolutions ont été relevées. L’appellation
« métiers d’avenir » regroupe des nouveaux métiers,
des métiers dont le contenu va évoluer, s’hybrider et/ou
des métiers pour lesquels l’effectif en postes de travail
va croitre. Une première liste de métiers d’avenir est
proposée, conjuguant un fort intérêt stratégique pour
le secteur d’activité avec les besoins en effectifs et en
qualifications.
Ainsi pour chaque secteur d’activités considéré, la com-
pilation des facteurs sectoriels en quatre grands do-
maines de transformation a été organisée :
0 Les progrès techniques et les innovations technologi-
ques favorisent l’adaptation constante des métiers ;
0 Les facteurs économiques (p. ex. la mondialisation de
la concurrence, la tertiarisation de nos économies)
ont un impact direct sur l’organisation du travail, la
répartition des tâches et la structuration des mé-
tiers/fonctions au sein des chaînes de valeur de l’en-
treprise ;
0 Les facteurs réglementaires, les certifications et
autres normalisations influencent directement ou in-
directement les fonctions des personnes ;
0 Les modes de vie des personnes (p.ex. l’individuali-
sation des modes de vie) influencent l’économie et
génèrent des nouvelles demandes sociales, etc.
Tous ces facteurs interagissent, influencent l’organisa-
tion des processus de fabrication des produits ou de
livraison de services et impactent – variablement selon
le secteur – les chaines de valeurs au sein des organi-
sations.
Secteur par secteur, le Forem a tenté de déterminer
avec les experts contactés de quelle manière ces fac-
teurs influenceraient, à moyen terme, un ensemble de
métiers proposés.
Les pages qui suivent présentent les principaux ensei-
gnements tirés pour un secteur ainsi qu’une liste (non
exhaustive) de métiers identifiés comme d’avenir pour
la Wallonie.
Le lecteur intéressé par une vue transversale sur
l’ensemble des secteurs étudiés peut se référer à
la publication complète accessible via le site du
Forem :
Le Forem, Métiers d’avenir : états des lieux secto-
riels et propositions de futurs – recueil prospec-
tif, septembre 2013
http://www.leforem.be/chiffres/chiffres-et-analy-
ses.html

MÉTIERS D’AVENIR -
LA SANTÉ
3
Santé
Principales tendances1.
Le secteur de la santé connaît aujourd’hui des transfor-
mations importantes, majoritairement liées aux évolu-
tions technologiques (évolution des outils de gestion et
de suivi des activités, innovations technologiques, nou-
veaux dispositifs médicaux et outils de diagnostic, etc.)
et au vieillissement de la population.
Bien que n’étant pas directement touché par la crise
financière puis économique entamée en 2008, le sec-
teur en ressent les effets au travers des politiques de
maîtrise des dépenses publiques dans le domaine de
la santé. De plus, la défédéralisation de la gestion des
soins de santé et de l’aide aux personnes âgées ren-
force l’incertitude quant au financement du secteur et
pourrait influer en profondeur l’organisation institu-
tionnelle de celui-ci.
Par ailleurs, l’organisation du secteur tend vers la déli-
vrance des soins au sein d’une chaîne d’acteurs de plus
en plus spécialisés, allant de la prévention au suivi et à
l’accompagnement sur le long terme. De plus, le nom-
bre de pratiques de groupe de première ligne croît dans
un environnement où les normes, règles et agréments
sont ressentis comme de plus en plus contraignants.
Dans le même temps, le secteur connait une forme de
concurrence et voit apparaître des stratégies emprun-

4
tées au marketing. Une « commercialisation » de la san-
té semble avoir commencé, touchant particulièrement
le secteur de l’accueil des personnes âgées. Cette ten-
dance fait craindre à certains l’apparition d’un système
de santé à deux vitesses.
Les réformes des formations aux métiers du secteur se
poursuivent dans un contexte marqué par un turn-over
élevé et des pénuries de main-d’œuvre pour certains
métiers.
La société, quant à elle, change. La santé semble deve-
nir un bien de consommation. La population vieillit et
une part d’entre elle se précarise. Le stress et l’anxiété
augmentent. Les besoins en matière de santé semblent
de plus en plus importants. Il est donc plus que proba-
ble que l’emploi dans le secteur poursuive son évolu-
tion à la hausse dans un avenir proche.
Facteurs d’évolutions2.
Technologiques
L’intégration des technologies de l’information et de
la communication (TIC) en tant qu’outil de gestion et
de suivi des activités se poursuit, dans le cadre de la
création de la plateforme « e-health ». Cela permettra
d’optimaliser la qualité et la continuité des prestations,
d’améliorer la sécurité du patient, de simplifier les for-
malités administratives et d’offrir un soutien solide à la
politique en matière de soins de santé.
Les TIC rendent possible la transmission automatique
d’informations entre les différents interlocuteurs de
la chaîne des soins : du patient au médecin, entre les
professionnels des soins et vers les autres acteurs ges-
tionnaires du système de santé (mutuelles, INAMI, etc.).
Les nouveaux processus de captation, de traitement
et de partage de l’information de santé modifient les
pratiques et les organisations, notamment par un al-
lègement des temps consacrés aux activités adminis-
tratives et une possible différenciation des tâches vers
des gestionnaires de dossiers administratifs et des
techniciens de l’information médicale. Cette évolution
permet également de centraliser les informations et
de développer des métiers de recherche et d’analyse
des données de santé (notamment au sein du Centre
Fédéral d’Expertise des Soins de Santé). Ceci pose tou-
tefois question quant à la sécurisation de la gestion des
données, à leur utilisation, à la rupture éventuelle entre
les prestataires de terrain et les gestionnaires de don-
nées ainsi qu’à l’impact éventuel sur la relation avec le
patient.
L’innovation technologique dans le secteur est constan-
te et la Recherche & Développement (R&D) est très
présente, en lien notamment avec les secteurs phar-
maceutiques et des nouveaux matériaux. Les sciences
fondamentales de la médecine progressent vite, per-
mettent de mieux comprendre les mécanismes des ma-
ladies et d’orienter efficacement les recherches. Des
dispositifs médicaux et des solutions logicielles de dia-
gnostic et traitement sont peu à peu mis au point (suivi
du patient au travers des TIC, diagnostic à distance, té-
lémédecine, etc.). Des appareillages de soins de plus en
plus sophistiqués et coûteux sont utilisés.
Ces nouvelles pratiques nécessitent le recrutement
de techniciens qui présentent tant des compétences
techniques spécifiques que relationnelles et commu-
nicationnelles. Cela doit être pris en compte dans la
formation de base et la formation continuée du person-
nel. Des experts métiers de terrain seront nécessaires
à l’instauration d’un dialogue efficace avec les techni-
ciens et informaticiens mettant au point ces nouvelles
technologies. Des techniciens de maintenance seront
également de plus en plus nécessaires.
Les compétences technologiques, déjà bien présentes,
peuvent aussi être supportées par d’autres activités de
marché, via des contrats de service et impactent donc
l’emploi dans d’autres secteurs d’activités en lien avec
l’écosystème de la santé.
La formation des professionnels des soins doit s’adap-
ter à ces évolutions, tout en continuant à maîtriser les
bases que sont l’interrogation du patient, l’ausculta-
tion et l’observation. Cette formation est ainsi de plus
en plus confrontée à l’apparente contradiction entre
contact humain et technicité.
La nécessité de connaissances de plus en plus éten-
dues et pointues entraine une différenciation des mé-
tiers selon les spécialisations. Cela pose la question
de la délégation/substitution des actes à risque. Selon
certains acteurs du secteur, ceci pourrait multiplier
les intervenants autour d’un patient qui ne serait plus
perçu comme une « personne globale ». Les profes-
sionnels devraient alors acquérir, dans leur formation,
les compétences nécessaires pour déléguer, supervi-
ser et encadrer leurs aidants (infirmiers vis-vis des
aides-soignants, médecins vis-à-vis des infirmiers no-
tamment).

MÉTIERS D’AVENIR -
LA SANTÉ
5
Par ailleurs, des questions restent posées quant à
l’utilisation et au coût de ces techniques, ainsi qu’aux
limites éthiques. Selon certains acteurs du secteur, le
risque d’une médecine à deux vitesses se préciserait.
Enfin, les nouveaux produits et médicaments proposés
par l’industrie pharmaceutique impliquent une mise à
jour constante des connaissances.
Économiques
Bien que n’étant pas directement touché par la conjonc-
ture économique, le secteur de la santé est cependant
dépendant d’un financement par la sécurité sociale et
par les pouvoirs publics en charge de la politique de
santé. Dans un contexte de rationalisation des budgets
(notamment ceux dédicacés aux politiques de santé et
de prise en charge des personnes non autonomes), de
diminution de la population active comme source du
financement de la sécurité sociale, de vieillissement
de la population et de développements technologiques
(sources potentielles d’une hausse des dépenses de
santé), les modalités d’organisation du système des
soins de santé sont amenées à changer. Les modes de
financement auront un impact sur la réponse apportée
aux besoins médicaux. L’importance de la participation
du bénéficiaire au financement du service influencera
la possibilité et la manière de consommer les services
de santé. Le nombre d’actes et/ou de places financés
par des fonds publics et proposés dans les institutions
pourrait être limité à l’avenir et le potentiel d’emplois
à créer en serait donc affecté. La mutation de l’offre
de services de santé entamée ces dernières années se
poursuivra dans le cadre d’une recherche de la plus
grande efficience.
La défédéralisation de la gestion des soins de santé et
de l’aide aux personnes âgées renforce le degré d’in-
certitude quant au financement du secteur et pourrait
avoir une forte influence sur l’organisation institution-
nelle du secteur ; notamment en impliquant éventuelle-
ment la création d’un organisme spécifique en charge
de la gestion de la santé. Ceci pourrait générer des be-
soins en termes d’expertises auxquels des transferts
de personnel ne pourraient entièrement répondre.
Le manque de financement pourrait, face à l’évolution
des besoins des personnes, renforcer progressivement
la commercialisation du secteur.
En lien avec les modes de financement et les complexi-
tés (techniques et sociales) des activités, l’organisation
du secteur tend à la délivrance des soins au sein d’une
chaîne d’acteurs de plus en plus spécialisés allant de la
prévention au suivi et à l’accompagnement sur le long
terme. Par exemple, les soins à domicile prennent de
plus en plus en charge des cas « complexes » passés du
secteur hospitalier vers le secteur des soins ambulatoi-
res. La culture de travail des professionnels est ainsi
amenée à évoluer. Le nombre de pratiques de groupe
de première ligne croît (trajet de soins, approche in-
tégrée et globale des soins, service intégré de soins à
domicile et initiatives de coopération soins de santé
primaires) et les horaires de travail changent. Des fonc-
tions de coordination, d’appui et de soutien aux pro-
fessionnels du soin apparaissent ou sont demandées.
Le recours aux aides-soignants dans les soins à domi-
cile est ainsi amené à s’intensifier.
Le secteur compte de nombreuses sorties « précoces »
du métier dans certaines professions de soin. Ce phé-
nomène serait lié aux conditions de travail difficiles,
aux salaires peu compétitifs ou à la pyramide d’âges
des effectifs. Cela entraîne des difficultés de recrute-
ment, voire des pénuries de main-d’oeuvre persistantes
(par exemple infirmier). Ces difficultés, cumulées à la
libre circulation des travailleurs, entraînent de nou-
velles pratiques de recrutement dans le secteur. D’un
recrutement majoritairement local ou régional, le re-
crutement s’élargit au niveau européen, voire mondial.
L’internationalisation des recrutements nécessite par
ailleurs la mise en place d’actions spécificiques afin à
faciliter l’intégration des candidats (langue et culture).
Notons aussi que certaines spécialisations, notamment
en médecine, rencontrent moins de succès qu’aupara-
vant et voient le nombre de candidats diminuer.
La rationalisation des ressources et l’organisation de
l’offre de soins au sein de bassins géographiques fait
naître une forme de « concurrence » dans un secteur
où les piliers traditionnels sont toujours présents. Les
hôpitaux conçoivent et mettent notamment en place
une stratégie d’offre (marketing et communication, ap-
parition de chargés de relations et de communication,
webmasters).
Au sein des maisons de repos, disparaissent progres-
sivement les petits établissements à caractère familial
et apparaissent des chaînes avec une portée plus com-
merciale .
La concurrence qui règne à présent dans ce secteur
rend nécessaire une politique de communication et la
recherche d’atouts à mettre en valeur (proposition de
services de pointe, amélioration des infrastructures
d’accueil, etc.). Une commercialisation de la santé sem-
ble – pour plusieurs observateurs - avoir commencé,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%