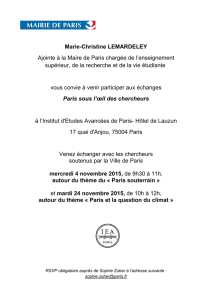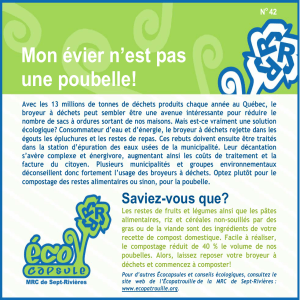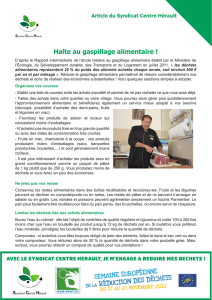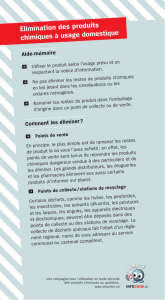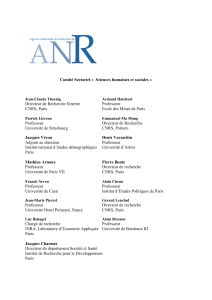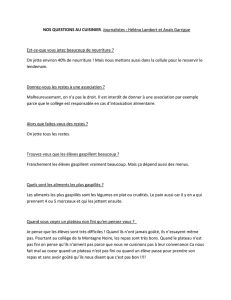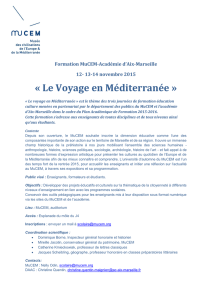Appel à candidature pour un contrat post-doctoral

1
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
Laboratoire d’excellence « Les sciences humaines et sociales au coeur de
l’interdisciplinarité pour la Méditerranée » - LabexMed
Aix-Marseille Université – Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
Appel à candidature pour un contrat post-doctoral LabexMed/MuCEM
Dans le cadre d’un partenariat entre le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à
Marseille (MuCEM- http://www.mucem.org/fr/le-mucem/formation-et-recherche) et le laboratoire
d’excellence sur les études méditerranéennes, coordonné par la Maison méditerranéenne des sciences
de l’homme (LabexMed; http://labexmed.mmsh.univ
‐
aix.fr/), il est proposé le recrutement à compter
du 1er décembre 2013 d’un chercheur post-doctorant pour un contrat d’une durée de 12 mois,
renouvelable une fois.
Le post-doctorant sera sous contrat à durée déterminée avec l’Université d’Aix-Marseille et sera
rattaché à une unité de recherche partenaire de LabexMed (voir annexe 2). En outre, il bénéficiera
d’un statut de chercheur associé au MuCEM et y disposera d’un espace de travail.
Mission
Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), musée national constitué en
établissement public et administratif, qui a ouvert ses portes en juin 2013, souhaite associer à son pôle
scientifique des chercheurs inscrivant leurs recherches dans le champ d’activité de l’établissement.
L’objet du MuCEM est de comprendre, pour les restituer aux publics, les dynamiques des sociétés
contemporaines du bassin méditerranéen en les situant dans leurs contextes.
Il est dès lors essentiel pour l’institution de fonder sa politique sur des travaux de recherche adaptés
tant aux thématiques qu’aux impératifs de l’acquisition, de la conservation et de la restitution aux
publics des témoignages des transformations des sociétés de la Méditerranée.
Le MuCEM se positionne comme un musée pluridisciplinaire. L’approche privilégiée est celle de
l’anthropologie entendue au sens large comme science de l’homme et de la société dans la mesure où
elle permet d’observer et d’analyser les constructions culturelles et sociales contemporaines dans leurs
multiples dimensions : historiques, ethnologiques, sociologiques, économiques, géographiques,
archéologiques, politiques, linguistiques, esthétiques….
Les chercheurs associés seront amenés à participer à l’élaboration des contenus scientifiques du musée
sous ses différentes formes : expositions de longue durée et temporaires, programmation des
séminaires de recherche et des cycles de conférences, publications…
Leur activité s’exercera au sein de la direction scientifique et des collections du MuCEM en relation
avec d’autres services comme ceux des publics, du développement culturel ou de la production.
Ainsi dès 2013, il est proposé à des chercheurs associés de participer à l’élaboration et à l’animation
d’un programme de recherche spécifique en se familiarisant avec les différentes missions d’un musée

2
de société et en particulier la traduction des données de recherche dans des expositions destinées à de
larges publics.
Dans le cadre du présent contrat, le thème de recherche proposé est celui de l’économie des restes en
Méditerranée (voir annexe 1) qui donnera lieu à une exposition au MuCEM à l’automne 20161.
Le post-doctorant sera amené à définir avec le commissariat de l’exposition un programme de
recherche comparatif dans le bassin méditerranéen sur un des axes thématiques en lien avec ce
thème, puis à le mettre en œuvre.
Il assurera en outre, sous l’autorité du commissariat de l’exposition, la coordination scientifique du
programme et en particulier l’animation de son conseil scientifique.
Le post-doctorant associera ce programme de travail à ses activités de recherche dans le cadre de son
laboratoire d’accueil partenaire de LabexMed. Les axes de recherche de LabexMed sont les suivants :
1. Systèmes productifs, circulations, interdépendances
2. Dynamiques socio-environnementales
3. Savoirs, techniques, langages
4. Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations
5. Etats, droits, appartenances
Rémunération brute mensuelle: 2415€ brut mensuel
Profil
Le candidat devra être titulaire d’un doctorat dans une des disciplines des sciences humaines et
sociales.
Il devra avoir une expérience dans le domaine de la recherche sur le monde méditerranéen.
Il maitrisera au moins une langue méditerranéenne en plus du français et de l’anglais.
Dossier de candidature :
Une lettre de motivation indiquant l’intérêt du candidat pour le sujet proposé et développant
les axes de recherche qu’il souhaite privilégier dans le cadre de sa mission au MuCEM.
Un projet de recherche dans le cadre de LabexMed : titre, unité de recherche d’accueil,
présentation du projet en 10 000 signes maximum.
Un avis du directeur du laboratoire d’accueil
Un curriculum vitae incluant les publications significatives
Diplôme de doctorat
Rapport de soutenance de thèse
1 Date à confirmer

3
Les candidatures (par voie électronique, au format pdf) doivent être adressées au plus tard le 31
octobre 2013 labexmed-adm[email protected]aix.fr
A l’attention de Mme Brigitte Marin, directrice de la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme et de LabexMed,
avec copie à :
M. Denis Chevallier, département de la recherche et de l’enseignement du MuCEM,
denis.chevallier@mucem.org.

4
Annexe 1. L’économie des restes en Méditerranée –thème de recherche
« En fouillant un tas d’ordure on peut reconstituer toute la vie d’une société » Marcel Mauss,
Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques, Musée d’ethnographie du
Trocadero, 1931
Matériau utile à la compréhension des sociétés du passé le reste est aussi au cœur d’une économie qui
en dit long sur nos sociétés aujourd’hui.
L’objet du programme, qui devrait aboutir à la présentation d’une exposition au MuCEM en 2016, a
pour fil conducteur l’économie des restes en Méditerranée, en tant qu’ensemble des modalités de
traitement (au sens large d’appropriation, échange, transformation, récupération tant
techniques que symboliques) des éléments matériels voués à disparaitre ou à avoir une nouvelle
vie.
La mise au jour de ces processus, des formes d’organisation qu’ils génèrent, des valeurs qui les sous
tendent permettra de soulever quelques-unes des grandes questions que doit aborder un musée de
civilisation comme le MuCEM : la part cachée de nos sociétés confrontées d’une part aux pressions du
consumérisme et ses corollaires que sont le gaspillage et l’obsolescence des objets et d’autre part aux
restrictions des ressources avec leurs conséquences en termes de paupérisation et d’enjeux
écologiques.
Le sujet, peu abordé par les musées de société, permet ainsi de rencontrer et de faire se rencontrer les
effets sociaux d’une double crise économique et écologique. Ces effets se retrouvent dans certaines
reconfigurations actuelles des systèmes d’échange (le don, le troc…) et d’usage des ressources et des
objets (la récupération). Le sujet offre par ailleurs une métaphore de la fonction d’un musée comme
instrument d’une actualisation du passé avec les distorsions et les changements de sens occasionnés
par ces recyclages multiples que sont les mises en collection (boites et bases de données) et en
exposition.
1-1 Etendu du domaine concerné
La mise en perspective historique et culturelle des mutations et pratiques liées aux restes dans
l’espace méditerranéen impose de couvrir un champ suffisamment vaste pour montrer les multiples
dimensions d’une économie des restes.
Le reste a des acceptions multiples : relique, trace, ruine, ordure, déchet. Il engage des valeurs
contrastées : pur/impur ; propre/sale ; caché/montré ; sacré/profane ; abondance/pauvreté ;
jeté/conservé…
D’un côté le reste humain transformé par le rite funéraire, parfois exhumé, présenté comme une
relique sacrée, de l’autre le déchet et ses différents modes de traitement possibles du tri et du
recyclage (parfois dans une œuvre d’art !) jusqu’à sa disparition la plus totale par un traitement radical
(enfouir, incinérer, immerger…)
Les modalités d’analyse et de transformation des restes révèlent ainsi les grandes catégories dans
lesquelles ils prennent place.
1-2 pistes thématiques
Les restes comme indicateurs culturels et sociaux : les déchets sont des témoins de l’état des sociétés
d’aujourd’hui (exemples de la rudologie qui étudie les contenus des poubelles dans différents
quartiers) et d’hier (exemple de la fouille archéologique).
Restes humains : reconnaissance, traitement, reconstitutions. (Embaumement, techniques de
thanatopraxie, reconstitution des dépouilles lors d’exhumations de charniers…).

5
Traitement des restes et pratiques funéraires comme révélateurs d’une fonction symbolique
essentielle : assurer une présence de ce qui a disparu dans la société et donc contribuer à la
transmission des cultures.
Déchets à faire disparaitre ou à cacher. La prise en compte des déchets dans les politiques publiques a
pourtant une histoire récente et diffère selon les pays2. Les études et enquêtes déjà faites ou à
organiser en différents points du bassin méditerranéen permettront d’évoquer les manières dont les
sociétés considèrent et prennent en charge leurs déchets3 dans le contexte d’un accroissement
considérable des rejets des sociétés et donc d’un accroissement des risques écologiques (on estime à
2,5 milliards de tonnes la production annuelle mondiale des déchets).
Ces politiques se traduisent par la dévolution d’espaces spécifiques (les décharges comme cimetières
des sociétés de consommation), le développement de métiers spécifiques (chiffonniers, biffins,
éboueurs….) ; des économies marchandes parfois parallèles (décharges sauvages, trafics de déchets,
etc) ; des transferts technologiques (techniques de retraitement …)
Récupération et recyclage, des économies informelles en transformation. Ces processus correspondent
à des formes de requalifications des objets qui sont réintroduits dans le système économique
(marchand, non marchand, domestique) soit par réemplois, soit par transformations. Les exemples
vont de la cuisine des restes aux différents intermédiaires du recyclage (de la déchetterie aux vide-
greniers en passant par les formes d’échanges caritatifs…) jusqu’aux usages que les artisans et les
artistes font des restes.
Ces pistes permettent de dégager plusieurs thèmes de recherches dans différentes disciplines des
sciences humaines et sociales selon l’angle choisi pour aborder l’économie des restes :
- Analyse des restes et connaissance des sociétés : la rudologie comme science sociale
- Accommoder les restes humains : pratiques et rites funéraires
- Les cultes des restes : la relique et la mise en en scène des restes
- Les marchés du reste : places et industries
- Hommes des restes : métiers, statuts sociaux, représentations
- Le droit et les restes : glanage et grappillage
- Esthétique du reste : faire de l’art avec les restes
- Faire du neuf avec des restes : la réhabilitation et le recyclage
- La « cuisine » des restes
…….
2 En Europe cette prise en compte remonte au XIXe siècle avec la prise en considération des thèses hygiénistes.
3 Dans la loi française ( 1975) , « déchet: tout résidu d’un processus de production, de transformation ou
d’utilisation, toute substance, matériau ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur
destine à l’abandon ».
 6
6
1
/
6
100%