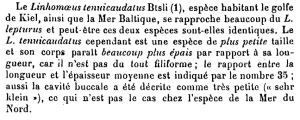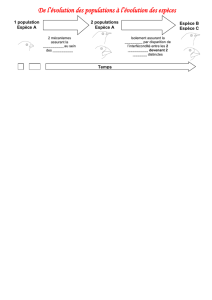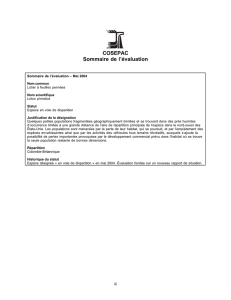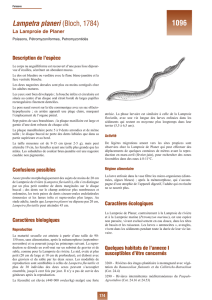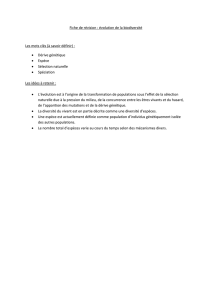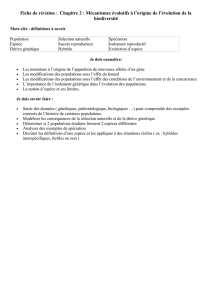Position de thèse - Université Paris

1/7
L’espèce humaine, norme fondamentale du droit de la bioéthique
Philippe Descamps
Position de thèse
La notion d’espèce humaine est entrée dans le droit français à l’occasion de la
loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, dite première loi de
bioéthique. Le législateur a alors souhaité insérer dans le Code civil l’article 16-4
précisant que « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine » afin
d’interdire et de prévenir toute forme de modification des lignées germinales
humaines. Au-delà des éventuelles justifications que peut trouver l’insertion de la
protection de l’espèce humaine, il convient de pointer le caractère inédit des mesures
juridiques qui l’ont accompagnée. Avec elles, en effet, le Code civil a intégré une
série d’interdictions strictes tendant à limiter la liberté de l’individu au nom de la
préservation de l’intégrité de l’espèce humaine et il a, par le fait, rompu avec une
longue tradition remontant à sa création en 1804 et qui faisait de lui le temple de la
protection de l’individu et de ses libertés.
Après la loi du 6 août 2004 portant révision des lois de bioéthique, l’espèce humaine
est devenue une des valeurs les mieux protégées du droit pénal français. Cette loi a en
effet institué une nouvelle incrimination, les « crimes contre l’espèce humaine » afin
de sanctionner toute tentative de clonage reproductif humain ainsi que toute pratique
eugénique. La disposition, qui prend place dans le Code pénal aux articles 214-1 et
suivants, est remarquable à bien des égards. Les sanctions prévues pour ces crimes
sont tout d’abord exceptionnellement sévères puisqu’elles sont comparables à celles
prévues en cas de meurtre avec préméditation. En outre, la nouvelle incrimination est
affectée du plus long délai de prescription de l’action publique que connaisse le droit
français si l’on excepte les « crimes contre l’humanité » qui font par ailleurs l’objet
d’une définition internationale. Enfin, le régime de ces crimes est parfaitement
dérogatoire à de multiples dispositions de procédure pénales, ce qui les rend à
proprement parler extraordinaires.
De manière générale, l’introduction de l’espèce humaine dans le droit a peu à peu
modifié la définition de la personne juridique en tant que sujet de droit. En effet dès
lors que l’individu détenteur et sujet du droit est compris comme élément d’un

2/7
ensemble au nom duquel il est possible de limiter, voire d’entraver sa liberté, la
personne juridique ne peut plus être pleinement considérée comme la source, la raison
et la destination du droit. Tout se passe comme si, au contraire, en intégrant l’espèce
humaine comme valeur fondamentale, le droit avait relégué la personne dans un
second rôle. Un tel bouleversement mérite assurément que l’on s’y attarde. Et il s’agit
avant tout de comprendre comment l’espèce humaine s’est ainsi installée au cœur du
droit français d’une manière toujours exceptionnelle et comment les lois de
bioéthique de 1994 et 2004 l’ont peu à peu érigée en valeur fondamentale du droit,
suivant en cela un mouvement repérable aussi dans le droit communautaire et
international.
Le fait est suffisamment rare – et même parfaitement inédit – pour être remarqué :
l’espèce humaine, entité totalement inconnue du droit français avant 1994, y est
entrée pour occuper une place de choix parmi les valeurs juridiques les mieux
protégées. Elle s’est imposée – pour ainsi dire naturellement – au législateur ainsi
qu’à la doctrine tout comme si elle avait toujours été là, se tenant tacitement dans
l’évidence de sa référence. Ce simple fait aurait pu susciter une abondante littérature
juridique et constituer le point de départ de nombreuses thèses de droit. Or, force est
de constater – et, dans le même temps, de manifester un certain étonnement – que tel
n’a pas été le cas : l’espèce humaine est entrée dans le droit sans coup férir et sans
que l’immense majorité des juristes s’en inquiétât. Et pourtant, les multiples
interrogations que soulèvent l’expression elle-même d’espèce humaine, la solennité
des dispositions juridiques qui s’y réfèrent et les bouleversements que l’introduction
d’une telle notion entraîne dans la conception de la personne juridique appelaient un
long travail d’éclaircissement et de mise au jour des enjeux d’une telle référence.
Dans un premier temps, nous devons nous interroger sur la pertinence du recours à
une notion qui, en apparence du moins, renvoie à une tout autre discipline que le
droit, savoir la biologie et plus particulièrement la classification du vivant. Il convient
ainsi de se demander comment le droit peut se saisir d’une notion qui semble avoir
été littéralement importée de la biologie. Certes ce n’est pas la première fois que le
droit, dans sa lettre, renvoie à une notion extra-juridique, cela est même monnaie
courante. Cependant la notion d’espèce humaine présente à cet égard un certain
nombre de particularités que l’on ne peut considérer comme négligeables. A

3/7
proprement parler, le droit ne l’évoque pas, il ne se contente pas d’y renvoyer en
laissant à la biologie le soin d’en donner une claire définition. Il la prend au contraire
en charge et la revendique comme notion juridique fondamentale et en garantit la
protection. Aussi, depuis son introduction, l’espèce humaine est-elle ce au nom de
quoi le droit s’élabore, et ce pour quoi il est fait. Elle n’est pas en effet simplement un
objet du droit qui ne peut la considérer uniquement comme une chose, elle se présente
plus volontiers comme une entité comparable à la personne juridique. Autrement dit,
l’espèce humaine est peu à peu devenue une nouvelle figure du sujet de droit,
concurrençant dans sa primauté la personne.
On pourrait s’en tenir là et se contenter de pointer le fait que l’introduction de
l’espèce humaine a modifié en profondeur le droit dans sa fonction, sa destination et
sa raison d’être. Une fois repérée une telle mutation, il faudrait alors en énumérer les
conséquences et en déterminer la portée. Toutefois, dans la lettre même du droit, la
référence à l’espèce humaine renvoie explicitement à une notion biologique. Nous
sommes donc invité, par le droit lui-même et les dispositions qui se réfèrent à
l’espèce, à interroger le concept biologique d’espèce. Or, précisément, du point de
vue de la biologie elle-même, l’espèce est un concept pour le moins problématique :
ne connaissant pas de définition univoque et fixe, il est avant tout un enjeu théorique
suscitant de nombreuses polémiques épistémologiques. En aucun cas, il ne se
présente comme un objet clairement circonscrit et parfaitement identifié. Quant à
« l’espèce humaine », il ne s’agit, biologiquement, que d’une expression
approximative et non rigoureuse qui désigne, en termes plus stricts, le taxon Homo
sapiens.
Un tel constat complique redoutablement la problématique de l’introduction de la
notion d’espèce humaine au sein du droit. Face à l’impossibilité de cerner de manière
satisfaisante cet objet, tant du point de vue juridique (puisqu’elle n’est ni une
personne ni une chose) que biologique (puisque, à proprement parler, elle n’existe pas
pour le biologiste), nous nous retrouvons nécessairement face à ce qu’il faut bien
appeler un problème, parmi les plus aigus qui soient. Que faire en effet d’une entité
non définie et ne se laissant pas appréhender par aucune discipline, mais que le droit
protège néanmoins fermement ? La question se fait d’autant plus pressante que les
sanctions prévues par le droit pour les infractions à l’endroit de l’espèce humaine sont

4/7
particulièrement sévères et que des individus peuvent ainsi être en son nom privés de
leur liberté et déchus de leurs droits civiques.
Il reste à savoir si l’impossibilité de définir strictement la notion d’espèce humaine est
d’ordre théorique ou si elle résulte d’une erreur d’appréhension. Si l’on ne peut
aborder et comprendre la notion d’espèce humaine ni avec les outils traditionnels de
la science juridique ni avec ceux de la biologie, c’est qu’elle appartient à une autre
discipline. Et nous sommes tenus d’aller chercher ailleurs une telle définition dès lors
que cette référence est inscrite dans la lettre du droit elle-même. Ne pas s’acquitter
d’une telle recherche serait en effet admettre sans sourciller que certaines dispositions
juridiques relèvent intégralement de l’arbitraire politique ; ce qui, dans un état de
droit démocratique et républicain, ne saurait être toléré. Par ailleurs, le droit pénal
lequel est d’interprétation stricte, il faut bien trouver une signification précise à cette
notion qui y figure désormais en bonne place.
Or l’espèce humaine est bien un objet, mais elle n’est ni celui du droit ni celui de la
biologie. Elle est l’objet d’un souci éthique et il s’agit, en ce sens, d’une notion
morale avant tout. La notion d’espèce humaine n’acquiert en effet d’objectivité qu’en
tant qu’elle est visée par l’inquiétude éthique qui accompagne le développement des
biotechnologies et particulièrement l’extension du pouvoir de la technique sur la
reproduction humaine. Et ce souci éthique s’est exprimé, depuis quelques décennies,
avec une réelle insistance et sous de multiples formes. Nous avons donc pris le parti
de la considérer comme une Idée pratique et de tenter de saisir ce qui se jouait pour la
théorie morale, pour l’agent moral et pour le droit dans « l’éthique de l’espèce
humaine ». Finalement nous avons dû nous demander qui était l’homme de l’éthique
de l’espèce humaine et à quelle figure de l’individu une telle éthique renvoyait.
Il faut d’emblée souligner le fait qu’une éthique de l’espèce humaine, en accordant à
celle-ci une certaine primauté, ne peut qu’esquisser une image particulière de
l’individu, savoir celle d’une entité biologique appartenant à l’ensemble que constitue
l’espèce. L’analyse précise des principes fondamentaux de cette éthique de l’espèce
humaine permet non seulement d’esquisser la teneur de cet individu-élément-de-
l’espèce mais aussi de rendre compte du fait qu’elle s’exprime principalement dans et
par le droit.

5/7
En ce qu’elle considère l’individu comme élément d’un ensemble, l’éthique de
l’espèce humaine s’affirme comme non individualiste, voire anti-individualiste. Elle
se doit en conséquence, quelle qu’en soit la forme et la tradition dans laquelle elle
entend s’inscrire, de penser l’individu comme entité dépendante, voire déterminée par
des principes qui le dépassent et le transcendent. En ce sens, l’éthique de l’espèce
humaine ne peut que renoncer à l’individu compris comme autonomie. Par ailleurs,
parce que, par définition, elle le rattache à une appartenance qui doit s’entendre
comme biologique, elle ne peut que le renvoyer et le river à sa nature. On ne
s’étonnera donc pas de la résurgence contemporaine du thème de la nature humaine
dans le discours éthique.
Afin d’en saisir plus précisément la teneur et la portée, il convient par ailleurs de
s’interroger sur ce qui suscite et motive l’affirmation de ce paradigme éthique de
l’espèce humaine. Il faut l’admettre, l’analyse est largement facilitée par l’unanimité
qui se dégage dans l’éthique contemporaine sur cette question. Le paradigme de
l’espèce humaine (ou encore, la prise en compte éthique de la perspective de l’espèce
humaine) est annoncé comme un point de vue rendu nécessaire par le développement
des biotechnologies et plus généralement par l’emprise de la technique sur le vivant.
Aussi ledit paradigme a-t-il avant tout pour fonction de contrer ou d’endiguer la
puissance technicienne en s’attachant à préserver les caractéristiques fondamentales
et essentielles de la nature humaine. Dès lors, l’éthique de l’espèce humaine est-elle,
dans son origine même, une réponse, si ce n’est une réaction, à ce que la technique
permet et offre comme possibilités d’interventions sur le vivant. Cette caractéristique
explique en grande partie la forme si particulière des normes qu’elle produit. Il ne
s’agit pas d’une éthique élaborée à partir de l’analyse du sujet moral qui tâcherait de
déterminer et formuler son devoir-être mais au contraire d’un discours qui, une fois
posée une nature humaine, au contenu parfois très déterminé, entend indiquer les
limites de l’agir humain en vue de conserver les principales qualités ontiques de l’être
humain. En un mot, l’éthique de l’espèce humaine opère délibérément (même si ce
geste s’accompagne parfois, comme chez Habermas, d’un certain regret) une
réduction du devoir-être à l’être. Plus exactement, elle détermine le devoir-être à
partir des caractéristiques de l’être naturel telles qu’elles sont mises au jour, en creux,
par la maîtrise technique du vivant.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%