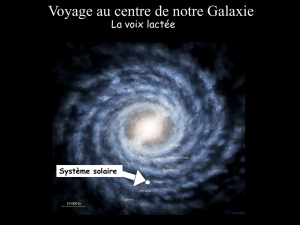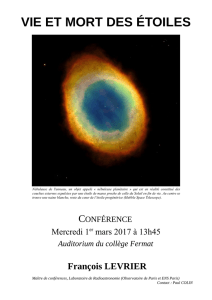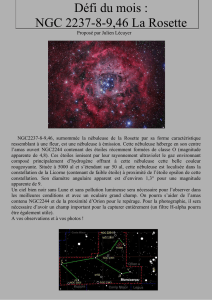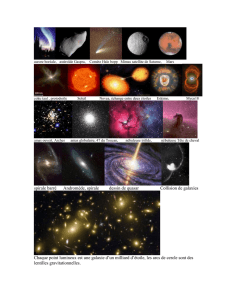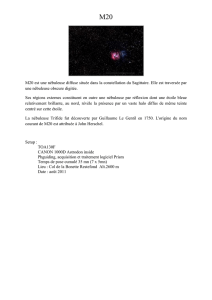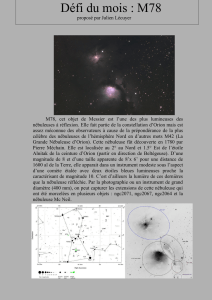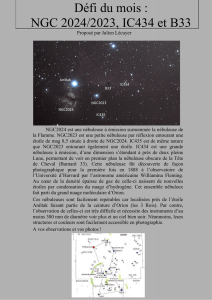image du mois de décembre 2016 - Société d`Astronomie Populaire

L’image du mois de décembre 2016 : la Trompe de l’Éléphant
Pour la fin de l’année 2016, nous restons dans le ciel profond avec la Trompe de l’Eléphant, parfaitement reconnaissable
à sa forme. C’est une nébuleuse obscure contenue dans la nébuleuse par émission IC 1396, elle-même immergée au
cœur d’un jeune amas stellaire.
En astronomie, les nébuleuses sombres, les nébuleuses obscures ou encore nébuleuses d’absorption sont des régions
où les poussières du milieu interstellaire semblent se concentrer en grands nuages opaques dans le domaine visible qui,
de ce fait, apparaissent à nos yeux comme des régions pauvres en étoiles.
Alors qu’en réalité, c’est dans les régions internes de ces nébuleuses sombres que la formation des étoiles se produit.
Cette région du ciel a déjà été présentée en septembre 2014 par Christophe Mercier qui l’avait photographiée en fausses
couleurs afin de favoriser une dominante bleue.
Ici, seule la région entourant la Trompe de l’Éléphant a été sélectionnée par Jean Pierre Debet. Elle a été réalisée au mois
d’août 2016 sur plusieurs nuits en 10H 26 minutes de pose avec une lunette TMB de focale 520 mm, équipée d’une caméra
SBIG 8300 et des 3 filtres SII, HII et OIII, dont les images recombinées permettent de présenter l’Hydrogène sous sa couleur
rouge. Le traitement numérique a été conduit avec le logiciel Pixinsight.

des formes souvent irrégulières, sans frontières bien définies, mais ressemblant parfois à des « piliers ». Ce sont des poches
de poussières et de gaz froid relativement dense, principalement de l’hydrogène sous forme moléculaire (H2), opaques à la
lumière visible en provenance de la nébuleuse qui se trouve derrière. Ces nuages denses possèdent un champ magnétique
important les empêchant de s’effondrer sous l’effet de leur propre gravitation.
Nous ne pouvons les observer dans le domaine visible que si elles obscurcissent une partie d’une nébuleuse en émission
(comme c’est le cas ici) ou en réflexion, ou bien si elles bloquent la lumière des étoiles qui se trouvent en arrière-plan.
Par contre, elles deviennent détectables directement dans les domaines infrarouge et micro-ondes à cause de leur
température interne froide et de leur émission dans ces domaines de longueurs d’ondes. Leur rayonnement n’est pas
absorbé par la poussière et peut donc traverser aisément les nuages sombres. Grâce à l’imagerie infrarouge, on sait que la
Trompe de l’Éléphant contient de nombreuses étoiles très jeunes de moins de 100 000 ans, ce qui est très peu pour une
étoile. D’une longueur de 20 années-lumière et plusieurs centaines de milliers de fois plus massive que le Soleil, elle
contient le matériau brut à partir duquel vont se former les étoiles et les proto-étoiles.
Elle est du même type que la célèbre « Tête de Cheval » dans Orion.
D’autres informations sur la position et les caractéristiques de la nébuleuse IC 1396, ainsi que sur la Trompe de l’Éléphant
ont déjà été publiées dans l’article de septembre 2014. Les lecteurs intéressés pourront s’y reporter s’ils le souhaitent.
Webographie
[1] http://saplimoges.fr/limage-du-mois-de-septembre-2014-ic-1396-amas-detoiles-plonge-dans-une-nebuleuse-a-emission/
[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_obscure
[3] http://www.astropegase.com/emission+reflexion.htm
Rédaction : Michel Vampouille
L’image du mois de février 2016 : la Nébuleuse du Cocon
Plongée dans le ciel profond en février 2016 avec cette image qui contient pas moins de 3 objets célestes différents : tout
d’abord, la Nébuleuse du Cocon, alias Sharpless-125 (Sh-125 en abrégé), une nébuleuse en émission de couleur rouge,
ensuite, un amas ouvert de jeunes étoiles, IC 5146, enserré dans la nébuleuse et la faisant briller, et enfin, une fraction de
la nébuleuse obscure Barnard 168, entourant la nébuleuse du Cocon et s’étirant très loin vers la droite dans la direction de
2 étoiles orangées bien reconnaissables.
Cliquer sur l’image pour l’observer en haute résolution.

Tout cet ensemble a été photographié durant les nuits des 19 et 23 juillet 2015 par Jean Pierre Debet à Saint Léonard de
Noblat, avec un télescope C9 muni de son réducteur, et équipé d’une caméra SBIG STF 8300. Le temps de pose global est
de 3H 04 minutes se décomposant ainsi : Hα : 1H30 en 16 poses Binning 1, Rouge : 30 minutes en 20 poses binning 2, Vert :
27 minutes en 18 poses binning 2, Bleu : 37 minutes en 25 poses binning 2. Le traitement numérique a été mené avec
Pixinsight selon la procédure HαRVB.
Caractéristiques de la Nébuleuse du Cocon [1] :
Cette belle nébuleuse couvre un champ angulaire d’une douzaine de minutes. Elle mesure près de 15 années-lumière de
diamètre et se trouve à quelque 4 000 années-lumière de nous dans la constellation boréale du Cygne, en limite de la
frontière avec celle du Lézard, comme le montre le schéma suivant réalisé avec Stellarium.

Pour la trouver, il faut partir de
Deneb, la queue de Cygne, et se
diriger vers le milieu du le
Lézard. La Nébuleuse est aux
2/3 du chemin. De magnitude
7.2, elle est surtout observable
grâce à l’amas ouvert qu’elle
contient. Comme d’autres
régions de formation d’étoiles,
elle brille principalement en
rouge et bleu. Le rouge, car
c’est la couleur caractéristique
de l’émission de l’hydrogène
moléculaire [2] excité par le
rayonnement des jeunes et
chaudes étoiles bleues de
l’amas ouvert, et le bleu car la
lumière de ces mêmes étoiles
se réfléchit sur la poussière
délimitant les bords d’un nuage
moléculaire autrement invisible.
C’est dans ce type de nuage
que naissent les étoiles…
Caractéristiques de l’amas ouvert IC 5146
C’est lui qui permet de repérer la nébuleuse du Cocon. Il est composé d’une dizaine de jeunes étoiles dont la couleur bleue,
bien reconnaissable sur la photo, révèle leur température élevée. La brillante étoile près du centre est probablement la plus
jeune, ne dépassant pas quelque centaines de milliers d’années existence. Elle alimente la luminosité de la nébuleuse tandis
qu’elle creuse une cavité – bien visible – dans le gaz et la poussière du nuage moléculaire [1].
A l’enregistrement, une longue pause avec le filtre Hα est nécessaire pour bien saisir tous les nuances sombres contenues
dans la couleur rouge spécifique du nuage d’hydrogène moléculaire de la nébuleuse.
Caractéristiques de la nébuleuse obscure Barnard 168 :
Les nébuleuses obscures – par absorption – sont répertoriées dans le catalogue “Barnard” des 349 objets sombres du ciel.
Ici, sa présence se fait remarquer par l’absence d’étoiles dans la région entourant la nébuleuse et se prolongeant vers la
droite selon une diagonale montante. Les rares étoiles qu’on voit se trouvent devant la nébuleuse obscure.
Alors que IC 5146 est extrêmement difficile à percevoir, B 168 est bien visible aux jumelles sous un ciel pur, tel un chenal
sombre quasiment rectiligne en pleine Voie Lactée. Les dimensions de B 168, sans commune mesure avec celles de la
nébuleuse du Cocon, demandent l’utilisation d’un instrument à grand champ pour capturer tout entier ce tentacule de
poussière. Une focale de 500mm est alors un maximum avec un APN reflex numérique défiltré [3].
Il sera intéressant de choisir cette nébuleuse obscure comme prochaine cible pour bien montrer toute son étendue…
Webographie :
[1] http://www.cidehom.com//apod.php?_date=090305
[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_mol%C3%A9culaire
[3] http://www.astrosurf.com/beaudoin/Cocoon.htm
Rédaction : Michel Vampouille
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%